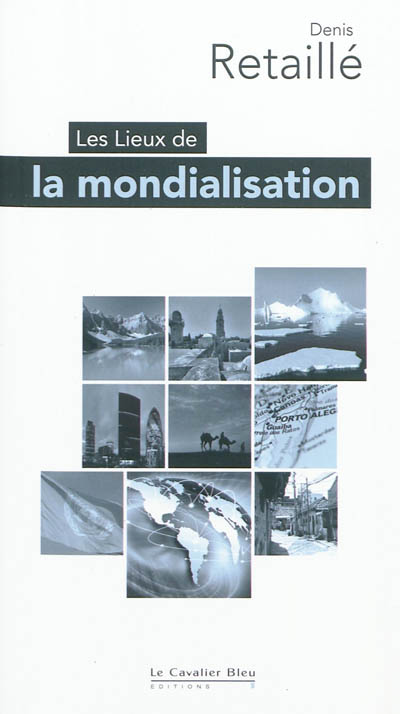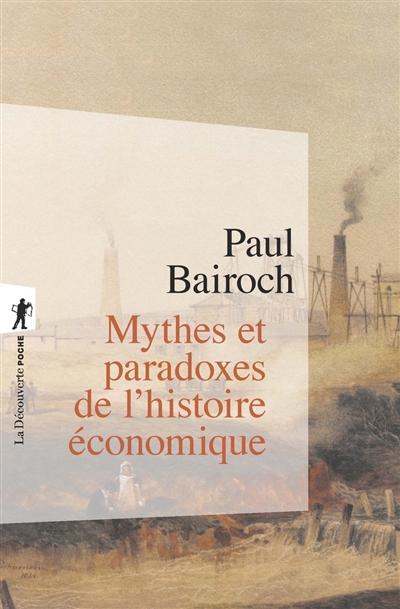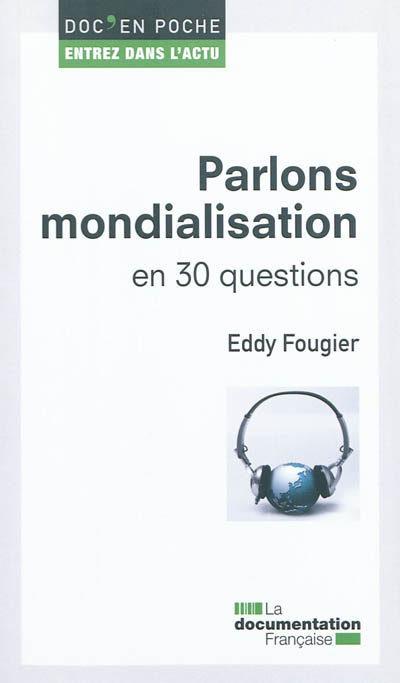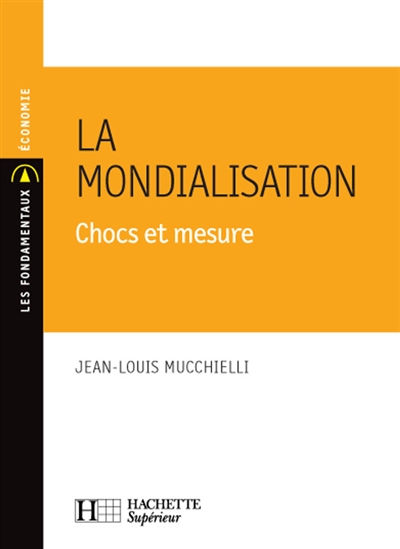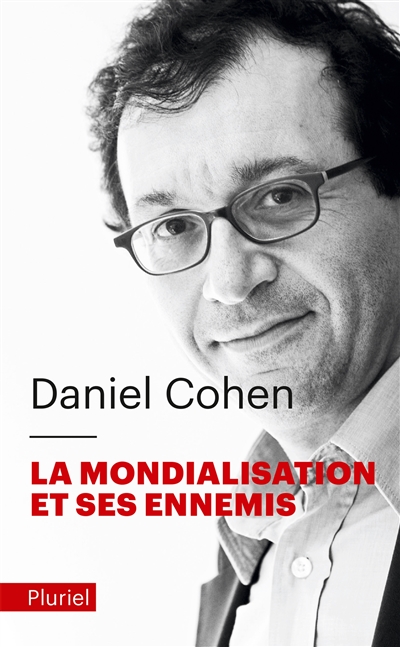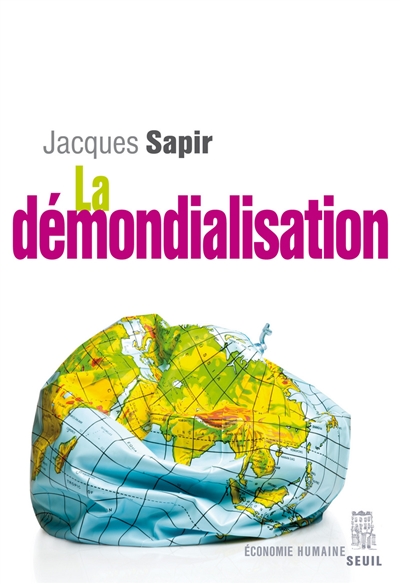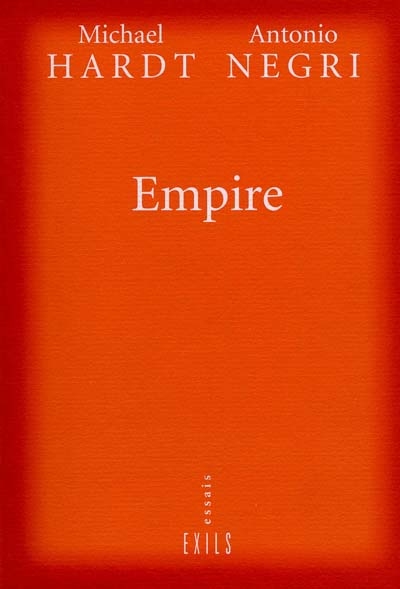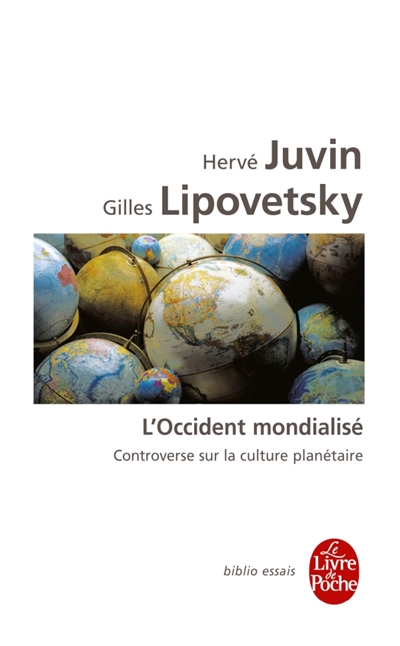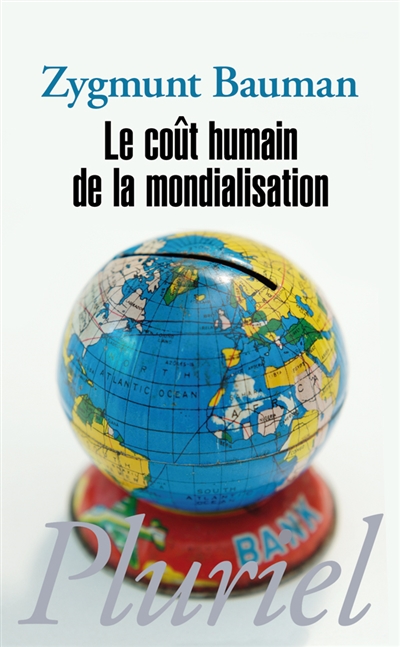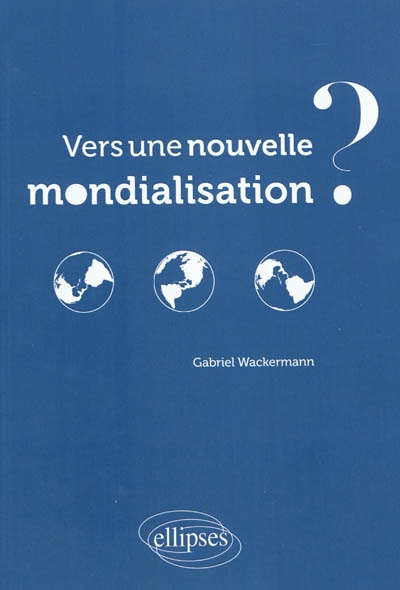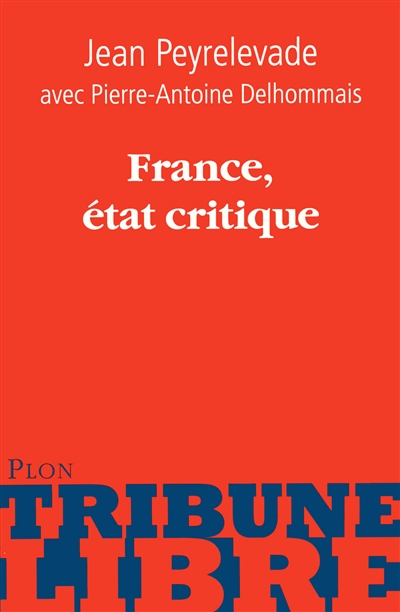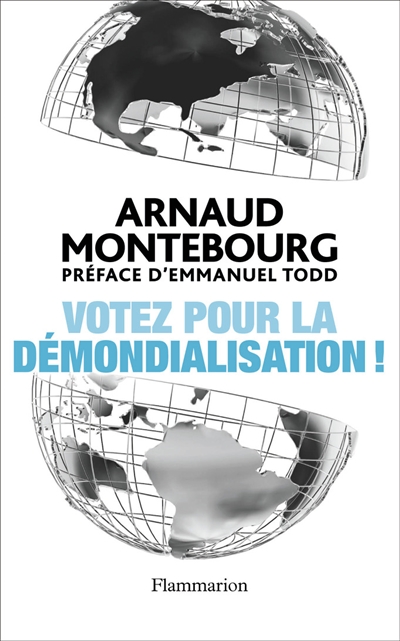Le résultat des primaires socialistes et la publication du manifeste-programme d'Arnaud Montebourg2 a mis ce thème de la « démondialisation » au centre des discussions. Selon un sondage des Échos, de nombreux Français sont réceptifs aux thèses du protectionnisme. Mais la mondialisation est plus vaste que le simple échange de marchandises comme nous l'indique Jean-Louis Mucchielli3, c'est un phénomène à visage multiples : démographique avec les migrations, commercial avec l'explosion du commerce mondial, industriel avec les firmes multinationales et les délocalisations, technologiques et culturelle. Le trait saillant qui émerge est celui d'une déterritorialisation des flux. L'ancienne vision internationale, entre nations sous l'égide des États, semble céder le pas à celle de flux croisés organisés principalement par les firmes multinationales sous l'égide des marchés financiers, les États devenant des complices volontaires du processus.
…mais qui n'est pas si nouveau historiquement
Mais est-ce si récent ? L'idée commune est aujourd'hui que la mondialisation est nouvelle, irréversible et synonyme de progrès. Pourtant, des historiens de l'économie, comme Bertrand Blancheton4, nous montrent que la mondialisation ou globalisation selon l'expression anglo-saxonne, était très forte avant 1914. Dès 1848, dans le « Manifeste communiste », Marx et Engels décrivaient la constitution d'un marché mondial. Les deux guerres mondiales l'ont fait régresser avant qu'elle ne reparte dans les années 1970-80, pour connaître un grand essor avec les politiques de libéralisation et de dérèglementation et l'insertion dans l'économie mondiale des anciens pays socialistes ou de la Chine. Il y a donc une illusion rétrospective à penser le phénomène comme une nouveauté, même si les évolutions des technologies de l'information et de la communication lui donnent une rapidité inégalée. Certains indicateurs de globalisation n'ont été dépassés que récemment et un penseur et homme politique marxiste comme Lénine analysait dès 1916 la globalisation comme impérialisme, stade suprême du capitalisme. Les principales caractéristiques qu'il dégageait : prédominance du capital financier, primauté des exportations de capitaux, formation de grandes entreprises à l'échelle mondiale, formation de monopoles en lien avec les États sont en résonance avec aujourd'hui. Cette première mondialisation n'a pas empêché -ou l'a-t-elle précipité ?- la catastrophe de la Première guerre mondiale et la grande crise qui a suivi a exacerbé les tensions commerciales et monétaires. La crise que nous connaissons aujourd'hui réactualise ce passé et éclaire les enjeux du présent. La mondialisation est-elle allée trop loin et comment organiser un repliement qui ne soit pas le résultat d'une catastrophe ou la guerre économique de tous contre tous ?
La mondialisation heureuse…
Pour ses partisans, la mondialisation apparaît comme la réalisation de la « fin de l'histoire », le moment où selon Francis Fukuyama5, les contradicteurs principaux du capitalisme et de la démocratie libérale ont été vaincus. Ce « capitalisme parlementaire » va se diffuser à l'échelle de la planète et les lois naturelles de l'économie et de la société, à savoir des individus poursuivants leurs intérêts égoïste dans le cadre d'un marché libre, vont enfin fonctionner. C'était déjà la vision du XIXeme siècle chez les économistes classiques. Adam Smith, considéré comme le « père » de l'économie politique, fournit encore aujourd'hui le modèle de référence aux tenants de la mondialisation libérale. Selon lui, le cœur de la prospérité des nations réside dans la spécialisation et l'échange. Si chacun se spécialise dans une activité, les progrès de productivité liés à l'apprentissage et à l'augmentation des quantités produites abaissent les coûts et le temps de travail nécessaire à la production. La spécialisation peut s'effectuer dans les activités où l'on est le plus efficace, mais aussi si l'on ne possède aucun avantage d'efficacité par rapport aux autres. C'est ce qu'établit le célèbre modèle des avantages comparatifs de David Ricardo, véritable pierre philosophale des partisans de l'ouverture commerciale et du libre-échange : si un pays se spécialise là où il est le plus favorisé ou le moins défavorisé, il y aura un gain pour lui et ses partenaires. Chacun pourra ainsi se procurer à meilleur compte les produits des autres. Ce processus de spécialisation est comme une division cellulaire commençant au niveau local, puis régional et national dans les entreprises et les branches d'activité pour se propager au niveau mondial. La condition de cette extension mondiale est une grande liberté de circulation des marchandises (le libre-échange) mais aussi des facteurs de production, les hommes et les capitaux : la libre circulation intégrale. Dans ce modèle coopératif, non seulement chacun est gagnant mais ceux qui partent du plus bas rattrapent ceux qui sont les plus avancés. Ainsi l'on converge vers une harmonisation générale des conditions économiques et sociales à l'échelle de la planète. C'est le programme implicite des organisations internationales comme l'OMC qui fait de la libéralisation des échanges de marchandises, de services, de capitaux, le fondement la prospérité. C'est aussi la transcription de la thèse du « doux commerce » chère à Montesquieu : l'échange est un facteur de pacification et un indicateur de progrès. Le monde n'est pas un jeu à somme nulle, où tout ce que l'un gagne l'autre le perd, mais un jeu à somme positive : il y a un gain collectif. C'est cette vision idyllique qui fournit la trame de la « mondialisation heureuse » chère à Alain Minc6.
…. mais pas pour tous
Adam Smith et David Ricardo présentent la mondialisation comme un jeu à somme positive tant à l'intérieur des nations qu'entre nations. Il y a un surplus ou un gain à se partager entre nations mais aussi entre individus à l'intérieur des nations. L'échange international est analysé comme une coopération. Ainsi, si nous supposons deux individus qui coopèrent pour atteindre un objectif que chacun ne peut atteindre seul, si chacun apporte 10 euros, l'avance totale de 20 euros dégage un surplus ou « gain collectif » de 10 euros. On suppose par principe que le partage du gain collectif sera équitable. Cependant, l'histoire montre qu'il n'en a pas été ainsi, ni à l'intérieur des pays entre classes, ni entre nations. Ce peut être toujours le même qui capte le gain et l'écart entre les « deux coopérateurs » devient immense quand le jeu se répète. Pire encore, le gain collectif de 10 euros peut n'être qu'une résultante algébrique : l'un gagne 15 tandis que l'autre perd 5 : l'enrichissement de l'un se fait au prix de l'appauvrissement de l'autre. Jean-Jacques Rousseau nous disait déjà que si l'on a faim dans les campagnes, c'est qu'il y a trop de dépenses de luxe dans les villes. Le développement de la mondialisation depuis deux siècles n'a pas échappé à ces interrogations. Si globalement, la situation des habitants des pays capitalistes du centre s'est amélioré ce fut souvent au détriment des populations de la périphérie dominée ou colonisée. Les classes ouvrières du centre, celles de l'Angleterre notamment, ont bénéficié de la dégradation de la situation de la population du sud, comme l'avait analysé Arghiri Emmanuel7 dans une analyse de « l'Échange inégal » (1969) qui fit couler beaucoup d'encre par ses conclusions politiques : l'exploitation de la classe ouvrière par les capitalistes se dédouble à l'échelle mondiale par celle des pays de la périphérie par ceux du centre. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des populations qui sont touchées et cela ébranle des certitudes. Ainsi, des économistes réputés longtemps partisans de la théorie orthodoxe, comme Paul-Anthony Samuelson, prix Nobel, professeur au MIT (Institut de technologie du Massachusetts), qui, à la fin de sa vie marquait son scepticisme dans un retentissant article sur « l'Acte II » de la mondialisation. Dans le « Premier acte », la Chine et les États-Unis vérifient les résultats de la théorie traditionnelle, chacun a progressé mais les États-Unis conservent leur avance. Le deuxième acte change la donne. Les Chinois progressent dans tous les domaines, et pas seulement dans ceux où ils étaient au départ moins bons que les États-Unis. La prospérité des Américains, et notamment ceux qui sont peu qualifiés, mais pas seulement eux, est menacée : la rente dont bénéficiaient les Anglais au XIXeme ou les habitants du Nord après 1945 est terminée. Ces analyses et d'autres ont alimenté le débat de la campagne des primaires de la présidentielle américaine de 2008, notamment entre Barack Obama et Hilary Clinton à propos de la politique protectionniste. Mais à l'intérieur même des pays développés dans leurs relations avec les pays émergents, les inégalités salariales se creusent au détriment des moins qualifiés. Ces pays importent des produits à fort contenu de travail peu qualifié et exportent des produits à travail plus qualifié. Les travailleurs non qualifiés sont ainsi soumis à la concurrence des pays à bas salaires et à une demande interne de leur force de travail moins intensive. Ils sont relativement perdants par rapport aux salariés qualifiés.
La question nationale est à nouveau posée...
La mondialisation met en jeu la question nationale à plusieurs niveaux. Le premier paraît d'une telle évidence dans les discours que l'on n'en questionne plus le fondement : la compétitivité nationale. A travers cette notion, on réduit la nation au statut d'une entreprise. Pourtant, un économiste réputé comme Paul Krugman8 met en garde contre cette réduction. L'économie nationale n'est pas une entreprise comme Coca-Cola ou Pepsi-Cola qui ne produisent pas pour leurs employés et peuvent se prendre mutuellement des parts de marché. Une économie nationale avancée produit d'abord pour ses propres membres et sa prospérité peut générer celle des autres, par ses importations par exemple. L'entreprise peut fermer ses portes, licencier ses employés, appartenir à un groupe restreint de propriétaires. La nation non. Même si la Grèce « fait faillite », elle ne fermera pas ses portes. De plus, la compétitivité est un concept multiforme. Il en existe une version très restreinte qui vise simplement à vendre moins cher, mais aussi une version plus large et complète qui indique que c'est la capacité de répondre à la demande nationale et étrangère en conservant et en améliorant le niveau de vie existant. On voit immédiatement que dans certains discours politiques c'est souvent la variante restreinte qui est mise en avant : dans ce cas, l'appel à la compétitivité s'accompagne de menaces de baisse des salaires et du pouvoir d'achat et de réduction de la protection sociale. Mais cette réduction de l'économie nationale à un statut d'entreprise maintient quand même l'idée de nation avec un dedans et un dehors. Ceci est remis en cause par la mondialisation actuelle. Alors que la précédente mondialisation avait été celle de l'émergence et l'affirmation et de la construction des grands États-Nations (Allemagne, États-Unis, Japon) avec peu d'investissements directs, la nouvelle est différente. Les firmes multinationales et les marchés financiers globalisés forment aujourd'hui des réseaux « déterritorialisés ». Une part importante des flux commerciaux de marchandises par exemple sont des flux internes aux firmes elles-mêmes. Les processus productifs sont fragmentés, délocalisés, dans leurs étapes intermédiaires, dans de nombreux sites, selon les coûts de la main d'œuvre, les opportunités diverses des ressources et des avantages fiscaux. Les économies nationales deviennent très relatives et les politiques visent souvent à développer l'attractivité de leur territoire ou de leurs États, qui se mettent en concurrence pour attirer les investisseurs et les capitaux : concurrence des fiscalités, assauts de rigueur sociale et salariale, pour rassurer les marchés, mener des politiques de crédibilité et conserver le « triple A ». La mondialisation et surtout la démondialisation, posent la question de la souveraineté politique.
…et avec elle l'internationalisme contre la mondialisation ?
C'est ce qu'analyse Dani Rodrick9 qui estime que les marchés globalisés, les États et la démocratie sont incompatibles. Il présente ainsi ce qu'il appelle « le trilemme politique de l'économie mondiale » :

Le trilemme est un triangle dont chaque sommet présente une possibilité. Mais les trois simultanément sont impossibles. Il faut en choisir deux et sacrifier le troisième. Si le couple H-E l'emporte, la politique démocratique est condamnée par des corsets comme « la règle d'or », le but étant uniquement le maintien de la confiance des marchés. Si c'est H-P, l'État-Nation se dissout au profit de « l'Empire », théorisé par Toni Negri et Michael Hardt10. Enfin la couple E-P, c'est celui de la démondialisation et le retour non au simple repli national mais à l'internationalisme. Ainsi des choix sont possibles mais pas facile à mettre en œuvre. La campagne présidentielle fait déjà apparaître des tendances
Que faire pour la France: imiter l'Allemagne...
Quelles sont les politiques possibles autres que la soumission à la camisole de force ou à une gouvernance mondialisée ou européanisée ? La crise de la zone euro, montre que nous alternons entre la camisole pour rassurer les marchés et des projets sur l'intégration dans une gouvernance européenne. Deux options qui conservent le cadre national sont pourtant présentes. Les deux sont plus ou moins liées à la mouvance du parti socialiste, mais leur écho va beaucoup plus loin.
La première est due à Jean Peyrelevade11, ancien du cabinet du premier ministre Pierre Mauroy et devenu banquier d'affaires. Peyrelevade fut le promoteur de la politique de désinflation compétitive et de rigueur salariale en 1983. Aujourd'hui, il plaide pour une reprise de ces politiques dans le cadre HE de Dani Rodrick. Estimant ainsi que la France est en « état d'urgence » et la mondialisation un fait à accepter, il faut suivre le modèle de rigueur allemand : exporter plus, reconquérir des parts de marché et pour cela, pratiquer une nouvelle politique de rigueur salariale et sociale comme les plans Harz en Allemagne. Sacrifice de la consommation au profit de l'accumulation du capital et des profits, rigueur budgétaire accrue, accroissement de la durée du travail. Il ne faut plus vivre au dessus de ses moyens. La France est ainsi une entreprise qu'il faut gérer en tant que telle dans une conception de la compétitivité restreinte : les Français sont « cigales » (trop dépensiers) « paresseux » (ne travaillent pas suffisamment) et « mauvais » (leur produits sont moins bons que ceux des Allemands) ! Ce programme séduit un arc assez large des responsables politiques et du Medef. Mais que se passe t-il si chaque pays se lance aussi dans la même politique, la concurrence ne risque-t-elle pas d'être aussi destructrice à la fois économiquement, mais aussi socialement et écologiquement ? La concurrence à tout prix, c'est aussi une course effrénée au renouvellement des techniques, des produits et comme le disait le célèbre économiste anglais John Stuart Mill : « L'idée ne m'enchante pas que ma vie dépende de ceux qui pensent que l'état normal de l'humanité est de se battre pour survivre ».
…ou renouer avec le protectionnisme ?
De l'autre côté du spectre, le thème de la démondialisation et du protectionnisme reparaît à travers les analyses de Jacques Sapir12, d'Emmanuel Todd13 et récemment celle d'Arnaud Montebourg. Le protectionnisme est devenu un thème tabou dans le discours politique légitime, assimilé à la régression technologique, l'enfermement sur soi. Pourtant, cette critique, comme le montrent les travaux historiques, est proprement mythologique. C'est l'objet notamment des travaux de Paul Bairoch14. C'est le libre-échange qui est un mythe : le XIXeme siècle ne fut pas libre-échangiste et les périodes de libre-échange ont conduit à des crises. De plus, le libre-échange sacrifie le bien-être de nombreuses fractions de la population, notamment les moins qualifiées. Emmanuel Todd insiste beaucoup sur l'indifférence des élites françaises et européennes au coût du libre-échange généralisé que supportent les populations. D'un point de vue plus théorique, les modèles qu'utilisent les partisans du libre-échange sont ceux d'une économie parfaitement concurrentielle et en situation de plein emploi. Dès que l'on se tourne vers d'autres modèles plus réalistes de concurrence imparfaite et de commerce stratégique, les résultats changent la plupart du temps. La réalité du monde est celle de grandes entreprises oligopolistiques, de coûts fixes très importants, de batailles stratégiques pour conquérir les marchés : centrales nucléaires, trains à grande vitesse, aviation civile etc. L'État qui aide ou qui prend des mesures protectionnistes en faveur de ses producteurs est gagnant. D'où l'interrogation de Paul Krugman : « Is free trade passé ? ».
Enfin, le protectionnisme se décline de plusieurs manières. Celui que veulent réactualiser ces penseurs est à l'origine le protectionnisme éducateur du théoricien allemand Frederic List : les pays émergents, qui à son époque était l'Allemagne et plus tard le Japon, doivent protéger leurs industries naissantes. Aujourd'hui, c'est plutôt un protectionnisme de « renaissance » qui est proposé : renaissance des activités nationales et européennes, mais aussi un nouveau protectionnisme qualifié de « Juste échange » par Jacques Sapir, pour lutter contre le double dumping (mise en concurrence). Le dumping social qui menace l'ensemble de la protection sociale et le dumping écologique des pays qui ne respectent pas les normes environnementales. Ces propositions sont combattues par ceux qui mettent en évidence le degré très fort d'intégration des firmes à l'échelle mondiale. Les exportations chinoises vers l'Europe sont le fait d'entreprises européennes implantées en Chine et dans les exportations de celle-ci, il y des importations en provenance d'Europe. La mondialisation est alors présentée comme irréversible et déjà transnationale. Le Juste échange lui-même dans l'opinion d'Arnaud Montebourg ne peut être qu'européen, mais comment convaincre les Allemands ?
Dans les deux cas, l'Allemagne est au centre du débat : l'imiter pour le premier, la convaincre pour le second d'instaurer un protectionnisme européen et la convertir à une vision écologique du système productif, un retour des usines en Europe et la restauration de la souveraineté politique.
D'autres courants existent aussi, qui récusent l'obsession sous-jacente de la croissance pour la croissance. La mondialisation, outre ses dégâts écologiques, même régulée ou refoulée, renationalisée, ne met pas fin à ce que l'économiste anglais John Maynard Keynes15 désignera comma la « fin du problème économique ». Pour les pays les plus avancés, à partir d'un certain niveau de vie par tête, il faut s'intéresser à une nouvelle répartition des richesses et à orienter la vie vers l'art, la culture, la discussion. Ce n'est certes pas le programme aujourd'hui, hormis chez les « décroissants ».
Lucien Orio
Retour vers « Aux livres citoyens ! »