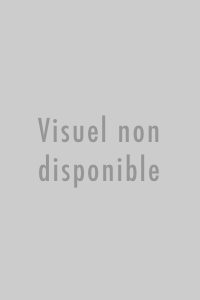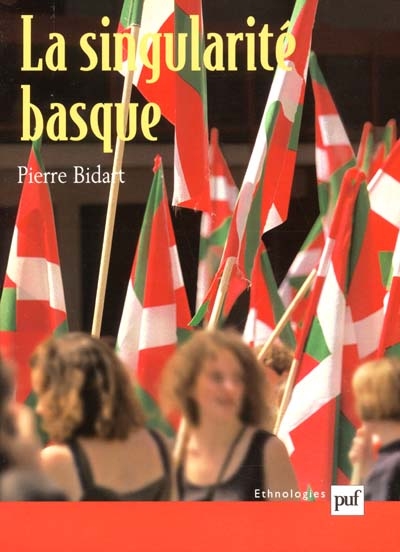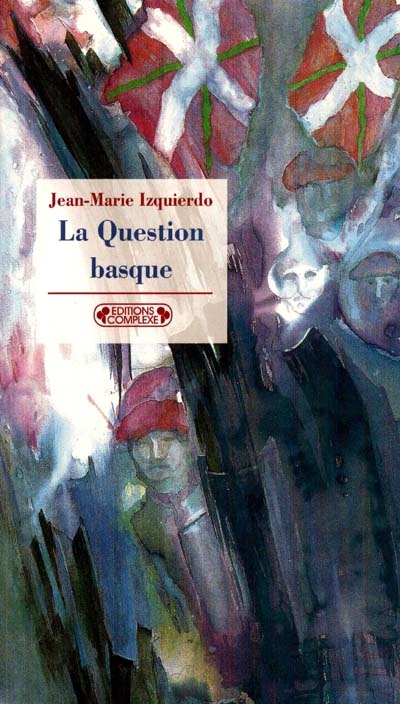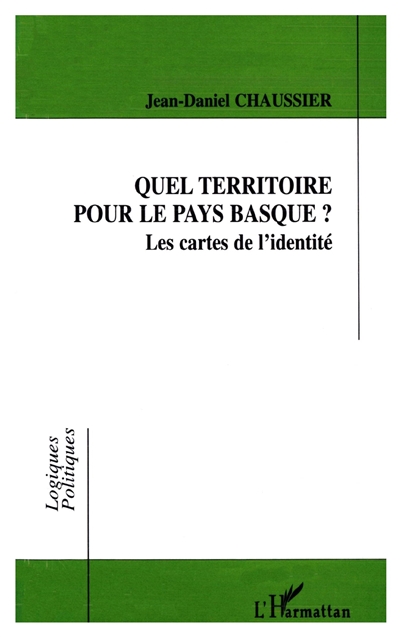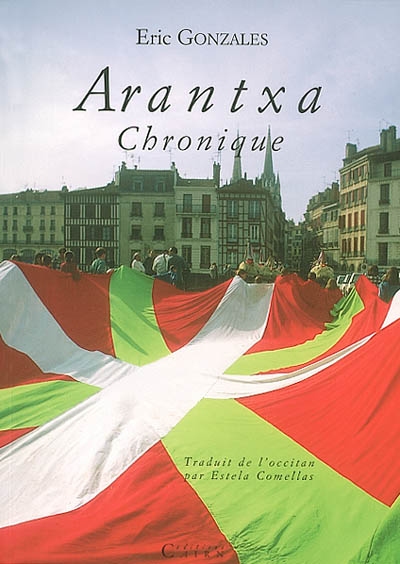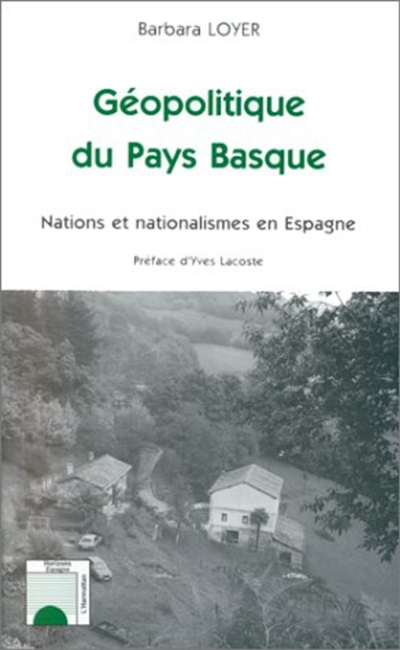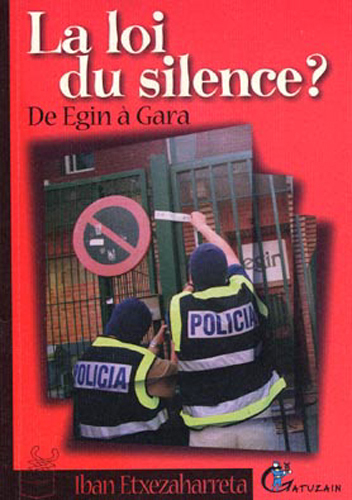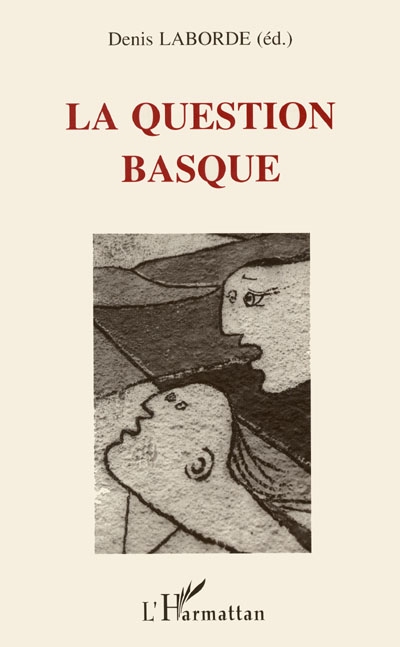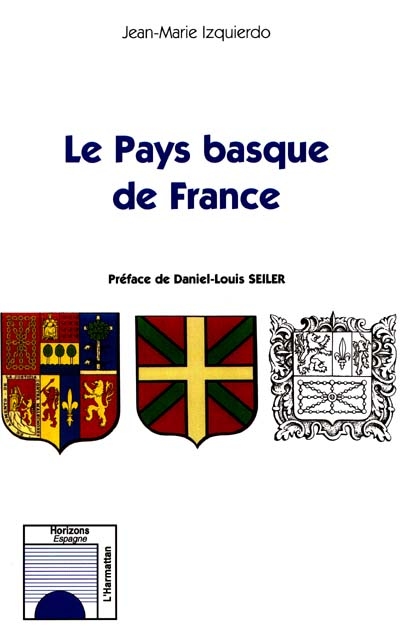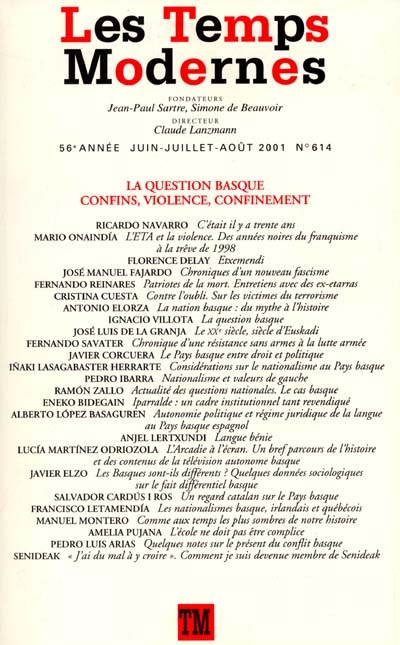Comme d'autres mouvements contestataires nationalistes, la question basque ne cesse de nous intriguer. La singularité basque séduit ou intéresse toujours mais, lorsqu'elle se transforme en question franco-espagnole, il nous est difficile d'évaluer tous les enjeux socio-politiques sans en connaitre leur part historique.
Vous trouverez plus facilement des ouvrages sur le peuple basque que sur la seule question basque. Le thème est, en effet, régulièrement traité dans des revues mais rarement dans des ouvrages (du moins en France).
Jean-Marie Izquierdo (Diplomé de l'IEP de Bordeaux) spécialiste du nationalisme basque a récemment écrit deux ouvrages sur le sujet.
Dans le premier, La Question basque, il tente d'expliquer clairement l'évolution du problème basque de son origine au terrorisme actuel.
Il s'intéresse essentiellement à la partie espagnole, mais nous permet enfin de comprendre le processus de formation de l'état-nation espagnol, de l'apparition du nationalisme et de sa pratique politique actuelle.
Il développe ensuite le cas français dans son dernier livre Le pays basque de France. L'étude fouillée des deux cas transfrontaliers, pourvus d'un même ensemble ethno-linguistique, explique l'importance que revêt la variable étatique. Le politiste essaie, loin de toute imagerie romantico-révolutionnaire, d'établir la réalité nationaliste basque française entre ETA et particularisme régional.
Le langage utilisé est clair et l'on assiste presque à l'un de ses cours de sciences politiques en différé.
Dans la même année, la revue Les Temps Modernes N°614 (La question basque confins, violence, confinement) a ouvert ses pages à ce thème et à de nombreux intervenants essentiellement espagnols. Nationalistes de gauche, partisans de l'autodétermination, constitutionalistes, autonomistes ; historiens, sociologues ou écrivains mêlent leurs divers sentiments sur l'éclatement démocratique actuel avec d'une part les revendications ethniques et nationalistes et d'autre part le rôle impuissant de l'état pressé de suivre le courant de la mondialisation. Ce collectif laisse une large place à la parole multiple et l'on y retrouve le philosophe espagnol Fernando Savater (traduit en France depuis quelques années) dans un éloge de la désobeissance civile en Euskadi contre le terrorisme.
A noter aussi, un glossaire en fin d'ouvrage permettant l'explication de termes géographiques ou politiques.
Dans la continuité des travaux précédents, la thèse de Barbara Loyer, Géopolitique du Pays Basque, parle de la diversité des opinions politiques des citoyens basques. Elle prend la mesure géopolitique de la singularité de la nation espagnole, et de son face à face, sur son territoire avec des nations concurrentes.
En cheminant de problème en question et de particularisme en basquité, un terme émerge de la réflexion, c'est : singularité.
L'anthropologue Pierre Bidard, dans son ouvrage La Singularité basque, lui rend toute sa dimension dans ses diverses facettes : scientifique, religieuse, mythique ou politique. C'est la première contribution anthropologique de la langue française à la connaissance du fait culturel basque. Tout est dit afin de donner un sens historique et généalogique à la notion de singularité : la langue et le peuple, les traditions régionales, les jeux et les fêtes.
Ce texte, dense et très documenté, s'inscrit dans une réflexion différente des précédentes mais est essentiel à la compréhension des différences sans les différends ; car le problème semble avoir plusieurs passés, plusieurs présents et plusieurs avenirs.