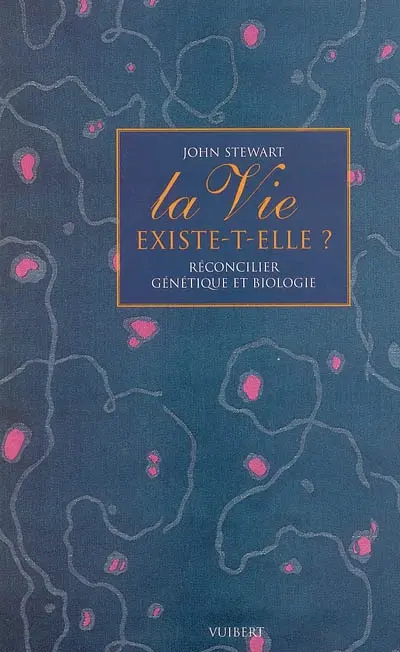en savoir plus

Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).
Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.
Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.
Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...
Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.
Requiert un compte Mollat
Requiert un compte Mollat
La vie existe-t-elle ? : réconcilier génétique et biologie
Auteur : John Stewart
en savoir plus
Résumé
Montre que la biologie contemporaine n'observe plus la vie et accorde une place plus grande au gène. Propose une vision critique de la science génétique tout en cherchant à la réconcilier avec une véritable biologie des organismes. Retrace l'histoire et les progrès de la génétique en mesurant ses limites. ©Electre 2026
Quatrième de couverture
«On n'interroge plus la vie dans les laboratoires» déclarait François Jacob. Partant de ce constat, l'auteur explique comment on a pu en arriver là: l'objet central de la biologie contemporaine n'est plus la vie, mais le gène.
Or, depuis sa fondation par Mendel au XIXe siècle, la génétique est ce qu'on appelle une science différentielle - au sens où une différence dans un facteur génétique est la cause d'une différence dans un phénotype observable. Il s'ensuit que, là où il n'y a pas de différences, la génétique n'est plus opérationnelle. Autrement dit, la génétique ne permet pas d'observer l'invariant ni même de le concevoir. C'est notamment le cas pour le plus important parmi tout ce qui est invariant: le fait que les organismes vivants ne sont pas des «choses», mais des flux d'énergie et de matière organisés de telle sorte que ces organismes se produisent en permanence, d'instant en instant. Appelé autopoïese, cet invariant-là est ignoré de la génétique. D'où le divorce historique qui sépare la génétique de la biologie des organismes.
On peut penser que les grandes découvertes de la biologie moléculaire rendent caduques ces considérations d'histoire et de philosophie des sciences, mais il n'en est rien. On a, certes, découvert la structure moléculaire de l'ADN - support matériel des gènes - ainsi que le «code génétique». Mais un organisme vivant ne se réduit pas à un assemblage de protéines. Et les notions-clés d'«information», de «message» et de «code» - importées de la cybernétique - ont une face cachée: aucun message codé ne porte en lui-même le dispositif permettant de l'interpréter.
L'auteur examine aussi les possibilités d'une réconciliation entre une véritable biologie des organismes et une génétique ramenée à sa juste place par une reconnaissance de ses limites: ce n'est pas parce que les gènes ne peuvent pas tout faire qu'ils ne peuvent rien faire. Ils constituent indéniablement le support d'informations codées puisque depuis trois milliards d'années ces mêmes informations ont permis l'évolution par variation aléatoire et sélection naturelle; une évolution à laquelle nous ne devons pas moins que l'ensemble des organismes vivants actuels.
Fiche Technique
Paru le : 16/09/2004
Thématique : Biologie
Auteur(s) : Auteur : John Stewart
Éditeur(s) :
Vuibert
Collection(s) : Non précisé.
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782711753680
Reliure : Broché
Pages : IV-150
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 17.0 cm
Épaisseur: 1.0 cm
Poids: 284 g