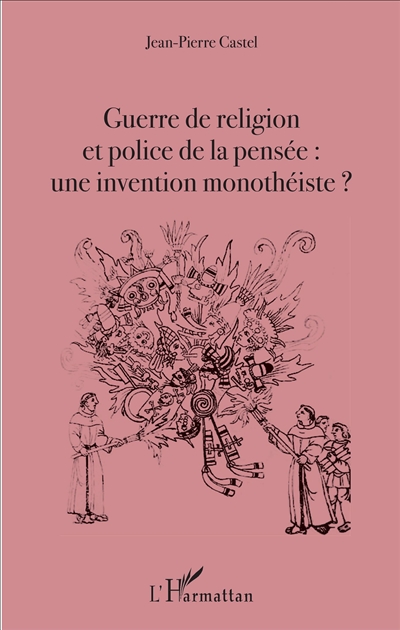en savoir plus

Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).
Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.
Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.
Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...
Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.
Requiert un compte Mollat
Requiert un compte Mollat
- Sciences humaines - Histoire
- Religions - Spiritualités
- Histoire des religions
- Socio-anthropologie des religions, Dialogue inter-religieux
Guerre de religion et police de la pensée : une invention monothéiste ?
Auteur : Jean-Pierre Castel
en savoir plus
Résumé
La violence générée par les valeurs et concepts des religions monothéistes est analysée en regard du polythéisme de l'Antiquité. Le judaïsme, le christianisme et l'islam partagent un complexe d'exclusivisme qui leur est spécifique et dont les conséquences retentissent plus que jamais dans la société civile. Premier essai d'une trilogie qui vise à en présenter les faits. ©Electre 2026
Quatrième de couverture
Guerre de religion et police de la pensée : une invention monothéiste ?
Les religions abrahamiques ont développé une nouvelle motivation de violence : celle de détruire les dieux d'autrui pour imposer le sien. Au nom de l'introduction, inédite jusque là, de la notion du vrai et du faux dans le domaine des dieux.
L'extirpation de l'idolâtrie a justifié des persécutions religieuses, des guerres de religion, un impérialisme de la pensée qui s'est illustré par l'Inquisition, et qui, au nom de l'évangélisation, prétend détruire tout autre système religieux.
En comparaison, le polythéisme a parfois interdit des pratiques religieuses qu'il jugeait dangereuses pour l'ordre public, mais il n'a jamais qualifié un dieu de faux, ni engagé de guerre pour promouvoir un dieu, ni détruit les dieux des peuples vaincus. La pluralité des aspects de la vérité, la relativité de tout énoncé y étaient reconnues. Cette prévention contre l'absolu ne fut retrouvée en Europe qu'à partir de la Renaissance. Des rechutes débouchèrent néanmoins sur la Terreur, sur les « religions séculières », sur les fondamentalismes. Via la mondialisation, la tentation de l'absolu tend aujourd'hui à contaminer d'autres religions.
Prétendre que les religions monothéistes ne sont que « de paix et d'amour » constitue une présentation tronquée de la réalité. Ce qu'elles veulent d'abord, c'est purifier, convertir, exercer une emprise sur les âmes. Il tend à en résulter une diabolisation de l'adversaire et une sacralisation de la violence.
Ce diagnostic reste pourtant contesté voire inaudible. Aussi ne faut-il guère s'étonner de ce que la fin des guerres de religion n'intervienne le plus souvent qu'après un lourd tribut de violence, et que la solution ne vienne pas du monde religieux, mais de la société civile.
Cet essai est le premier d'une trilogie. Il vise à présenter les faits. Le second partira à la recherche des mobiles, et suggérera une voie de solution. Le troisième discutera les arguments des opposants à la thèse de la violence monothéiste.
Fiche Technique
Paru le : 28/10/2016
Thématique : Socio-anthropologie des religions, Dialogue inter-religieux
Auteur(s) : Auteur : Jean-Pierre Castel
Éditeur(s) :
L'Harmattan
Collection(s) : Non précisé.
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-343-10389-1
EAN13 : 9782343103891
Reliure : Broché
Pages : 219
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 1.2 cm
Poids: 349 g