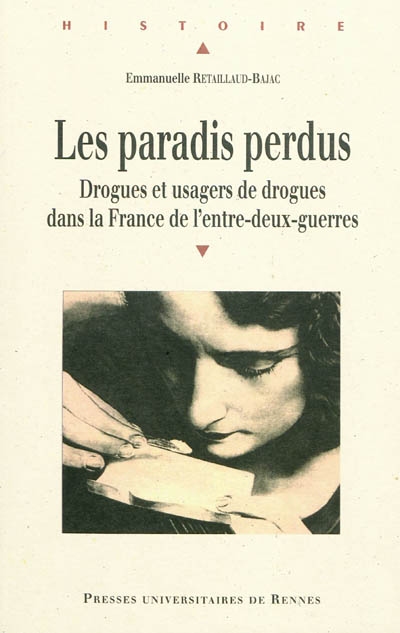en savoir plus

Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).
Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.
Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.
Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...
Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.
Requiert un compte Mollat
Requiert un compte Mollat
Les paradis perdus : drogues et usagers de drogues dans la France de l'entre-deux-guerres
Auteur : Emmanuelle Retaillaud-Bajac
en savoir plus
Résumé
Dès 1916, les drogues relèvent de la loi pénale et les produits tels que cocaïne, opium, morphine ou haschich sont contrôlés et réservés aux usages thérapeutiques. Leur commerce est alors fortement réprimé. Cette étude analyse le mouvement de l'opinion publique, la sociologie et la pratique des usagers, leur sort judiciaire et thérapeutique et interroge les effets du modèle répressif. ©Electre 2026
Quatrième de couverture
Les paradis perdus
Drogues et usagers de drogues dans la France de l'entre-deux-guerres
À compter de 1916, les « paradis artificiels » chers à Baudelaire relèvent en France d'une loi pénale adoptée sous la pression du mouvement prohibitionniste international et d'une opinion publique devenue réticente. Désormais, les produits définis comme « stupéfiants » (opium et ses dérivés tels la morphine et l'héroïne, cocaïne et haschich) sont étroitement contrôlés, réservés aux usages strictement thérapeutiques, tandis que leur commerce illicite est sévèrement réprimé. C'est donc dans la période de l'entre-deux-guerres que s'élaborent les enjeux contemporains de « la question des drogues » : « clandestinisation » des pratiques, mise en place d'un marché parallèle, répression des fraudeurs, marginalisation de certaines catégories d'usagers.
Fondé sur le dépouillement minutieux des archives judiciaires, que complète une ample documentation médicale, journalistique et littéraire, ce travail adapté d'une thèse de doctorat analyse les modalités et les conséquences de cette mutation majeure. Étudiant successivement le mouvement de l'opinion publique, la sociologie et les pratiques des usagers, leur sort judiciaire et thérapeutique, il interroge les effets et l'efficacité du modèle répressif dans la genèse de son élaboration. À travers le devenir du consommateur de stupéfiants, ce sont aussi toute une série d'évolutions anthropologiques et culturelles qui se trouvent abordées : celles du rapport dialectique entre progrès de l'hygiénisme et redéfinition des frontières somatiques, progrès parallèle du contrôle social et de la liberté individuelle. La question des drogues jette ainsi un éclairage original et novateur sur une période qui fut, à bien des titres, un laboratoire de la modernité.
Fiche Technique
Paru le : 03/12/2009
Thématique : Sociologie pénale
Auteur(s) : Auteur : Emmanuelle Retaillaud-Bajac
Éditeur(s) :
Presses universitaires de Rennes
Collection(s) : Histoire
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-7535-0954-2
EAN13 : 9782753509542
Reliure : Broché
Pages : 467
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 3.3 cm
Poids: 708 g