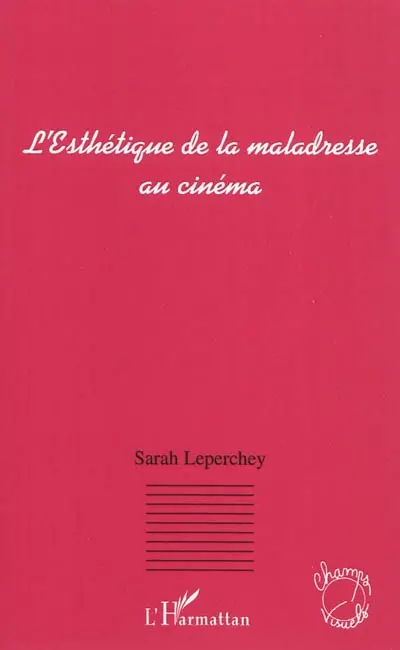en savoir plus

Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).
Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.
Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.
Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...
Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.
Requiert un compte Mollat
Requiert un compte Mollat
L'esthétique de la maladresse au cinéma
Auteur : Sarah Leperchey
en savoir plus
Résumé
Une réflexion sur le problème esthétique que pose la valorisation de la maladresse, en parcourant l'histoire du cinéma, de Man Ray à Jonas Mekas, de Renoir à Pialat. Utilisée pour le burlesque (Charlot, Monsieur Hulot), la maladresse sert aussi à teinter la mise en scène d'amateurisme afin de faire "plus vrai". ©Electre 2026
Quatrième de couverture
L'Esthétique de la maladresse au cinéma
La maladresse n'est pas envisagée ici comme un défaut. En parcourant l'histoire du cinéma (de Man Ray à Jonas Mekas, de Renoir à Pialat), on découvre qu'il existe une maladresse délibérée, relevant d'un programme artistique, d'une visée esthétique. On sait que, dans le burlesque, la maladresse a un pouvoir libérateur : Buster Keaton, Charlot et Monsieur Hulot sont des saboteurs qui mettent à nu l'absurdité de notre quotidien. Certains réalisateurs ont exploité le potentiel subversif de la maladresse pour mettre en crise les conventions du « bien-filmer » traditionnel.
Dans les films de Jacques Rozier, la gaucherie (féconde) des personnages constitue une sorte de manifeste en faveur de l'« amateurisme » de la mise en scène. Comme chez Jean Rouch, Jean-Luc Godard ou Gilles Groulx, il s'agit de rejeter le savoir-faire attaché au réalisme classique pour instaurer un rapport plus authentique à la réalité. Le cinéma contemporain est tributaire de cet héritage ; la maladresse y est largement utilisée dans le but de « faire vrai ».
Une recherche plus approfondie montre que la maladresse recouvre encore d'autres enjeux : elle permet d'interroger les présupposés du médium cinématographique et, in fine, de désigner les limites de l'image, de montrer que quelque chose échappe - qu'il y a du non-visible, de l'insaisissable, de l'imprésentable.
Fiche Technique
Paru le : 01/03/2011
Thématique : Ecrits sur le cinéma
Auteur(s) : Auteur : Sarah Leperchey
Éditeur(s) :
L'Harmattan
Collection(s) : Champs visuels
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-296-54172-6
EAN13 : 9782296541726
Reliure : Broché
Pages : 279
Hauteur: 22.0 cm / Largeur 14.0 cm
Épaisseur: 1.5 cm
Poids: 340 g