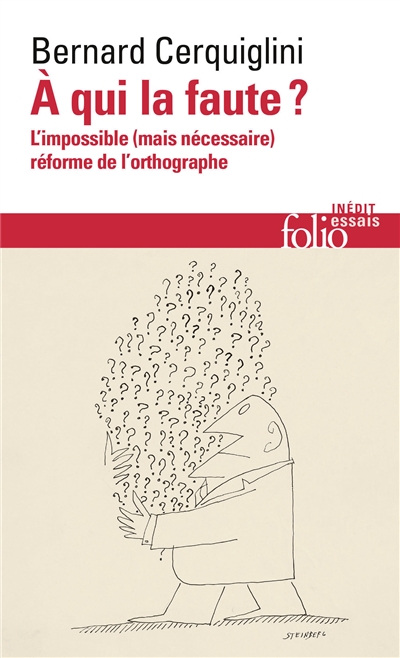Chargement...
Chargement...
Bernard Cerquiglini - A qui la faute ? : l'impossible (mais nécessaire) réforme de l'orthographe
"Le français est une langue difficile, mais l'orthographe est un art qui se maîtrise. Plongez dans les mystères et les paradoxes de la langue française pour comprendre pourquoi elle suscite tant de passion."
Publié le 21/10/2025
Bernard Cerquiglini vous présente son ouvrage "A qui la faute ? : l'impossible (mais nécessaire) réforme de l'orthographe" aux éditions Gallimard. Entretien avec Aurélia Gaillard.
Le linguiste Bernard Cerquiglini décortique les paradoxes de l'orthographe française, en s'appuyant sur son livre, conçu comme une enquête policière. L'énigme à résoudre : pourquoi les francophones aiment-ils tant une orthographe difficile et souvent incohérente, au point de refuser les réformes ? L'auteur part du constat que la faute d'orthographe est perçue non comme une simple erreur, mais comme un crime, révélant un rapport sacralisé et identitaire à la langue.
Le livre identifie plusieurs "coupables", à la fois responsables et innocents de cette situation. Le premier accusé est la corporation des scribes du Moyen Âge qui ont latinisé et étymologisé la langue, rendant l'orthographe plus complexe. Cependant, ils ont aussi, de manière maladroite, compris que l'écrit nécessitait une forme visuelle distinctive pour gérer les nombreux homophones du français. Le deuxième coupable est l'Académie française, qui a scellé ce choix élitiste au XVIIe siècle, avant de tenter de se corriger elle-même au fil des éditions.
Jules Ferry et son école sont également examinés. Bien que l'école républicaine ait sacralisé l'orthographe à travers la dictée, elle a aussi donné au peuple un savoir commun, un outil d'émancipation et de promotion sociale. L'orthographe est ainsi devenue un enjeu politique, un symbole d'égalité républicaine et un outil de distinction sociale. L'auteur revient sur le "parisianisme" de la norme, où la prononciation et la graphie de Paris ont été imposées au reste du pays, et sur le phonocentrisme (un son = une lettre), un principe de réforme qui s'est heurté à la nature de la langue française.
Bernard Cerquiglini soutient en effet que le français, un "créole" issu de l'hybridation du latin et des langues germaniques, ne peut avoir une orthographe purement phonétique. Son écriture est "grammaticale", car elle doit ajouter pour l'œil les informations que l'oreille ne fournit pas (marques du pluriel, genre, etc.). C'est pourquoi la réforme de l'orthographe est à la fois nécessaire (pour corriger les aberrations) et impossible (face à la résistance des usagers).
L'auteur revient sur la réforme de 1990, qu'il a lui-même pilotée, la qualifiant de "bricolage" du XXe siècle. Il regrette son manque d'audace et le fait qu'elle n'ait pas été entièrement appliquée. En conclusion, il plaide pour une réforme future qui ne serait pas basée sur le phonocentrisme, mais sur la reconnaissance des fonctions de l'orthographe (transcription, grammaire, désambiguïsation, et son rôle d'icône visuelle). Il termine en soulignant l'importance d'enseigner le français et la complexité de son orthographe à l'école.
Le livre identifie plusieurs "coupables", à la fois responsables et innocents de cette situation. Le premier accusé est la corporation des scribes du Moyen Âge qui ont latinisé et étymologisé la langue, rendant l'orthographe plus complexe. Cependant, ils ont aussi, de manière maladroite, compris que l'écrit nécessitait une forme visuelle distinctive pour gérer les nombreux homophones du français. Le deuxième coupable est l'Académie française, qui a scellé ce choix élitiste au XVIIe siècle, avant de tenter de se corriger elle-même au fil des éditions.
Jules Ferry et son école sont également examinés. Bien que l'école républicaine ait sacralisé l'orthographe à travers la dictée, elle a aussi donné au peuple un savoir commun, un outil d'émancipation et de promotion sociale. L'orthographe est ainsi devenue un enjeu politique, un symbole d'égalité républicaine et un outil de distinction sociale. L'auteur revient sur le "parisianisme" de la norme, où la prononciation et la graphie de Paris ont été imposées au reste du pays, et sur le phonocentrisme (un son = une lettre), un principe de réforme qui s'est heurté à la nature de la langue française.
Bernard Cerquiglini soutient en effet que le français, un "créole" issu de l'hybridation du latin et des langues germaniques, ne peut avoir une orthographe purement phonétique. Son écriture est "grammaticale", car elle doit ajouter pour l'œil les informations que l'oreille ne fournit pas (marques du pluriel, genre, etc.). C'est pourquoi la réforme de l'orthographe est à la fois nécessaire (pour corriger les aberrations) et impossible (face à la résistance des usagers).
L'auteur revient sur la réforme de 1990, qu'il a lui-même pilotée, la qualifiant de "bricolage" du XXe siècle. Il regrette son manque d'audace et le fait qu'elle n'ait pas été entièrement appliquée. En conclusion, il plaide pour une réforme future qui ne serait pas basée sur le phonocentrisme, mais sur la reconnaissance des fonctions de l'orthographe (transcription, grammaire, désambiguïsation, et son rôle d'icône visuelle). Il termine en soulignant l'importance d'enseigner le français et la complexité de son orthographe à l'école.
Bibliographie