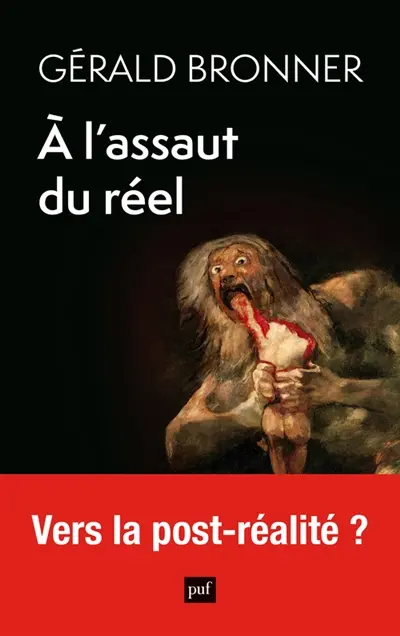Chargement...
Chargement...
Gérald Bronner - À l'assaut du réel
Une exploration passionnante du monde contemporain et de ses mécanismes de déréalisation.
Publié le 09/10/2025
Dans le cadre des conférences ECHO organisées par Cap Sciences, Gérald Bronner vous présente son ouvrage "À l'assaut du réel" aux PUF. Entretien avec Raphaël Dupin.
Dans son dernier ouvrage, "À l'assaut du réel", Gérald Bronner, sociologue éminent et spécialiste des croyances collectives, explore les mécanismes qui nous éloignent de la réalité. Pour lui, nous vivons dans un monde où la dérégulation de nos désirs est telle qu'elle menace notre rapport au réel. En guise d'introduction, l'auteur établit un lien surprenant entre les slogans situationnistes de Mai 68 ("Soyons réalistes, demandons l'impossible") et le désir individuel de plier la réalité à sa volonté.
Il pose ensuite la question de la nature humaine, nous désignant comme des "singes magiciens", l'une des rares espèces capables de percevoir un univers de possibles. Cette faculté, qui nous a permis de survivre, nous pousse aussi à créer des récits pour vaincre nos incertitudes, engendrant ainsi des comportements de déréalisation. La dérégulation de ce désir, selon lui, s'amorce dès l'éducation de l'enfant. Les valeurs traditionnelles comme l'obéissance s'effacent au profit de l'indépendance, voire de l'égoïsme, plaçant l'enfant au centre de l'univers familial et créant une génération peu habituée à la sanction du réel. Cette tendance se prolonge dans une quête obsessionnelle du "vrai moi" et du bonheur, nourrie par le développement personnel. En l'absence de mythes collectifs comme celui du progrès, l'individu se tourne vers une exploration de ses propres malheurs, accusant la toxicité de l'environnement d'entraver son épanouissement. Bronner met en lumière les stratégies que nous avons développées pour contourner ou amollir le réel.
Il explore des communautés qui s'isolent (Hikikomori) ou qui se réfugient dans la fiction (Shifters), choisissant des mondes alternatifs pour échapper à l'incertitude. L'auteur analyse également comment les flux virtuels et réels se mélangent, notamment avec l'intelligence artificielle qui brouille les frontières entre le vrai et le faux. Il évoque le "Kefabe", un concept issu du monde du catch, pour expliquer l'acceptation collective des déclarations de personnalités comme Donald Trump, où l'on sait que le propos est faux, mais où on le tolère parce qu'il sert un récit perçu comme plus vrai. Le faux a un "avantage concurrentiel" sur le vrai, car il s'accorde plus facilement à nos intuitions et nos croyances. Enfin, l'auteur aborde la ductilisation du réel, c'est-à-dire sa malléabilité. Il prend l'exemple des Terriens, des individus qui revendiquent une identité animale, pour montrer comment le ressenti peut supplanter les catégories biologiques. Cette tendance se retrouve à une échelle plus large, comme dans l'autodiagnostic de troubles psychiques via les réseaux sociaux, où l'individu cherche un récit disponible pour absorber son "anomalie" perçue.
L'entretien se termine sur une réflexion profonde sur le transhumanisme, une quête ultime pour Gérald Bronner d'échapper à notre condition biologique, illustrant à quel point l'être humain cherche sans cesse à donner un sens à son existence, même si le réel ne répond qu'avec des sanctions.
Il pose ensuite la question de la nature humaine, nous désignant comme des "singes magiciens", l'une des rares espèces capables de percevoir un univers de possibles. Cette faculté, qui nous a permis de survivre, nous pousse aussi à créer des récits pour vaincre nos incertitudes, engendrant ainsi des comportements de déréalisation. La dérégulation de ce désir, selon lui, s'amorce dès l'éducation de l'enfant. Les valeurs traditionnelles comme l'obéissance s'effacent au profit de l'indépendance, voire de l'égoïsme, plaçant l'enfant au centre de l'univers familial et créant une génération peu habituée à la sanction du réel. Cette tendance se prolonge dans une quête obsessionnelle du "vrai moi" et du bonheur, nourrie par le développement personnel. En l'absence de mythes collectifs comme celui du progrès, l'individu se tourne vers une exploration de ses propres malheurs, accusant la toxicité de l'environnement d'entraver son épanouissement. Bronner met en lumière les stratégies que nous avons développées pour contourner ou amollir le réel.
Il explore des communautés qui s'isolent (Hikikomori) ou qui se réfugient dans la fiction (Shifters), choisissant des mondes alternatifs pour échapper à l'incertitude. L'auteur analyse également comment les flux virtuels et réels se mélangent, notamment avec l'intelligence artificielle qui brouille les frontières entre le vrai et le faux. Il évoque le "Kefabe", un concept issu du monde du catch, pour expliquer l'acceptation collective des déclarations de personnalités comme Donald Trump, où l'on sait que le propos est faux, mais où on le tolère parce qu'il sert un récit perçu comme plus vrai. Le faux a un "avantage concurrentiel" sur le vrai, car il s'accorde plus facilement à nos intuitions et nos croyances. Enfin, l'auteur aborde la ductilisation du réel, c'est-à-dire sa malléabilité. Il prend l'exemple des Terriens, des individus qui revendiquent une identité animale, pour montrer comment le ressenti peut supplanter les catégories biologiques. Cette tendance se retrouve à une échelle plus large, comme dans l'autodiagnostic de troubles psychiques via les réseaux sociaux, où l'individu cherche un récit disponible pour absorber son "anomalie" perçue.
L'entretien se termine sur une réflexion profonde sur le transhumanisme, une quête ultime pour Gérald Bronner d'échapper à notre condition biologique, illustrant à quel point l'être humain cherche sans cesse à donner un sens à son existence, même si le réel ne répond qu'avec des sanctions.
Bibliographie