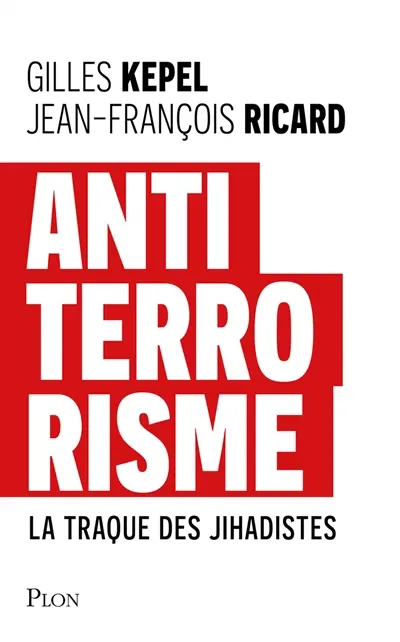Chargement...
Chargement...
Gilles Kepel et Jean-François Ricard - Antiterrorisme : la traque des jihadistes
Antiterrorisme : la traque des jihadistes, une alliance inédite.
Publié le 03/11/2025
Gilles Kepel et Jean-François Ricard vous présentent leur ouvrage "Antiterrorisme : la traque des jihadistes" aux éditions Plon. Entretien avec Jean Petaux.
Gilles Kepel, spécialiste du jihadisme, et Jean-François Ricard, haut magistrat antiterroriste, mettent en perspective leurs domaines de compétence respectifs pour analyser l'évolution du terrorisme jihadiste depuis les années 1980. L'ouvrage confronte l'analyse des mouvements islamistes à la gestion judiciaire des infractions terroristes. L'entretien définit d'abord le terme « jihadisme », dont l'usage contemporain est recontextualisé, avec une origine datée au 6 octobre 1981 (assassinat de Sadate).
La discussion aborde ensuite la façon dont le phénomène a nécessité une adaptation du droit français, rappelant que le terrorisme était initialement traité comme du droit commun avant la loi de 1986. L'irruption du GIA en France (1993-1995) et la campagne d'attentats qui en découle illustrent la complexité des enquêtes judiciaires (dossiers de l'attentat de Saint-Michel).
Les auteurs décrivent ensuite le passage à la structure d'Al-Qaïda post-11-Septembre, caractérisée par un fonctionnement en « rhizome » ou en système, s'opposant au modèle organisationnel classique. Cette période a servi de phase de recrutement et de développement en France. Enfin, l'analyse se porte sur Daesh (État islamique), ses attentats (2015, etc.) et le phénomène de l'allégeance. Jean-François Ricard présente la création du Parquet National Antiterroriste (PNAT), détaillant son rôle dans la spécialisation des magistrats et l'intégration de la chaîne de la lutte antiterroriste, du renseignement à l'exécution de la peine.
La discussion aborde ensuite la façon dont le phénomène a nécessité une adaptation du droit français, rappelant que le terrorisme était initialement traité comme du droit commun avant la loi de 1986. L'irruption du GIA en France (1993-1995) et la campagne d'attentats qui en découle illustrent la complexité des enquêtes judiciaires (dossiers de l'attentat de Saint-Michel).
Les auteurs décrivent ensuite le passage à la structure d'Al-Qaïda post-11-Septembre, caractérisée par un fonctionnement en « rhizome » ou en système, s'opposant au modèle organisationnel classique. Cette période a servi de phase de recrutement et de développement en France. Enfin, l'analyse se porte sur Daesh (État islamique), ses attentats (2015, etc.) et le phénomène de l'allégeance. Jean-François Ricard présente la création du Parquet National Antiterroriste (PNAT), détaillant son rôle dans la spécialisation des magistrats et l'intégration de la chaîne de la lutte antiterroriste, du renseignement à l'exécution de la peine.
Bibliographie