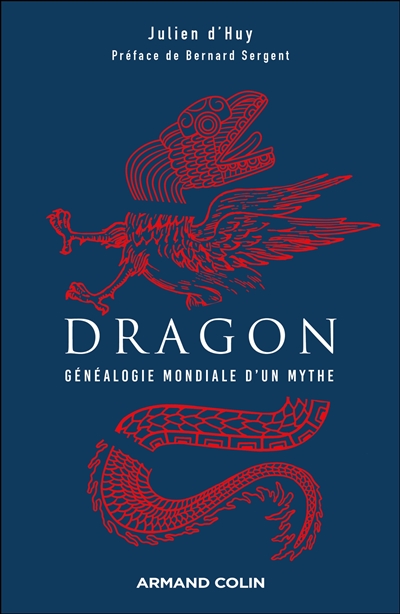Chargement...
Chargement...
Julien d'Huy - Dragon : généalogie mondiale d'un mythe
Les origines fascinantes du dragon : une enquête aux confins de la mythologie et de la science.
Publié le 22/09/2025
Julien d'Huy vous présente son ouvrage "Dragon : généalogie mondiale d'un mythe" paru le 28 août 2025 aux éditions Armand Colin. Entretien avec Pierre Coutelle. Rentrée sciences humaines automne 2025.
Le dragon, figure emblématique de l'imaginaire mondial, ne se résume pas à une créature légendaire figée dans le temps. Julien D'huy, en utilisant une approche scientifique novatrice, propose une véritable "généalogie" de ce mythe millénaire. Loin des spéculations hasardeuses, l'auteur démontre que les récits de dragons, malgré leurs innombrables variations, partagent une histoire commune et une origine profondément ancrée dans l'histoire des migrations humaines.
Le dragon, sous ses multiples formes (ailé ou non, cracheur de feu ou aquatique), est avant tout lié au serpent. Cette connexion est si forte qu'elle se retrouve dans l'étymologie même du mot "dracon". L'auteur explique comment des récits primaires, racontant la transformation d'un petit serpent en une créature gigantesque et dangereuse, ont voyagé avec les premières vagues d'Homo Sapiens hors d'Afrique. Ces histoires, loin d'être le fruit du hasard ou de l'archétype jungien, se sont transmises et adaptées aux nouveaux environnements. Par exemple, le serpent originel a pu être remplacé par un ver dans les régions plus froides où les serpents sont moins présents, tout en conservant la structure narrative.
Pour retracer cette évolution, Julien D'huy a développé une méthode "phylogénétique" appliquée aux mythes. Similaire à l'étude des arbres généalogiques des espèces, cette approche compare les versions d'un même mythe à l'aide d'algorithmes. En analysant les similitudes et les différences, il est possible de reconstituer les liens de parenté entre les récits et de remonter jusqu'à leur forme la plus ancienne. Ce travail d'une minutie extrême a permis de mettre en évidence deux grandes branches mythologiques distinctes : l'une suivant les premières migrations vers l'Australie et l'Amérique du Sud, et l'autre, plus tardive, se développant en Eurasie et en Amérique du Nord. C'est de cette seconde branche que sont issus des motifs bien connus comme le combat entre le héros et le dragon.
L'analyse de l'auteur révèle également que le mythe du dragon sert à donner du sens au monde, en interprétant les phénomènes naturels tels que les tremblements de terre ou les éclairs. Le dragon n'est pas une créature qui existe pour elle-même, mais une construction culturelle qui prend appui sur nos peurs et nos perceptions biologiques pour s'auto-alimenter. Le mythe se nourrit de notre attention, et en retour, il influence notre façon de voir le monde, créant une boucle où la culture et la biologie se renforcent mutuellement. En fin de compte, le dragon nous dit plus sur nous-mêmes, sur l'histoire de l'humanité et la puissance de nos récits que sur une quelconque réalité zoologique.
Le dragon, sous ses multiples formes (ailé ou non, cracheur de feu ou aquatique), est avant tout lié au serpent. Cette connexion est si forte qu'elle se retrouve dans l'étymologie même du mot "dracon". L'auteur explique comment des récits primaires, racontant la transformation d'un petit serpent en une créature gigantesque et dangereuse, ont voyagé avec les premières vagues d'Homo Sapiens hors d'Afrique. Ces histoires, loin d'être le fruit du hasard ou de l'archétype jungien, se sont transmises et adaptées aux nouveaux environnements. Par exemple, le serpent originel a pu être remplacé par un ver dans les régions plus froides où les serpents sont moins présents, tout en conservant la structure narrative.
Pour retracer cette évolution, Julien D'huy a développé une méthode "phylogénétique" appliquée aux mythes. Similaire à l'étude des arbres généalogiques des espèces, cette approche compare les versions d'un même mythe à l'aide d'algorithmes. En analysant les similitudes et les différences, il est possible de reconstituer les liens de parenté entre les récits et de remonter jusqu'à leur forme la plus ancienne. Ce travail d'une minutie extrême a permis de mettre en évidence deux grandes branches mythologiques distinctes : l'une suivant les premières migrations vers l'Australie et l'Amérique du Sud, et l'autre, plus tardive, se développant en Eurasie et en Amérique du Nord. C'est de cette seconde branche que sont issus des motifs bien connus comme le combat entre le héros et le dragon.
L'analyse de l'auteur révèle également que le mythe du dragon sert à donner du sens au monde, en interprétant les phénomènes naturels tels que les tremblements de terre ou les éclairs. Le dragon n'est pas une créature qui existe pour elle-même, mais une construction culturelle qui prend appui sur nos peurs et nos perceptions biologiques pour s'auto-alimenter. Le mythe se nourrit de notre attention, et en retour, il influence notre façon de voir le monde, créant une boucle où la culture et la biologie se renforcent mutuellement. En fin de compte, le dragon nous dit plus sur nous-mêmes, sur l'histoire de l'humanité et la puissance de nos récits que sur une quelconque réalité zoologique.
Bibliographie
Pour en savoir plus
Julien d'Huy - L'aube des mythes
À l'occasion de la 26ème édition des "Rendez-vous de l'Histoire" à Blois, Julien d'Huy vous prése...
Julien d'Huy - Dragon : généalogie mondiale d'un mythe
Les origines fascinantes du dragon : une enquête aux confins de la mythologie et de la science.
Julien d'Huy vous présente son ouvrage "Dragon : généalogie mondiale d'un mythe" paru le 28 août ...