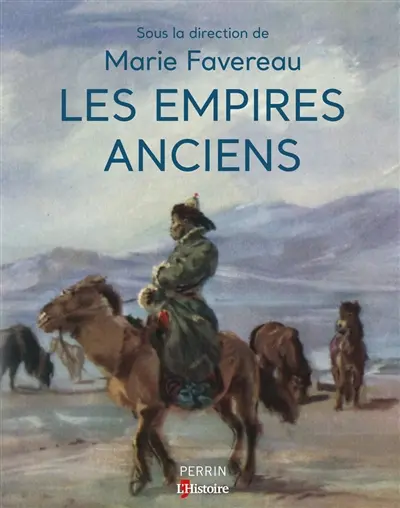Chargement...
Chargement...
Marie Favereau - Les empires anciens
Au-delà de la guerre et des armées : une nouvelle approche de la diversité et de la complexité des empires prémodernes.
Publié le 24/11/2025
À l'occasion de l'édition 2025 des "Rendez-vous de l'histoire" qui se sont déroulés à Blois, Marie Favereau vous présente son ouvrage "Les empires anciens" aux éditions Perrin.
Marie Favereau, spécialiste de l'Empire Mongol, coordonne cet ouvrage collectif qui réunit une vingtaine d'auteurs (archéologues, historiens d'art, historiens des textes). L'ambition de ce livre est d'étudier les empires anciens, principalement antérieurs au XVIe siècle, afin de montrer la panoplie et la sophistication de ces formats politiques souvent méconnus du grand public (Sassanides, Achéménides, Omeyyades, etc.).
L'ouvrage propose de regarder l'empire autrement que sous le seul prisme de la conquête et de l'armée. Les chercheurs mettent en lumière des constructions sophistiquées, lieux de débats politiques et de négociations collectives, mais aussi des centres de production, d'innovation artistique et de commerce.
L'accent est mis sur les connexions : l'empire est présenté comme un espace ouvert sur le monde, inscrit dans des rapports de force avec d'autres États. Pour concrétiser cette approche, l'ouvrage s'appuie sur des objets, des cartes et des chronologies. Marie Favereau souligne la difficulté à définir simplement l'empire, un terme hérité du monde romain. Elle met en avant plusieurs points communs entre ces constructions politiques :L'ampleur de l'organisation politique, bien supérieure à celle d'un royaume ou d'une chefferie. Le pluralisme (religieux, linguistique, culturel) et la manière dont il s'organise et se négocie.Le rapport central au commerce et les relations économiques, qui peuvent être une forme d'expansionnisme. La question de la ville et de la capitale, avec des cas d'empires nomades sans ville. La manière dont l'élite négocie son identité avec la pluralité de ses sujets, notamment à travers le système des impôts et de la taxation, qui doit être accepté par les populations. La négociation du multireligieux et des cultes, un point commun à tous ces empires prémodernes. La manière dont l'empire se raconte artistiquement, valorisée par une riche iconographie.
Enfin, l'ouvrage aborde la question du déclin et de la fin de l'empire, un thème complexe où les historiens s'accordent rarement sur la brutalité de l'effondrement. L'autrice privilégie la notion de métamorphose et de fragmentation, comme ce fut le cas pour l'Empire Mongol, qui a mené à de nouvelles organisations politiques sans être nécessairement un récit de chute. L'ouvrage met ainsi en avant les éléments de continuité et les héritages qui circulent d'un empire à l'autre.
L'ouvrage propose de regarder l'empire autrement que sous le seul prisme de la conquête et de l'armée. Les chercheurs mettent en lumière des constructions sophistiquées, lieux de débats politiques et de négociations collectives, mais aussi des centres de production, d'innovation artistique et de commerce.
L'accent est mis sur les connexions : l'empire est présenté comme un espace ouvert sur le monde, inscrit dans des rapports de force avec d'autres États. Pour concrétiser cette approche, l'ouvrage s'appuie sur des objets, des cartes et des chronologies. Marie Favereau souligne la difficulté à définir simplement l'empire, un terme hérité du monde romain. Elle met en avant plusieurs points communs entre ces constructions politiques :L'ampleur de l'organisation politique, bien supérieure à celle d'un royaume ou d'une chefferie. Le pluralisme (religieux, linguistique, culturel) et la manière dont il s'organise et se négocie.Le rapport central au commerce et les relations économiques, qui peuvent être une forme d'expansionnisme. La question de la ville et de la capitale, avec des cas d'empires nomades sans ville. La manière dont l'élite négocie son identité avec la pluralité de ses sujets, notamment à travers le système des impôts et de la taxation, qui doit être accepté par les populations. La négociation du multireligieux et des cultes, un point commun à tous ces empires prémodernes. La manière dont l'empire se raconte artistiquement, valorisée par une riche iconographie.
Enfin, l'ouvrage aborde la question du déclin et de la fin de l'empire, un thème complexe où les historiens s'accordent rarement sur la brutalité de l'effondrement. L'autrice privilégie la notion de métamorphose et de fragmentation, comme ce fut le cas pour l'Empire Mongol, qui a mené à de nouvelles organisations politiques sans être nécessairement un récit de chute. L'ouvrage met ainsi en avant les éléments de continuité et les héritages qui circulent d'un empire à l'autre.
Bibliographie