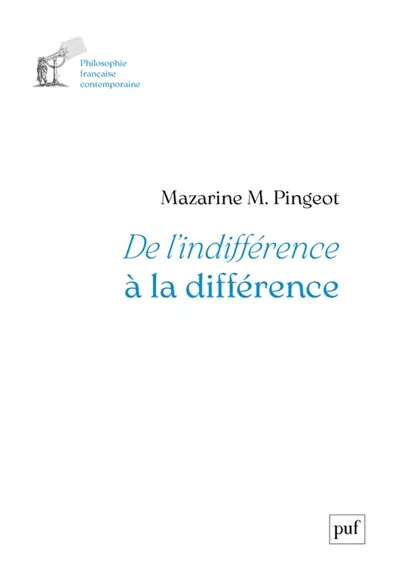Chargement...
Chargement...
Mazarine M. Pingeot - De l'indifférence à la différence
"Le grand danger n'est pas le mensonge, mais l'indifférence au vrai."
Publié le 07/10/2025
Mazarine M. Pingeot vous présente son ouvrage "De l'indifférence à la différence" aux éditions PUF. Entretien avec Pierre Coutelle.
Dans cet entretien, Mazarine M. Pingeot met en lumière une crise profonde de notre époque, qu'elle qualifie d'"indifférence". Pour la philosophe, cette indifférence ne se résume pas à un simple affect ; elle révèle une "indifférenciation structurelle" qui affecte aussi bien la pensée, le social, que le politique.
En se basant sur une relecture historique de la philosophie, elle identifie cette crise chez des penseurs comme Descartes, Kant et Husserl, qui, à des époques différentes, ont déjà constaté que la philosophie se désintéresse des questions fondamentales au profit d'une science florissante. L'autrice établit une corrélation forte entre l'affect d'indifférence et la structure d'indifférenciation de la crise. Elle montre que cette dissolution des distinctions se manifeste à plusieurs niveaux :
Indifférenciation des espaces : Le brouillage entre les sphères privée et publique, exacerbé par les réseaux sociaux, menace l'espace politique tel que l'entendait Hannah Arendt. Lorsque l'espace public est contrôlé par des entreprises privées et que l'intime est exposé, les fondements de la démocratie sont fragilisés.
Indifférenciation des temps : Suivant les travaux de François Hartog, elle pointe une "extension infinie du présent" qui dilue l'avenir et rend l'imagination politique presque impossible.Sans une distinction claire entre passé, présent et futur, la société est incapable de se projeter ou de tirer des leçons de l'histoire.
Indifférenciation du vrai et du faux : Le phénomène de la "post-vérité" est moins un mensonge assumé qu'une indifférence générale à l'égard de la vérité. Peu importe la réalité des faits, ce qui compte, c'est ce qui est "en réseau" et qui correspond à une vision du monde. Le problème n'est pas le mensonge, mais l'acceptation qu'il existe des "faits alternatifs", rendant le dialogue et la pensée impossible.
Mazarine M. Pingeot soutient que cette crise philosophique n'est pas uniquement un phénomène extérieur. Elle résulte, de manière paradoxale, de la volonté de la philosophie elle-même de se défaire du dualisme et de la transcendance. Le passage de l'idée "il n'y a pas d'autre monde" à celle "il n'y a que du monde" a enfermé la pensée dans une immanence qui nie la possibilité d'une altérité. Or, pour l'autrice, c'est précisément la reconnaissance d'une altérité "inappropriable" qui peut fonder notre dignité humaine, notre liberté et notre égalité.
Si l'égalité ne peut être fondée sur nos qualités tangibles (nos "différences hiérarchisables"), elle ne peut l'être que sur un principe extérieur à toute mesure, un "incommensurable" : la dignité. Cette altérité permet de penser la différence sans la transformer en hiérarchie.
C'est l'inaccessibilité de l'autre qui nous rend responsable de lui.
En conclusion, l'ouvrage de Mazarine M. Pingeot invite à réhabiliter la distinction, non pas pour enfermer la pensée dans des dualismes, mais pour préserver les fondements d'une penséeéthique et d'une politique progressiste. En faisant l'économie de la question de l'altérité, les discours contemporains se privent des outils nécessaires pour aborder les crises sociales et écologiques.
En se basant sur une relecture historique de la philosophie, elle identifie cette crise chez des penseurs comme Descartes, Kant et Husserl, qui, à des époques différentes, ont déjà constaté que la philosophie se désintéresse des questions fondamentales au profit d'une science florissante. L'autrice établit une corrélation forte entre l'affect d'indifférence et la structure d'indifférenciation de la crise. Elle montre que cette dissolution des distinctions se manifeste à plusieurs niveaux :
Indifférenciation des espaces : Le brouillage entre les sphères privée et publique, exacerbé par les réseaux sociaux, menace l'espace politique tel que l'entendait Hannah Arendt. Lorsque l'espace public est contrôlé par des entreprises privées et que l'intime est exposé, les fondements de la démocratie sont fragilisés.
Indifférenciation des temps : Suivant les travaux de François Hartog, elle pointe une "extension infinie du présent" qui dilue l'avenir et rend l'imagination politique presque impossible.Sans une distinction claire entre passé, présent et futur, la société est incapable de se projeter ou de tirer des leçons de l'histoire.
Indifférenciation du vrai et du faux : Le phénomène de la "post-vérité" est moins un mensonge assumé qu'une indifférence générale à l'égard de la vérité. Peu importe la réalité des faits, ce qui compte, c'est ce qui est "en réseau" et qui correspond à une vision du monde. Le problème n'est pas le mensonge, mais l'acceptation qu'il existe des "faits alternatifs", rendant le dialogue et la pensée impossible.
Mazarine M. Pingeot soutient que cette crise philosophique n'est pas uniquement un phénomène extérieur. Elle résulte, de manière paradoxale, de la volonté de la philosophie elle-même de se défaire du dualisme et de la transcendance. Le passage de l'idée "il n'y a pas d'autre monde" à celle "il n'y a que du monde" a enfermé la pensée dans une immanence qui nie la possibilité d'une altérité. Or, pour l'autrice, c'est précisément la reconnaissance d'une altérité "inappropriable" qui peut fonder notre dignité humaine, notre liberté et notre égalité.
Si l'égalité ne peut être fondée sur nos qualités tangibles (nos "différences hiérarchisables"), elle ne peut l'être que sur un principe extérieur à toute mesure, un "incommensurable" : la dignité. Cette altérité permet de penser la différence sans la transformer en hiérarchie.
C'est l'inaccessibilité de l'autre qui nous rend responsable de lui.
En conclusion, l'ouvrage de Mazarine M. Pingeot invite à réhabiliter la distinction, non pas pour enfermer la pensée dans des dualismes, mais pour préserver les fondements d'une penséeéthique et d'une politique progressiste. En faisant l'économie de la question de l'altérité, les discours contemporains se privent des outils nécessaires pour aborder les crises sociales et écologiques.
Bibliographie