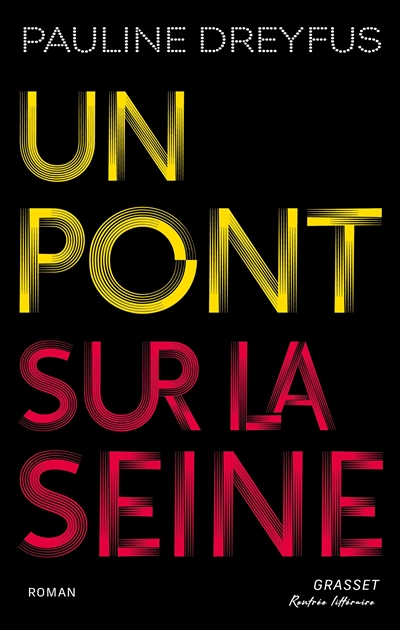Chargement...
Chargement...
Pauline Dreyfus - Un pont sur la Seine
L'histoire de France du XXe siècle se révèle à travers l'évolution de deux rives opposées.
Publié le 19/11/2025
Pauline Dreyfus vous présente son ouvrage "Un pont sur la Seine" aux éditions Grasset. Rentrée littéraire automne 2025.
Le roman de Pauline Dreyfus, "Un pont sur la Seine", puise son origine dans une observation fortuite : la découverte d'un contraste saisissant entre deux villages voisins, séparés par un simple pont mais que l'histoire a profondément éloignés. D'un côté, une rive prospère, associée aux résidences secondaires et au charme bucolique ; de l'autre, une ville sinistrée par la fermeture de son usine, témoignant des mutations économiques et sociales. Cette dualité inspire l'auteure à faire de ce pont le personnage principal muet du récit, un arbitre ou un témoin des évolutions de la France sur plus d'un siècle.
L'ouvrage ambitionne de retracer l'histoire du XXe siècle "à hauteur d'homme", illustrant le passage d'un pays principalement rural et viticole à une nation industrielle (dès 1903, avec l'installation d'une usine) puis, à partir des années 1980, à une économie dominée par le secteur tertiaire et le patrimoine. L'auteure dénonce ici la "muséification de la vie" lorsque l'activité économique a disparu.
Le récit se construit autour de l'histoire de deux frères jumeaux, issus d'une famille de riches viticulteurs. L'un, Lucien, choisit de rester fidèle au travail de la vigne, soumis aux aléas des saisons et du ciel. L'autre, Georges, embrasse la modernité et la sécurité de l'emploi qu'offre la nouvelle usine construite sur l'autre rive. Cette usine, l'entreprise Schneider, pratique le paternalisme, offrant à ses ouvriers un cadre de vie privilégié et des infrastructures modernes (eau courante, électricité, cinéma, vélodrome) bien avant les autres. Pour Georges, ce choix est synonyme de promotion sociale et le conduit à mépriser les "désarriérés" de la rive gauche.
Le fossé entre les deux frères et les deux rives se creuse dramatiquement avec la Première Guerre mondiale. Georges, l'ouvrier d'usine, est rappelé du front trois mois après le début du conflit pour participer à l'effort de guerre (production de chars et d'obus), lui permettant de survivre. Inversement, Lucien, le viticulteur, périt au front. Ce drame est à l'origine d'une haine tenace entre les deux branches de la famille, la veuve de Lucien nourrissant le désir de se venger de son beau-frère.
Pauline Dreyfus insiste sur le fait que son œuvre est une pure fiction. Il s'agit d'un roman d'imagination, délibérément à l'écart du récit autobiographique ou de la quête mémorielle souvent présents en littérature contemporaine. Elle explore ainsi, par l'entremise d'une histoire familiale et d'un lieu symbolique, les grandes forces historiques qui ont façonné la France moderne.
L'ouvrage ambitionne de retracer l'histoire du XXe siècle "à hauteur d'homme", illustrant le passage d'un pays principalement rural et viticole à une nation industrielle (dès 1903, avec l'installation d'une usine) puis, à partir des années 1980, à une économie dominée par le secteur tertiaire et le patrimoine. L'auteure dénonce ici la "muséification de la vie" lorsque l'activité économique a disparu.
Le récit se construit autour de l'histoire de deux frères jumeaux, issus d'une famille de riches viticulteurs. L'un, Lucien, choisit de rester fidèle au travail de la vigne, soumis aux aléas des saisons et du ciel. L'autre, Georges, embrasse la modernité et la sécurité de l'emploi qu'offre la nouvelle usine construite sur l'autre rive. Cette usine, l'entreprise Schneider, pratique le paternalisme, offrant à ses ouvriers un cadre de vie privilégié et des infrastructures modernes (eau courante, électricité, cinéma, vélodrome) bien avant les autres. Pour Georges, ce choix est synonyme de promotion sociale et le conduit à mépriser les "désarriérés" de la rive gauche.
Le fossé entre les deux frères et les deux rives se creuse dramatiquement avec la Première Guerre mondiale. Georges, l'ouvrier d'usine, est rappelé du front trois mois après le début du conflit pour participer à l'effort de guerre (production de chars et d'obus), lui permettant de survivre. Inversement, Lucien, le viticulteur, périt au front. Ce drame est à l'origine d'une haine tenace entre les deux branches de la famille, la veuve de Lucien nourrissant le désir de se venger de son beau-frère.
Pauline Dreyfus insiste sur le fait que son œuvre est une pure fiction. Il s'agit d'un roman d'imagination, délibérément à l'écart du récit autobiographique ou de la quête mémorielle souvent présents en littérature contemporaine. Elle explore ainsi, par l'entremise d'une histoire familiale et d'un lieu symbolique, les grandes forces historiques qui ont façonné la France moderne.
Bibliographie