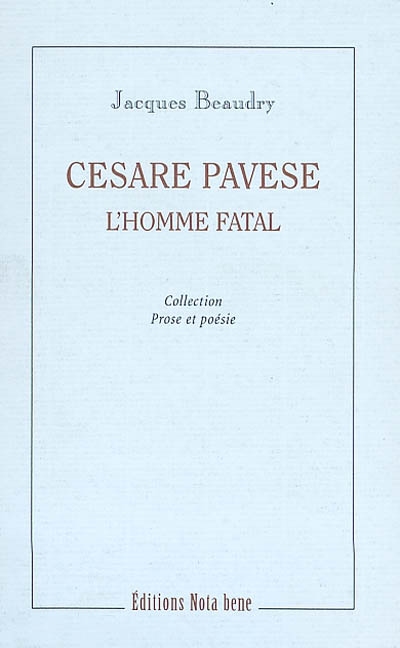Elle patientera jusqu'au 27 août 1950. Ce jour-là, Cesare Pavese décide de quitter la scène plutôt que d'y jouer un rôle qui lui était de plus en plus étranger. Alors qu'il vient d'achever la rédaction de son recueil poétique, au titre doucement prémonitoire, Quand la mort viendra, elle aura tes yeux, il met fin à ses jours en avalant une dose massive de somnifères dans une chambre d'hôtel à Turin. Plus d'un demi-siècle après sa mort, son ultime geste continue de jeter une ombre sur son œuvre, d'oblitérer sa lecture critique et de fixer son image comme un cliché : celui du poète inapte à la vie, infirme psychologiquement, indifférent à toute reconnaissance. La course aux identifications ne fait que commencer. Comment expliquer un tel geste alors que le poète est au faîte de sa célébrité ? Comment appréhender ces propos malicieusement dégoutés : « Jamais je ne pourrai m'arrêter sur une position stable, sur ce qu'on appelle la réussite dans la vie » ? Comment encore le suivre dans cette autodétestation pleinement assumée lorsqu'il se voit, déjà en 1927, « incapable, timide, paresseux, incertain, faible, à moitié fou » ? Face à l'incompréhensible, il est érigé en poète-martyr et condamné presque malgré lui au châtiment de l'immortalité.
Or, il faut lire ou relire ses écrits pour comprendre que Cesare Pavese ne peut être réduit uniquement à un « chantre de la mort, à un héraut du désespoir ». Son œuvre n'est pas écrite à l'encre noire ; elle témoigne de sa ferveur et de son enthousiasme. On oublie trop souvent qu'il était un bourreau de travail, un homme d'action et de convictions. Après ses études dans un collège de jésuites à Turin, il entre à l'université où il étudie la littérature américaine. Il y soutient une thèse sur Walt Whitman et se passionne pour l'usage du vers libre. Il tente d'obtenir une bourse d'études à Columbia University, puis se met à enseigner dans des écoles de province. Parallèlement, il traduit pléthores d'écrivains, des monuments de la littérature américaine injustement méconnus, Melville, Faulkner, Dos Passos, Gertrude Stein, Defoe, Dickens, Joyce. Autant d'occasions d'accumuler une expérience critique qui se manifeste, à partir de 1930, par sa collaboration à la revue Cultura, pour laquelle il rédige des articles qui seront réunis en un volume après sa mort en 1951, sous le titre : La littérature américaine et autres essais. C'est durant cette période qu'il compose son premier recueil de poèmes Travailler fatigue : « le jeune Pavese…se raconte en une sorte d'autobiographie stylisée, bien que, comme tous les écrivains de son âge, il pense avant tout innover techniquement, faire œuvre de théoricien » (Dominique Fernandez). Il écrit, quelques années plus tard, le curieux Salut Masino (1928-29), somme de récits et de poèmes, qui témoigne déjà de sa recherche perpétuelle de formes et de structures.
En 1932, Pavese adhère au Parti National fasciste. Arrêté en 1935, il est condamné à résidence surveillée durant huit mois à Bracaleone, en Calabre. Il commence la rédaction de son journal, Le métier de vivre, sans doute le plus beau de tout le 20ème siècle, avec celui de Kafka bien sûr. Là encore, l'écriture est résistance, le seul lieu où les nostalgies de sa ville et des collines des Langhe se changent en constellations. A partir de 1938, Pavese travaille de façon régulière pour les éditions Einaudi et écrit des nouvelles, publiées après sa mort sous le titre Nuits de fête, et des romans Le bel été (1940) pour lequel il remporte le prestigieux prix Strega, Le Diable sur les collines, Entre femmes seules, « trois romans urbains, trois romans de découverte de la ville et de la société, trois romans d'enthousiasme juvénile et de passion déçue », selon les propres termes de l'auteur. En 1948, il fonde toujours dans la même maison d'édition la « Collection d'études religieuses, ethnologiques et psychologiques ».
Cesare Pavese aurait eu cent ans cette année. Que ces fièvres commémoratives puissent aider à redécouvrir son œuvre et à balayer les stéréotypes qui ont la vie dure. Si ses poèmes et romans demeurent troublants, c'est parce qu'ils ont gagné contre le néant et qu'ils ont su inscrire la nécessité d'une parole jusque dans les plis les plus inaccessibles de la signifiance. Ce poète, le plus discuté et le plus marquant de l'après-guerre, a entrevu une autre transcendance, dans l'argile même de l'écriture. D'ailleurs, ses plus grandes réussites formelles s'évanouiraient, s'il ne gisait pas au fond un entrain, une jeunesse qui nous éblouit. Oui, une éternelle jeunesse porte les mots de Cesare Pavese ; sa prose en a les vertus et le souffle. N'y voyons plus une mystique noire ou l'expression d'un nihilisme radical. L'écriture est du côté du cœur ; elle n'aurait d'autre profession de foi. Il suffit de se rappeler ses confidences pour s'en convaincre : « les paroles sont de tendres choses, intraitables et vivifiantes ». Qu'il repose tranquille. Ses mots sont auréolés d'un petit infini.
- Isabelle Bunisset