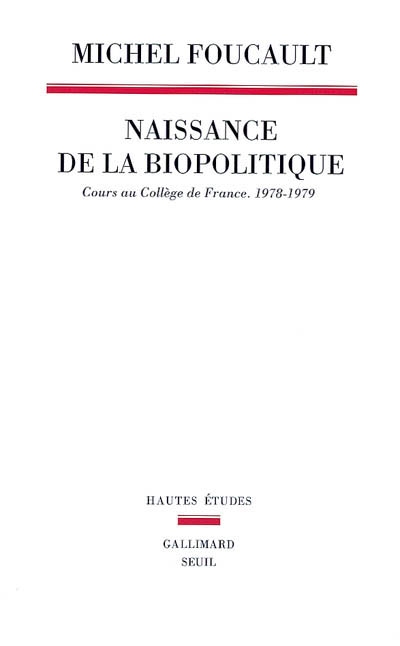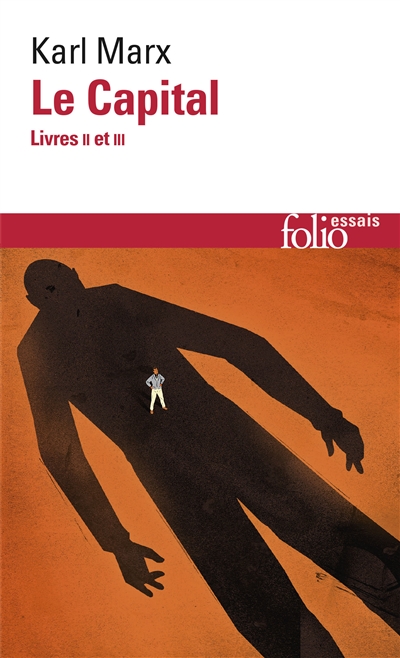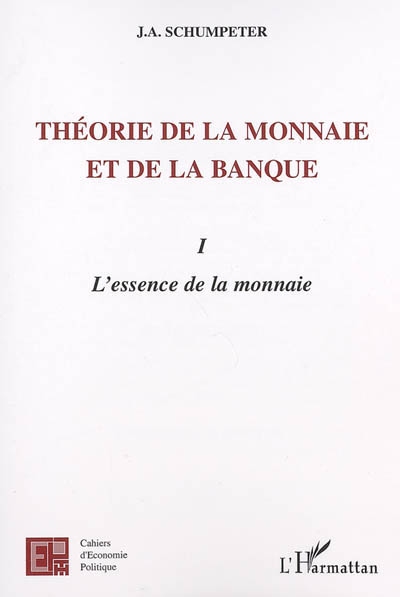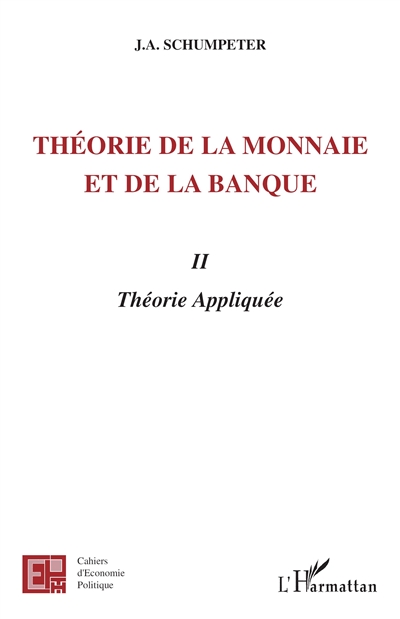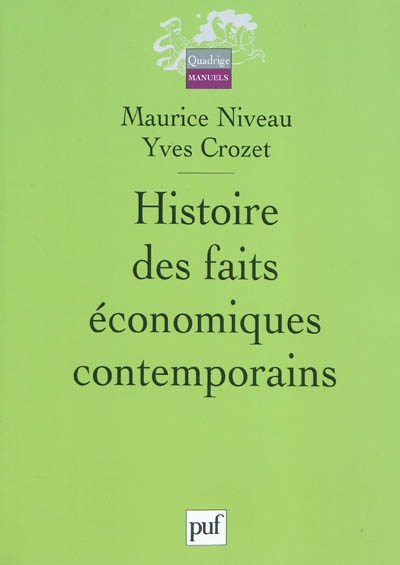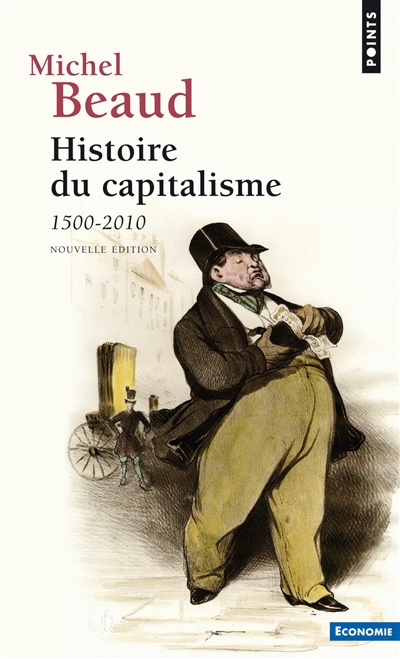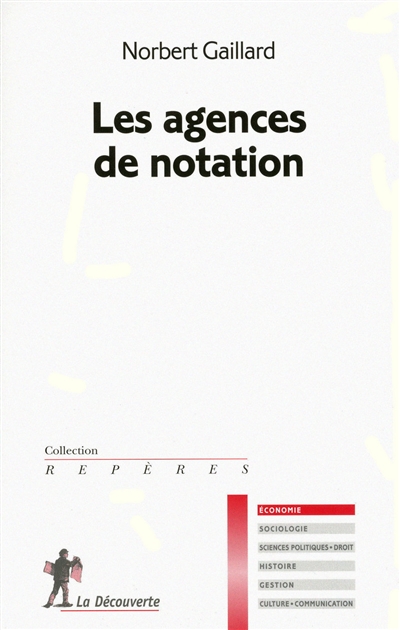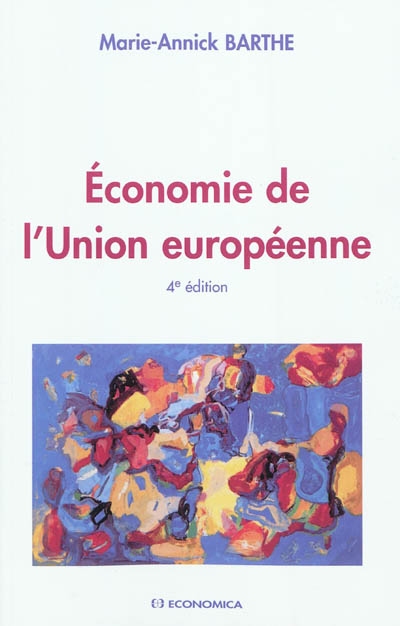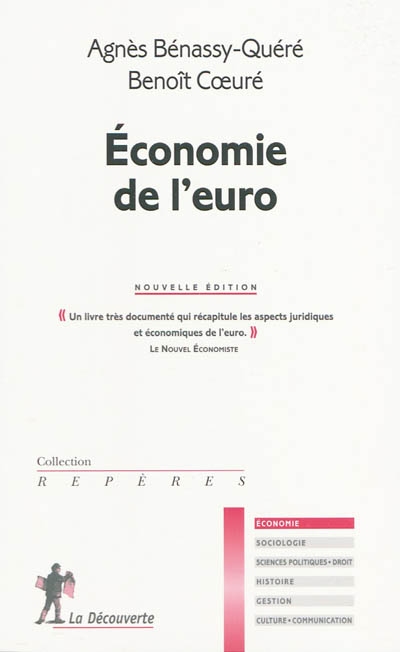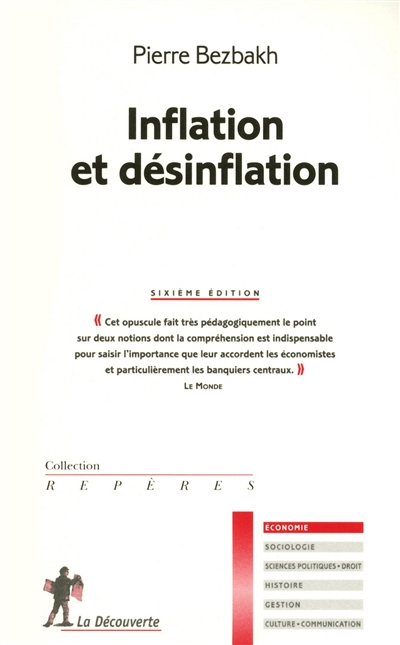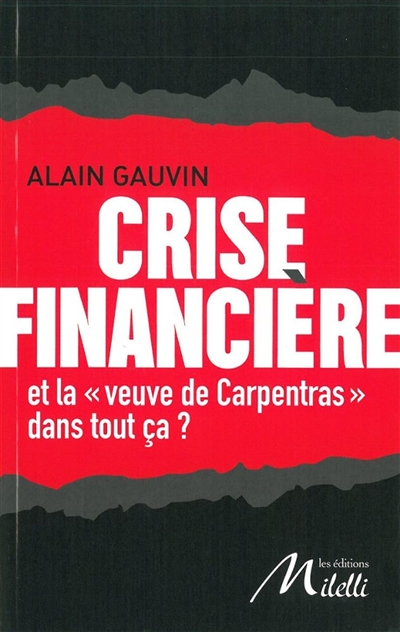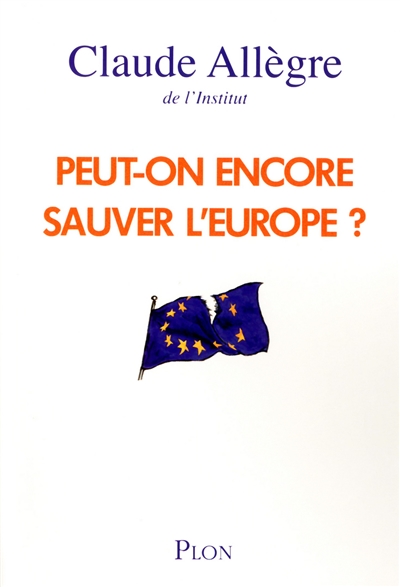Dès le départ, il y a une opposition sur la nature de l'organisation de l'Europe entre les Français et les Allemands : faut-il du volontarisme politique ou des règles générales avec sanctions automatiques? Dans le langage des économistes, cela est présenté comme l'alternative règles contre la politique discrétionnaire. La conception allemande dite de la « gouvernance européenne » veut instaurer un système de règles contraignantes dans un cadre de grande subsidiarité. Ces règles qui font partie aujourd'hui des débats publics sont bien connues. Règles de concurrence dite régulée, « libre et non faussée »; règles budgétaires de limitation des déficits et dettes des Etats avec sanctions automatiques; règles monétaires avec une banque centrale indépendante ne s'occupant que de la stabilité des prix. Son inspiration est l'Ordo-libéralisme, qui veut instaurer une « gouverne-mentalité » des institutions et des individus sur le modèle de l'entreprise. De l'autre côté, la conception française est désignée comme celle d'un « gouvernement économique » dans la tradition étatique et volontariste de la politique industrielle et de la recherche de la puissance.
... et verrouillage du politique ?
Ces deux conceptions sont largement antagonistes et révèlent deux projets bien différents. Le projet allemand est celui d'une constitutionnalisation de la politique économique, comme on le voit dans l'obligation d'inscrire dans les traités ou les constitutions des règles d'or de l'équilibre budgétaire. Ce que veut ce modèle Ordo-libéral, c'est la fin du politique, ou plus précisément la fin d'une alternative politique possible. En effet, quelque soit le résultat des élections, les élus doivent appliquer la politique qui est constitutionnalisée. Or, comme le disait le célèbre économiste autrichien Joseph Schumpeter, « la politique monétaire est politique » : dans toute politique, il y a des gagnants et des perdants, constitutionnaliser la politique, c'est verrouiller à l'avance les choix souverains des peuples et même des générations à venir, c'est la fin organisée de l'Histoire. On sait que la construction monétaire européenne s'est accélérée dans les années 1986-1992, avec la mise en place du grand marché européen et de la monnaie unique, moment aussi de la chute du Mur de Berlin et de l'unification allemande. Francis Fukuyama pouvait alors proclamer la « fin de l'Histoire » : le capitalisme avait vaincu ses rivaux historiques. Dans le même temps, les anciennes politiques keynésiennes des Trente glorieuses, la recherche du plein emploi dans le cadre de l'État social, soit ne marchaient plus dans le cadre de la mondialisation, soit étaient devenus inefficaces ou dangereuses selon les critiques monétaristes.
Cependant, on peut aussi interpréter la mise en place des nouvelles règles de gouvernance constitutionnalisée comme un dispositif visant à interdire la mise en place de politiques différentes. C'est le principe de la « pensée unique ». La politique de règles constitutionnalisées peut se comprendre comme la soumission aux impératifs des marchés financiers. C'est ce que montre la crainte de la perte du triple A ? Plus encore, la politique de règles, véritable oxymore, ne traduit-elle pas une sorte de fétichisme comme l'aurait dit Marx. Par exemple, le « fétichisme de l'intérêt ». Si on place de l'argent, il a effectivement le pouvoir de produire plus d'argent : l'argent produit de l'argent grâce à l'intérêt. Le fétiche a donc du pouvoir mais il masque ce qu'est la réalité sociale. L''intérêt est prélevé sur le fruit du travail. Idem pour les retraites par capitalisation, les taux d'inflation bas, l'équilibre budgétaire, la banque centrale indépendante…
Deuxième révélation : La difficulté d'une préférence collective européenne …
S'il faut des règles, bien qu'une politique essentiellement basée sur des règles soit une illusion fétichiste, comment alors rétablir le politique avec une conception du « gouvernement économique » ? Car, sinon, s'il s'agit de gérer selon des règles pourquoi ne pas choisir un système purement technocratique où l'on désignerait le plus compétent en économie et en finance ? La gouvernance des choses remplacerait le gouvernement des hommes. Mais la conception volontariste d'un gouvernement économique défendue par la France se heurte aussi à de sérieuses difficultés. Le volontarisme d'État, tel que nous le connaissons dans les épisodes historiques du colbertisme ou du gaullisme, se conçoit justement dans un cadre territorial où l'Etat exerce sa pleine souveraineté. Or dès que l'on passe au niveau européen, il y a plusieurs volontés souveraines en présence qui n'ont pas nécessairement les mêmes préférences, ni les mêmes objectifs. Peut-on dès lors faire émerger une préférence collective à partir des préférences de chacun ? L'idée un peu naïve qu'il suffirait de se mettre autour d'une table avec bonne volonté pour trouver des solutions agréables à chacun n'est pas crédible pour deux raisons au moins.
Première raison, l'approfondissement de la construction européenne a fait glisser le projet du Commun à l'Unique. C'est une radicalisation aux conséquences très importantes. Le commun c'est une coopération ou chacun peut réaliser avec d'autres ce qu'il ne peut faire seul. L'unique, c'est une radicalisation qualitative, puisque des champs de plus en plus étendus de la vie juridique, économique et sociale doivent être unifiés.
La deuxième a été énoncée au XVIIIème siècle par Condorcet et reformulée au XXème siècle par Kenneth Arrow et Amartya Sen : peut-on trouver une procédure, comme une règle de vote, qui fait émerger un choix collectif tout en respectant les préférences individuelles ? Ou, en d'autres termes, peut-on concilier l'efficacité de l'existence d'une décision et être libéral au sens anglo-saxon ? La réponse en général est négative, c'est ce que l'on appelle le théorème d'impossibilité, sauf la solution de la « dictature » ou la préférence d'un seul devient la préférence de tous . Transposé au niveau européen, cela peut signifier qu'un grand pays, comme l'Allemagne aujourd'hui, ou un groupe de grands pays qui s'entendent entre eux, peuvent imposer aux autres leurs choix. C'est pour cette raison que des garde-fous ont été mis en place dans les institutions européennes.
... qui débouche sur la difficile recherche du consensus
Depuis le début de ce que l'on appelle la crise grecque, en mi-juin 2010, on ne compte plus les sommets européens et mini sommets franco-allemand, réputés à chaque fois « de la dernière chance pour sauver l'euro »,qui débouchent sur des décisions longues à mettre en place et très vite dépassées par la rapidité des évolutions. Par exemple, le plan de sauvetage de la Grèce conclu le 21 juillet 2011 n'a finalement été ratifié qu'à la fin de l'automne par le parlement slovaque et après une seconde lecture. Ou de manière plus récente, la proposition Merkel-Sarkozy de nouveau traité européen. Deux économistes américains ont théorisé il y a une cinquantaine d'années le problème du « calcul du consensus » (1). Ils voient deux risques ou coûts. Pour le premier, chaque pays membre veut protéger ses intérêts fondamentaux, limiter les risques de la dépendance aux autres, et exiger que toute décision soit prise à l'unanimité. Mais celle-ci peut être source de blocages, de chantages. Aussi recherche-ton des majorités qualifiées qui protègent à la fois les « petits » pays en évitant que les gros puissent se coaliser(2).
Mais à côté de ces risques liés à la dépendance, il y aussi le coût en temps, en procédures, en marchandages pour atteindre un accord et a fortiori de le cas d'élaboration d'un nouveau traité. Le résultat est le plus souvent un compromis. Ce dernier est certes une vertu dans les relations humaines, mais en politique il risque de signifier une dépolitisation, voire l'accusation de compromission. Des partisans de la construction européenne, comme Jean-Louis Bourlanges, insistent d'ailleurs sur cet aspect de compromis tout en se défendant de l'accusation de compromission. En revanche, les adversaires du processus d'intégration insistent sur l'aspect compromission. Selon eux, alors qu'au niveau national règne le conflit politique, au niveau européen, les mêmes se retrouvent pour fonctionner par la recherche d'un compromis : la construction européenne a été largement le fruit d'une alliance politique implicite entre les socialistes et les démocrates-chrétiens.
Ainsi les deux alternatives, la gouvernance par des règles ou le gouvernement par le volontarisme politique, se heurtent à des limites propres. Les règles peuvent donner une direction, mais ne peuvent se suivre automatiquement quand le contexte change. Le volontarisme suppose un État-nation , mais l'Europe n'est pas un État-nation.
Troisième révélation : une Europe sans solidarité...
Un système communautaire doit fonctionner avec des règles, mais aussi de la coopération et de la solidarité entre ses membres. Or l'une des caractéristiques curieuses de la construction européenne est que l'exaltation dans les discours du projet européen se double concrètement d'une absence de solidarité. Tout dépend bien sûr du sens que l'on donne au mot solidarité. Si c'est celui d'Emile Durkheim, le résultat d'une interdépendance, il y a effectivement solidarité dans le sens où la situation économique d'un pays affecte nécessairement celle des autres. Mais si c'est celui de l'entraide mutuelle alors ce n'est pas le cas. On a pu ainsi définir la zone euro comme une coordination négative sans solidarité. La politique monétaire est centralisée au niveau de la BCE, tandis que la politique budgétaire passe par une coordination négative. La coordination signifie ici contrainte extérieure imposée à chacun. Chaque pays doit respecter les règles régissant les niveaux de déficits acceptables, le contenu de la politique budgétaire restant de la compétence exclusive des États. Cette absence de solidarité se manifeste par la faiblesse du budget européen, un peu plus de 1% du PIB européen, et par l'absence de co-responsabilité des dettes : les États européens ne répondent pas des dettes des autres. Ceci à première vue peut se justifier par ce que l'on désigne comme le principe de l' « aléa moral ». En effet, si un pays sait que, quoiqu'il arrive, ses engagements seront pris en charge par les autres, ceci peut le conduire à des comportements risqués. Le traité de Lisbonne n'exclut cependant pas le principe d'assistance entre États qui auraient des difficultés de balance des paiements (pour ceux qui ne sont pas membres de la zone euro). La crise grecque de mai-juin 2010 semble avoir fait basculer les esprits, avec l'acceptation par l'Allemagne du Fonds européen de stabilité financière (FESF). Mais c'est un fonds destiné à la stabilité et non pas à la solidarité. La stabilité qui est recherchée, l'est pour éviter la contagion des crises grecque, irlandaise et peut-être italienne, espagnole à l'ensemble de la zone euro, provoquant une crise systémique du système bancaire européen et un éclatement de la zone euro.
... qui débouche sur des cavaliers seuls
La crise grecque l'a encore montré : personne ne veut payer pour les autres. Les discours très accusatoires contre l'Allemagne, qui a déclenché en France la polémique sur la « germanophobie » a eu sa contre partie dans les propos méprisants vis-à-vis des pays du Sud, les pays du « Club Med » et autres « PIGS ». Au-delà de ces propos désagréables, la solidarité économique des nations européennes est limitée par les concurrences nationales. Les promoteurs du projet économique européen, celui du grand marché européen devant déboucher sur la monnaie unique, voyaient celui-ci avec les yeux d'Adam Smith. Chaque partie de l'Europe se spécialiserait pour les autres dans ce qu'elle a de meilleur ou de plus efficace et inversement la non-Europe représentait des « coûts » selon l'expression de Tommaso Paddoa-Schioppa. La réalité a été différente et les exemples ne manquent pas de rivalités ou de cavaliers seuls européens. La crise, la recherche de débouchés pour protéger l'emploi national exacerbe ces tendances. Ainsi on déplore la perte du marché suisse pour l'avion Rafale au profit d'un constructeur suédois pourtant membre du marché unique. L'Allemagne, pays principal européen, a restauré la situation de son commerce extérieur en accumulant les excédents grâce à une politique non coopérative de glaciation salariale interne. Récemment, au congrès du SPD, l'ancien chancelier Helmut Schmidt insistait sur le fait que les excédents allemands sont les déficits des autres, tout en dénonçant « l'arrogance » et le« chauvinisme allemand ». C'est justement sur l'exemple allemand que de nombreux commentateurs français s'appuient pour appeler à des politiques de rigueur. L'Allemagne ferait mieux que les autres car elle maîtrise bien ses finances publiques et ses coûts salariaux. Mais là aussi que nous révèle en réalité cette tendance ?
Quatrième révélation : une accusation qui se trompe de cible...
Depuis mai-juin 2010, les plans de rigueur se succèdent dans tous les pays européens : baisse des dépenses publiques, augmentation des impôts, diminution du nombre de fonctionnaires et, dans certains pays, baisse de leurs salaires, recul de l'âge de la retraite, etc. Chaque jour apporte son lot de nouveau plan et de nouvelles mesures. Cette politique part de constats : la dette publique est très élevée, les marchés financiers sont inquiets et n'acceptent de prêter qu'avec des taux d'intérêts de plus en plus élevés et les agences de notation menacent de dégrader les notes accentuant ainsi la défiance. Pour certains pays, la soutenabilité de la dette est en jeu, si les taux d'intérêt sont plus élevés que la croissance économique, pour d'autres, comme la Grèce, c'est déjà une situation d'insolvabilité. Ces constats alarmants fondent des politiques qui, de l'avis de nombreux observateurs, sont erronées et nocives.
Erronées car elles attribuent l'origine de la crise à la dette des États, alors que le creusement des dettes provient de la récession économique, elle-même provoquée par la financiarisation du capitalisme et ses dérèglements (voir la bulle immobilière). La dette publique « excessive » au regard des critères quantitatifs de Maastricht est la contrepartie des causes premières : sauvetage des banques, faiblesse des rentrées fiscales. Si les Etats appliquaient strictement leurs programmes de politiques restrictives l'effet dépressif serait encore plus grand.
... avec un détournement de la mémoire historique
Ceci n'est pas qu'une vue de l'esprit. Un spectre hante la zone euro, c'est celui des années 1930 et du Bloc-or ,où les politiques déflationnistes budgétaires ont enlisé les pays dans la dépression, comme en France entre 1932 et 1936. Plus particulièrement à partir de juin 1935 avec Pierre Laval dont on peut estimer que les politiques actuelles constituent la « revanche posthume » : il s'agissait comme aujourd'hui de rassurer les prêteurs de la France, de leur promettre que le franc ne serait plus jamais dévalué et que la sortie de crise passerait avant tout par le retour à l'équilibre budgétaire. On connaît la suite... mais pas nécessairement bien ce qui a précédé ! En effet il est courant d'entendre et de lire que l'Allemagne a une hantise de l'inflation. Et pour cette raison, elle veut cantonner la BCE au strict objectif de la stabilité monétaire et refuse les propositions françaises de changement de son statut qui l'autoriserait à acheter directement des titres de la dette publique. Or si cette hantise est partagée en Allemagne, elle n'en comporte pas moins des erreurs historiques. L'hyperinflation entre 1923 et 1924 est due avant tout à l'ampleur des réparations imposées au pays par le traité de Versailles et à l'occupation de la Ruhr en janvier 1923 par la France et la Belgique. En comparaison avec les taux d'inflation normaux, elle atteint des niveaux qui dépassent la simple accélération de l'inflation qui passerait de 2% à disons 4%. Il faut se représenter ce qu'a signifié l'hyperinflation. Si l'on prend l'indice des prix allemands base 100 en 1913 voici ce que cela donne au mois de décembre de chaque année :
1913 : 100
1921 : 3.490 (prix multipliés par 34, 9)
1922 : 147.480 ( prix multipliés par 42,25)
1923 : 126.160.000.000.000 (prix multipliés par 83 millions !)
Ces niveaux qui dépassent l'entendement ont touché bien d'autres pays au sortir des grandes guerres. Ils n'ont rien à voir avec une simple accélération de l'inflation. Mais ce n'est pas cela qui a conduit Hitler au pouvoir, c'est l'inverse, l'hyper-déflation menée par le chancelier Brüning à partir de décembre 1931 : baisse des salaires et des prix, refus de dévaluer. Résultat, chute de la production industrielle allemande de 40%, un chômage qui touche presque 50% de la population active salariée...On a pu dire que jamais une politique économique n'avait coûté aussi cher à l'humanité. Les partisans de la rigueur à tout prix devraient méditer cette expérience historique au lieu de s'alarmer de la montée des « populismes » : le sauvetage de la zone euro devra t-il se faire au prix de la ruine complète du bien être des populations ?
Cinquième révélation : vers un système européen post- démocratique …
Le philosophe allemand Jürgen Habermas a souligné l'effroi qui s'est emparé des élites européennes, politiques mais aussi journalistiques, lorsque le premier ministre grec Andreas Papandréou annoncé un référendum. Ce n'est pas un phénomène nouveau, la construction européenne s'est faite souvent en contournant les peuples, même si ceux qui l'ont réalisé avaient une légitimité politique issue des élections. Cependant depuis la campagne pour la ratification du traité de Maastricht en 1992, l'euroscepticisme gagne les populations européennes et le système européen essaie de le contourner. Ainsi si un peuple vote « non » au référendum, on le fait revoter comme en Irlande ou l'on n'en tient pas compte comme pour le référendum français de 2005. Ce déni de souveraineté populaire a bien été analysé par Dani Rodrick dans le cadre de la mondialisation, mais on pourrait tout aussi bien l'appliquer à la construction européenne : la démocratie, la souveraineté des États-nations et l'accentuation de l'intégration européenne sont-elles compatibles ? Ceci peut se présenter comme un triangle . L'intégration forte se fait au détriment de la souveraineté politique, tandis qu'elle limite l'expression de la démocratie politique.

La volonté d'intégration forte ou renforcée se manifeste à chaque fois que l'Europe connaît des difficultés : « Il faut plus d'Europe », d'où les appels au « fédéralisme européen » : gouvernement européen, parlement européen. Ce modèle très ambitieux qui prend pour modèle les États-Unis d'Amérique, fait l'impasse sur l'existence profonde des vieilles nations européennes, avec leurs différences de langues, de culture, d'histoire. D'ailleurs la cour constitutionnelle de Karlsruhe a signifié par un arrêt très important que les transferts de souveraineté étaient désormais terminés, car s'il existe un peuple allemand, il n'existe pas de peuple européen. Dans ce contexte de crise depuis mai-juin 2010, ce n'est pas ce projet fédéral proprement dit qui progresse mais une tentative menée par l'Allemagne de centraliser auprès de la Commission européenne et de la Cour européenne de justice l'essentiel des politiques budgétaires au détriment de la souveraineté politique des États. Jusqu'à présent, la politique de règles voulait limiter quantitativement le plafond de déficit et de dette publics laissant aux États les choix internes de dépenses. Depuis l'automne 2010, le « Semestre européen » a été instauré : il prévoit que durant le premier semestre le projet de budget soit examiné en détail par les autorités bruxelloises pour examiner leur conformité avec les grandes options politiques de l'Europe. En faisant de la Commission et de la Cour européenne de justice les juges de la situation et en proposant des sanctions automatiques, Angela Merkel va dans le sens d'une renonciation à la souveraineté politique Le président français Nicolas Sarkozy a refusé ces orientations pour maintenir la gestion des différends dans le cadre politique de l'intergouvernemental. Ce débat est décisif et a des chances de structurer la campagne présidentielle française. De même que la solution des « eurobonds » ou obligations européennes qui serait l'embryon d'un fédéralisme budgétaire : d'un côté ils mettraient en place une solidarité de dette entre les États, selon certains jusqu'à 60% du PIB, d'un autre ils soumettraient les choix de chaque pays à l'approbation des instances supérieures. L'Allemagne dominante n'imposerait-elle pas dès lors ses préférences ?
… qui marquerait le « retour à l'Empire »?
Quelle est donc la forme politique qui est au cœur du projet européen ? Ni super État-nation, ni système fédéral à l'américaine, les spécialistes s'interrogent la manière de définir l'objet politique européen. Une interprétation très stimulante a été proposée par Antoine Winckler lors du traité de Maastricht. Selon lui « L'Empire revient », ce qui se constitue c'est une forme politique qui retrouve les structures du modèle impérial symbolisé par le Saint-Empire romain germanique. Premier trait structurel, la rupture de la séparation des pouvoirs, le Conseil européen, couplé à la Commission, joue le rôle de diète d'Empire, l'organe étant à la fois législatif et exécutif, ceci atténué par le traité de Lisbonne qui renforce le rôle du parlement comme organe de codécision. Deuxième trait structurel, l'importance de la Cour européenne de justice qui invente le droit, s'érige en pouvoir judiciaire et contrôle et apprécie les politiques des États. L'intégration européenne poussée peut être vue comme contradictoire avec la citoyenneté politique qui s'est épanouie essentiellement dans le cadre des États-nations. L'intégration établit une distance de plus en plus grande entre les individus et les centres de pouvoirs, distance aggravée par les barrières de langues, la complexité des processus décisionnels européens, le jeu des marchandages des intérêts organisés, les lobbies, auprès des centre de décisions bruxellois. Le citoyen politique céderait-il ainsi le pas à l'individu européen doté de droits, pas toujours opposables, mais éloigné de plus en plus du contrôle politique ?
Lucien Orio, Professeur de Chaire supérieure, Lycée Montaigne, Bordeaux
(1).James Buchanan et Gordon Tullock « Le calcul du consensus. Les fondements logiques de la démocratie constitutionnelle » 1962. L.O
(2). Le Traité constitutionnel européen prévoit que la décision du conseil européen soit prise par 55% des membres, avec au moins 15 d'entre eux et représentant 65% de la population européenne, toute minorité de blocage devant inclure au moins 4 pays membres. Mais certains domaines comme la fiscalité restent sous la règle de l'unanimité à la demande entre autres des britanniques. Le projet de réforme du traité de Lisbonne présenté par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy prévoit une généralisation de la règle de la majorité qualifiée avec un blocage à 15%
Ce dossier s'inscrit dans une démarche générale d'éclairages
divers, réalisée en collaboration par des auteurs, des universitaires,
des professionnels et les libraires, en vue des élections
présidentielles françaises de 2012 : « Aux livres citoyens ! ».
Retour vers « Aux livres citoyens ! »
Illustration : ©Spitzl