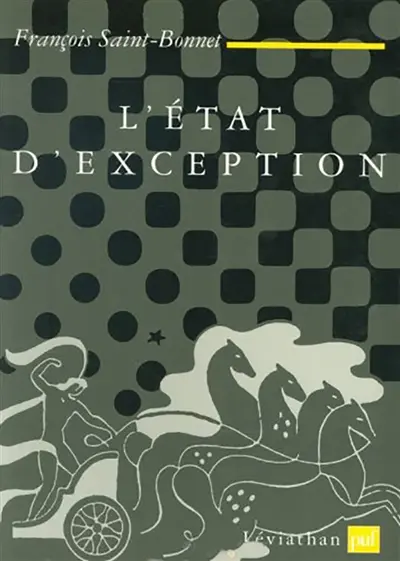en savoir plus

Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).
Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.
Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.
Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...
Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.
Requiert un compte Mollat
Requiert un compte Mollat
L'état d'exception
Auteur : François Saint-Bonnet
en savoir plus
Résumé
Cette étude du droit public de crise, de l'Antiquité à nos jours, permet d'identifier des constantes dans le discours justifiant l'état d'exception, qui fait appel aux notions d'impérieuse nécessité et d'évidence et échappe à l'interprétation (juridique) et au choix (politique). ©Electre 2026
Quatrième de couverture
Les débats relatifs à l'article 16 de la Constitution de 1958 sont aussi passionnés que récurrents. L'ombre de l'abus de pouvoir s'est toujours profilée derrière le droit public de crise ; une étude historique et théorique permet de la dissiper.
Dans la république romaine, la dictature ne suspendait pas la Constitution ; loin d'être un dispositif exceptionnel, elle était seulement liée aux besoins extra-ordinaires de défense de la cité. Dans la Chrétienté médiévale, l'état d'exception apparaît à l'occasion de conflits entre les organes spirituel et temporel ; en cas de nécessité, la concentration des fonctions est justifiée par l'idée de sauvegarde de la Chrétienté. A la fin du Moyen Age, en cas de péril pour le royaume, se manifeste l'impératif de sauvegarder ce qui deviendra l'Etat moderne ; ces situations permettent un élargissement temporaire des prérogatives royales (fiscalité, pouvoir normatif, atteinte à la propriété). A l'époque moderne, la préservation de l'Etat étant le fondement de l'ordre politique et juridique, le caractère absolu de la souveraineté exclut toute dérogation ou violation du droit ; en pratique, cependant, le roi continue d'invoquer la nécessité ; celle-ci est soutenue par les doctrines politiques de la raison d'Etat, ce qui lui confère, chez certains auteurs, un caractère systématique. A partir de 1789, l'état d'exception apparaît dans trois domaines (droit constitutionnel, droit administratif, «législations d'exception») où la perturbation de l'ordre juridique aboutit à une aporie. Pour la surmonter, deux types de justification sont avancés par les acteurs et les auteurs : soit la nécessité dispose d'une juridicité supérieure, soit elle est purement politique.
Par-delà des ordonnancements juridiques très différents selon les époques, le discours bute sur l'antinomie des adages : «nécessité fait loi» et «nécessité n'a point de loi». Pour dépasser la contradiction, l'évidence renforce la nécessité pour la faire échapper tant à l'interprétation (juridique) qu'au choix (politique). Fondement de l'état d'exception, l'évidente nécessité relève du sentiment esthétique. D'où son autonomie.
Fiche Technique
Paru le : 01/02/2001
Thématique : Grands thèmes droit public
Auteur(s) : Auteur : François Saint-Bonnet
Éditeur(s) :
PUF
Collection(s) : Léviathan
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782130501367
Reliure : Broché
Pages : 400
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 18.0 cm
Épaisseur: 2.1 cm
Poids: 701 g