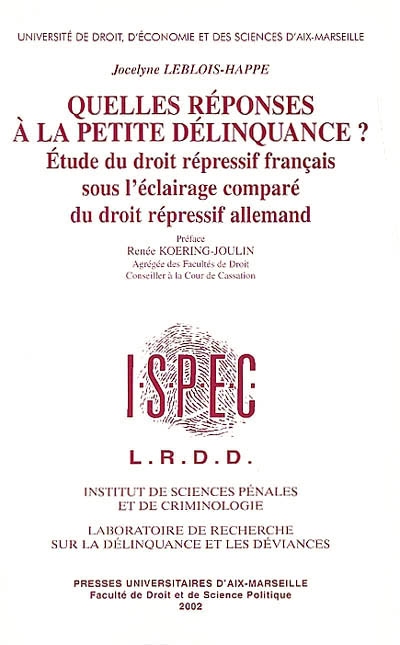en savoir plus

Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).
Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.
Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.
Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...
Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.
Requiert un compte Mollat
Requiert un compte Mollat
Quelles réponses à la petite délinquance ? : étude du droit répressif français sous l'éclairage comparé du droit répressif allemand
Auteur : Jocelyne Leblois-Happe
en savoir plus
Résumé
Etude comparative (France-Allemagne) du droit répressif concernant la petite délinquance. L'auteur distingue deux types de réponses. L'une consiste à adapter à ce type de criminalité les sanctions pénales classiques, et notamment l'emprisonnement et l'amende. L'autre consiste en des remèdes sur mesure telles que les sanctions privatives ou restrictives de droits, ou le travail d'intérêt général. ©Electre 2025
Fiche Technique
Paru le : 23/11/2002
Thématique : Droit Pénal
Auteur(s) : Auteur : Jocelyne Leblois-Happe
Éditeur(s) :
Presses universitaires d'Aix-Marseille
Collection(s) : Non précisé.
Contributeur(s) : Préfacier : Renée Koering-Joulin
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782731403084
Reliure : Broché
Pages : 821
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 0 g