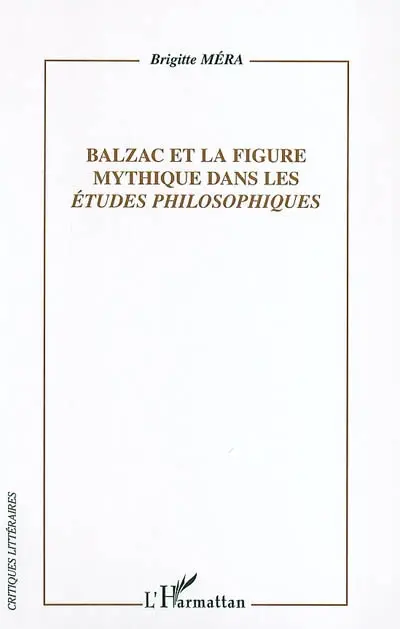en savoir plus

Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).
Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.
Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.
Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...
Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.
Requiert un compte Mollat
Requiert un compte Mollat
Balzac et la figure mythique dans les Etudes philosophiques
Auteur : Brigitte Méra
en savoir plus
Résumé
Balzac reconnaît dans le mythe le moyen d'incarner poétiquement l'idée et d'en fixer la portée générale dans un symbole historiquement daté. Le mythe permet une histoire à deux niveaux, terrestre et céleste. Il représente le réel tout en dévoilant une signification spirituelle. Les personnages se classent en trois catégories : le sorcier, le sacrificateur, le passeur. ©Electre 2026
Quatrième de couverture
Dès ses écrits de jeunesse, Balzac souhaite porter au jour les secrets de la nature, les vérités cachées sans recourir aux arguties de la métaphysique et inventer un langage qui lui soit adéquat, tout en restant accessible. Le langage adapté à un tel dessein combinerait la généralité et les particularités liées à l'Histoire, il renouvellerait la connaissance de l'homme en joignant l'image et l'idée. Cette ambition balzacienne se fixe définitivement à partir de 1831 dans La Peau de chagrin tandis que dans l'«Introduction» aux Études philosophiques, il exprime ensuite et, avec force, la nécessité de donner à la pensée des «formes vivantes» qui soient «à la fois poétiques, réelles, colorées et qui éblouissent le regard». Tout cela le conduit à entreprendre une très riche réflexion sur le mythe, dans les Études philosophiques. L'écrivain voit donc dans la figure mythique, le langage nécessaire pour tout exprimer. Dans la mesure où l'auteur souhaite précisément trouver le «germe», le caractère originaire de la condition humaine, il adopte une démarche de caractère anthropologique avant la lettre. Celle-ci vise à faire saillir des figures archétypales qui rendent compte de l'ambition balzacienne de classer toutes les espèces sociales et humaines, et de montrer toutes les expériences physiques, sociales et spirituelles. On peut ainsi répartir les personnages des Études philosophiques en trois classes: le «sorcier», le «sacrificateur» et le «passeur». Anticipant sur les théoriciens modernes du mythe, il reconnaît, dans celui-ci, le moyen d'incarner poétiquement l'idée, d'en fixer la portée générale dans un symbole historiquement daté: ainsi peuvent se joindre l'expérience la plus concrète et l'expérience de l'absolu. Progressivement se dégage la thèse de Brigitte Méra: Balzac combine des idées-mères, c'est-à-dire originaires, avec des images-forces qui se retrouvent dans les Études de moeurs à travers une typologie fascinante et dont la généalogie est la figure mythique des Études philosophiques.
Fiche Technique
Paru le : 15/02/2004
Thématique : Essais et théories - Dictionnaire
Auteur(s) : Auteur : Brigitte Méra
Éditeur(s) :
L'Harmattan
Collection(s) : Critiques littéraires
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782747559560
Reliure : Broché
Pages : 344
Hauteur: 22.0 cm / Largeur 14.0 cm
Épaisseur: 1.9 cm
Poids: 370 g