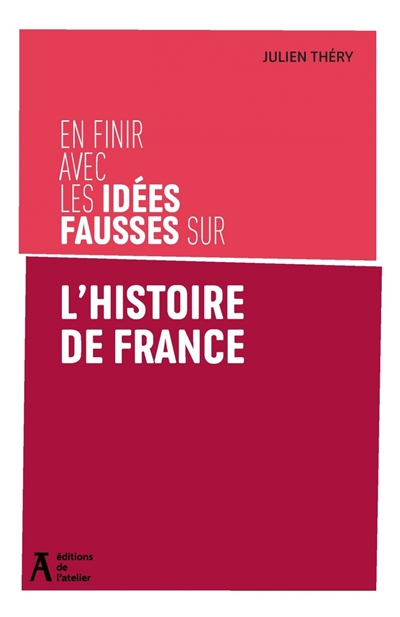Chargement...
Chargement...
Julien Théry - En finir avec les idées fausses sur l'histoire de France
Nos ancêtres les Gaulois, Moyen Âge obscur : décrypter les mythes de l'histoire de France.
Publié le 27/10/2025
Julien Théry vous présente son ouvrage "En finir avec les idées fausses sur l'histoire de France" aux éditions de l'Atelier. Entretien avec Nicolas Patin.
Dans cet essai Julien Théry, médiéviste et animateur de l'émission La Grande H, s'attaque à la prolifération et l'instrumentalisation politique des récits sur le passé. Loin de la posture du "chevalier blanc de l'exactitude", l'auteur s'inscrit dans l'héritage de Marc Bloch pour qui il est essentiel de comprendre non seulement pourquoi les faits sont faux, mais surtout pourquoi ces idées fausses sont nées et continuent d'être efficaces. Théry rappelle que toute histoire est instrumentalisée, car la perception du passé est subjective et sélective, toujours liée aux enjeux du présent.
L'ouvrage, dense et documenté, décline cette méthode en étudiant une vingtaine de mythes fondateurs, analysant leur nécessité historique et leur efficacité contemporaine.
L'exemple des "Nos ancêtres les Gaulois" est décortiqué. Ce mythe n'est pas médiéval (où les origines étaient troyennes) mais fut forgé principalement au XIXe siècle. Il a d'abord servi la cause de l'émancipation du Tiers État contre l'aristocratie (héritière des Francs). Il a ensuite été instrumentalisé par Napoléon III (qui se voyait en "nouveau César" civilisateur d'un peuple gaulois indiscipliné). Enfin, la IIIe République (via Ernest Lavisse) l'a imposé dans les manuels scolaires comme un "pieux mensonge" pour faire nation et préparer la revanche.
Aujourd'hui, ce mythe ringardisé par Astérix opère un retour sérieux, notamment dans le discours de la droite conservatrice (Laurent Wauquiez est cité). L'enjeu a changé : il ne s'agit plus de revanche nationale, mais de défendre une "civilisation gauloise" assiégée, renvoyant à l'idéologie du choc des civilisations et du Grand Remplacement.
Julien Théry déconstruit l'idée reçue selon laquelle le Moyen Âge fut une époque de ténèbres. Il rappelle que cette vision péjorative est une invention de la Renaissance ("âge moyen") et des Protestants (pour marquer la rupture religieuse) puis des Lumières (pour dénoncer l'oppression cléricale et le despotisme). Le médiéviste nuance notre sentiment de supériorité occidentale sur la démocratie. En comparant les systèmes, il met en lumière des formes de participation citoyenne plus élevées dans certaines Cités-États médiévales (italiennes, flamandes) que dans nos démocraties représentatives libérales, citant l'existence de lois antimagnats visant à limiter le pouvoir des oligarques.
L'auteur aborde également les sujets sensibles du XXe siècle, dont la complicité française dans le génocide rwandais, l'histoire de la guerre d'Algérie et le mythe "tous résistants". Pour ces sujets brûlants, Julien Théry s'appuie sur la bibliographie spécialisée (Chrétien, Duclert, etc.) et insiste sur les enjeux politiques contemporains. L'affaire du Rwanda est analysée comme la conséquence d'une logique néocoloniale et d'une raison d'État qui a permis à l'Exécutif d'agir sans contrôle démocratique réel. L'objectif de l'historien est de fournir les clés pour comprendre comment ces idées fausses et ces silences continuent de façonner les débats actuels.
L'ouvrage, dense et documenté, décline cette méthode en étudiant une vingtaine de mythes fondateurs, analysant leur nécessité historique et leur efficacité contemporaine.
L'exemple des "Nos ancêtres les Gaulois" est décortiqué. Ce mythe n'est pas médiéval (où les origines étaient troyennes) mais fut forgé principalement au XIXe siècle. Il a d'abord servi la cause de l'émancipation du Tiers État contre l'aristocratie (héritière des Francs). Il a ensuite été instrumentalisé par Napoléon III (qui se voyait en "nouveau César" civilisateur d'un peuple gaulois indiscipliné). Enfin, la IIIe République (via Ernest Lavisse) l'a imposé dans les manuels scolaires comme un "pieux mensonge" pour faire nation et préparer la revanche.
Aujourd'hui, ce mythe ringardisé par Astérix opère un retour sérieux, notamment dans le discours de la droite conservatrice (Laurent Wauquiez est cité). L'enjeu a changé : il ne s'agit plus de revanche nationale, mais de défendre une "civilisation gauloise" assiégée, renvoyant à l'idéologie du choc des civilisations et du Grand Remplacement.
Julien Théry déconstruit l'idée reçue selon laquelle le Moyen Âge fut une époque de ténèbres. Il rappelle que cette vision péjorative est une invention de la Renaissance ("âge moyen") et des Protestants (pour marquer la rupture religieuse) puis des Lumières (pour dénoncer l'oppression cléricale et le despotisme). Le médiéviste nuance notre sentiment de supériorité occidentale sur la démocratie. En comparant les systèmes, il met en lumière des formes de participation citoyenne plus élevées dans certaines Cités-États médiévales (italiennes, flamandes) que dans nos démocraties représentatives libérales, citant l'existence de lois antimagnats visant à limiter le pouvoir des oligarques.
L'auteur aborde également les sujets sensibles du XXe siècle, dont la complicité française dans le génocide rwandais, l'histoire de la guerre d'Algérie et le mythe "tous résistants". Pour ces sujets brûlants, Julien Théry s'appuie sur la bibliographie spécialisée (Chrétien, Duclert, etc.) et insiste sur les enjeux politiques contemporains. L'affaire du Rwanda est analysée comme la conséquence d'une logique néocoloniale et d'une raison d'État qui a permis à l'Exécutif d'agir sans contrôle démocratique réel. L'objectif de l'historien est de fournir les clés pour comprendre comment ces idées fausses et ces silences continuent de façonner les débats actuels.
Bibliographie