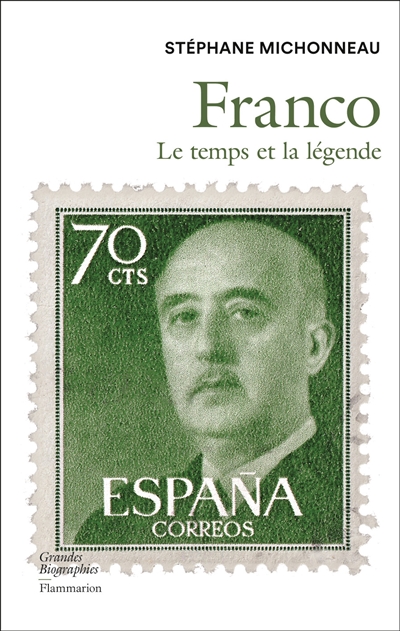Chargement...
Chargement...
Stéphane Michonneau - Franco : le temps et la légende
Plongez dans les couches mémorielles du franquisme et découvrez comment la figure de Francisco Franco continue de hanter l'Espagne contemporaine.
Publié le 21/11/2025
Stéphane Michonneau vous présente son ouvrage "Franco : le temps et la légende" aux éditions Flammarion. Entretien avec Aubin Gonzalez.
Dans cet entretien stimulant, l'historien Stéphane Michonneau invite à une relecture de la figure de Francisco Franco à travers le prisme de la mémoire et des mythes qu'elle a engendrés. L'auteur explique d'emblée pourquoi son livre n'est pas une biographie traditionnelle : face à la quantité d'ouvrages existants, principalement en espagnol et en anglais, il a choisi d'adopter une approche archéologique et mémorielle.
Le livre, écrit "à l'envers", commence par l'événement le plus récent (l'exhumation de Franco en 2019) pour remonter jusqu'à ses débuts de figure publique dans les années 1920. Cette structure permet de déconstruire les couches mémorielles successives. Stéphane Michonneau explore la manière dont l'image du dictateur a servi de caméléon, s'adaptant aux espoirs et aux peurs de la société espagnole à différents moments. Des mythes, comme celui du "héros de la Légion" des années 1920, ont disparu, tandis que d'autres, comme l'image du "symbole de l'unité du pays" ou du "modernisateur", ressurgissent, notamment à travers les mouvements d'extrême droite contemporains (Vox). L'auteur insiste sur le fait que la figure de Franco est une "ressource" toujours réinvestie par la société.
La discussion met l'accent sur deux lieux de mémoire fondamentaux pour comprendre le franquisme et son héritage. D'abord, le Valle de los Caídos (aujourd'hui Valle de Cuelgamuros), gigantesque ossuaire construit par des prisonniers républicains et devenu mausolée du dictateur. Le spécialiste détaille la construction de ce lieu et l'embarras qu'il représente pour la démocratie, illustrant sa difficulté à gérer cet héritage. Il explique pourquoi la visite de ce "plus grand monument fasciste d'Europe" est indispensable pour saisir l'ensemble de la mémoire espagnole. Ensuite, le village en ruine de Belchite, symbole de la prétendue "barbarie rouge" pour le franquisme. L'auteur retrace la dépolitisation progressive de Belchite à partir des années 1960, puis sa réappropriation sous un angle purement patrimonial dans les années 1990, illustrant un changement de regard sur la guerre civile, désormais vue comme une tragédie dont tous furent victimes.
L'entretien aborde également la manipulation de l'image du dictateur par le régime. Notamment à partir des années 1960 avec le slogan "Spain is different" et la promotion d'un Franco familial — le "grand-père" sympathique et protecteur. Cette propagande, qui masque la brutalité répressive du régime (maintenue jusqu'à la fin), a contribué au sentiment d'être « orphelin » ressenti par une partie de la population à sa mort en 1975. Stéphane Michonneau rappelle l'importance de l'origine coloniale de Franco (Guerre du Rif) et des répressions qu'il y mena, traçant un parallèle audacieux avec le général français Cavaignac. Cette dimension de "Franco criminel" n'a été pleinement reconnue en Espagne qu'à partir des années 2000, avec la montée de la vague mémorielle. En conclusion, l'historien choisit le kaléidoscope comme métaphore de son travail, soulignant la complexité et la nature plurielle du personnage, une démarche nécessaire pour toute biographie d'un grand personnage historique.
Le livre, écrit "à l'envers", commence par l'événement le plus récent (l'exhumation de Franco en 2019) pour remonter jusqu'à ses débuts de figure publique dans les années 1920. Cette structure permet de déconstruire les couches mémorielles successives. Stéphane Michonneau explore la manière dont l'image du dictateur a servi de caméléon, s'adaptant aux espoirs et aux peurs de la société espagnole à différents moments. Des mythes, comme celui du "héros de la Légion" des années 1920, ont disparu, tandis que d'autres, comme l'image du "symbole de l'unité du pays" ou du "modernisateur", ressurgissent, notamment à travers les mouvements d'extrême droite contemporains (Vox). L'auteur insiste sur le fait que la figure de Franco est une "ressource" toujours réinvestie par la société.
La discussion met l'accent sur deux lieux de mémoire fondamentaux pour comprendre le franquisme et son héritage. D'abord, le Valle de los Caídos (aujourd'hui Valle de Cuelgamuros), gigantesque ossuaire construit par des prisonniers républicains et devenu mausolée du dictateur. Le spécialiste détaille la construction de ce lieu et l'embarras qu'il représente pour la démocratie, illustrant sa difficulté à gérer cet héritage. Il explique pourquoi la visite de ce "plus grand monument fasciste d'Europe" est indispensable pour saisir l'ensemble de la mémoire espagnole. Ensuite, le village en ruine de Belchite, symbole de la prétendue "barbarie rouge" pour le franquisme. L'auteur retrace la dépolitisation progressive de Belchite à partir des années 1960, puis sa réappropriation sous un angle purement patrimonial dans les années 1990, illustrant un changement de regard sur la guerre civile, désormais vue comme une tragédie dont tous furent victimes.
L'entretien aborde également la manipulation de l'image du dictateur par le régime. Notamment à partir des années 1960 avec le slogan "Spain is different" et la promotion d'un Franco familial — le "grand-père" sympathique et protecteur. Cette propagande, qui masque la brutalité répressive du régime (maintenue jusqu'à la fin), a contribué au sentiment d'être « orphelin » ressenti par une partie de la population à sa mort en 1975. Stéphane Michonneau rappelle l'importance de l'origine coloniale de Franco (Guerre du Rif) et des répressions qu'il y mena, traçant un parallèle audacieux avec le général français Cavaignac. Cette dimension de "Franco criminel" n'a été pleinement reconnue en Espagne qu'à partir des années 2000, avec la montée de la vague mémorielle. En conclusion, l'historien choisit le kaléidoscope comme métaphore de son travail, soulignant la complexité et la nature plurielle du personnage, une démarche nécessaire pour toute biographie d'un grand personnage historique.
Bibliographie