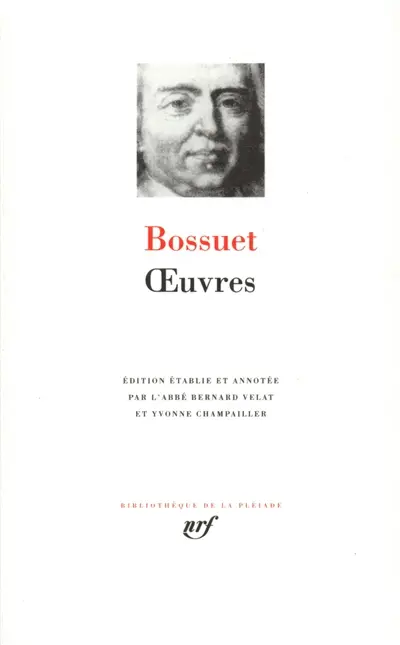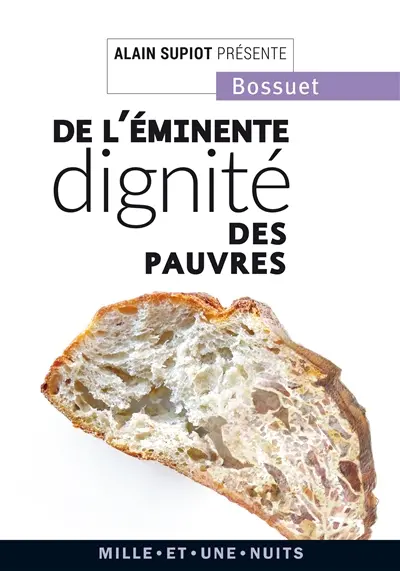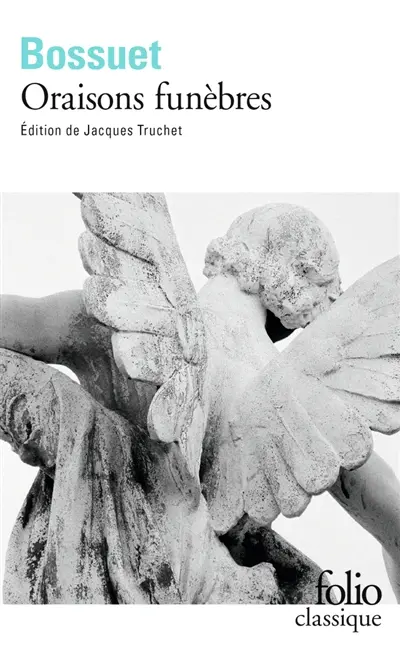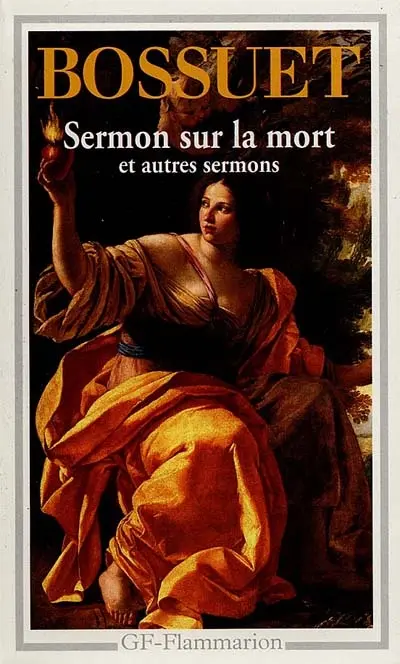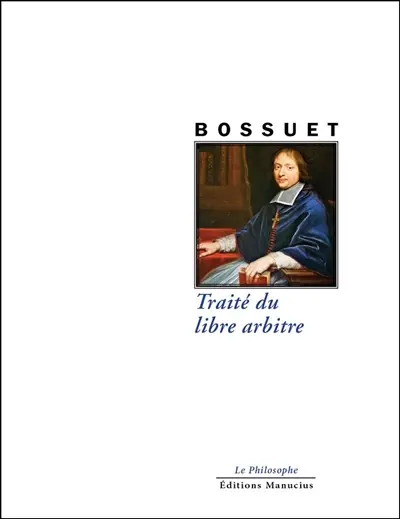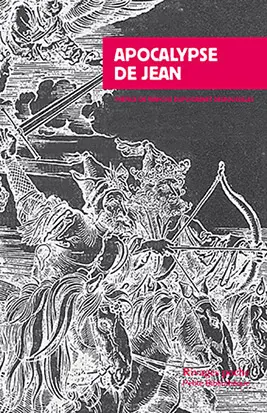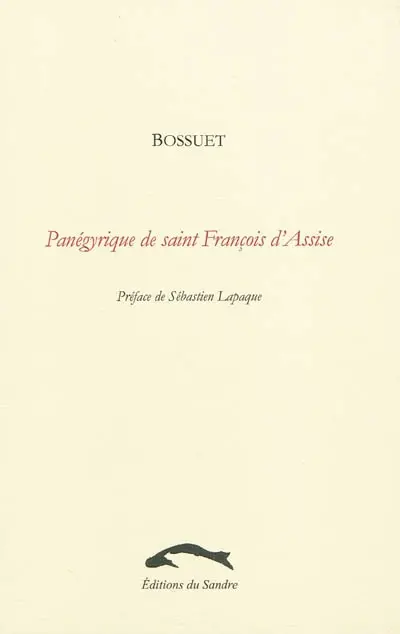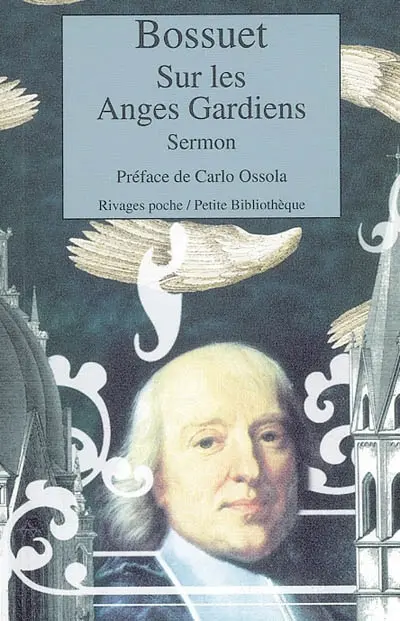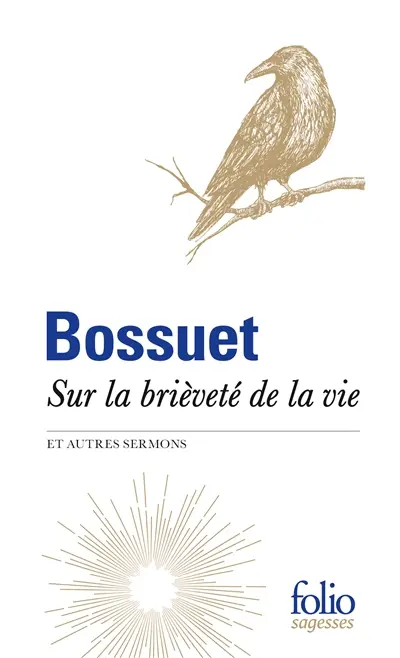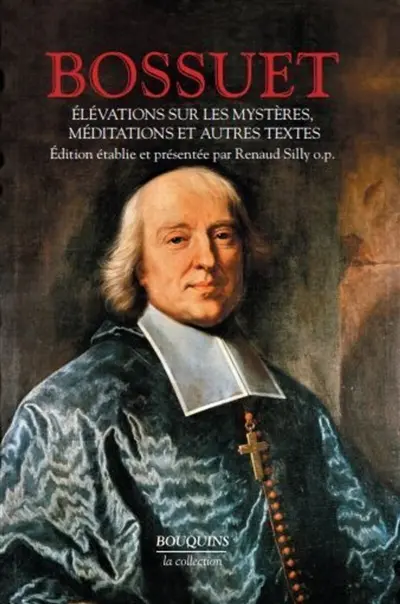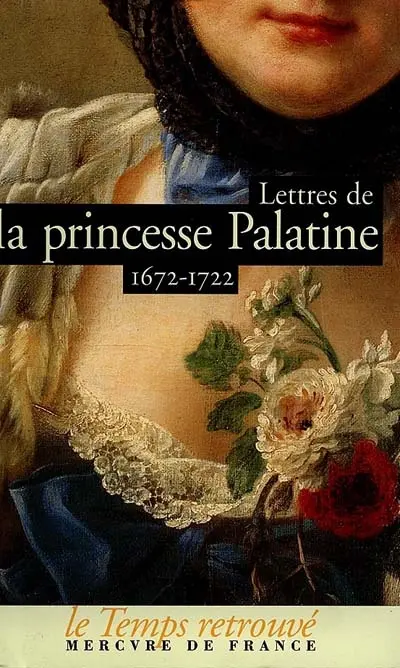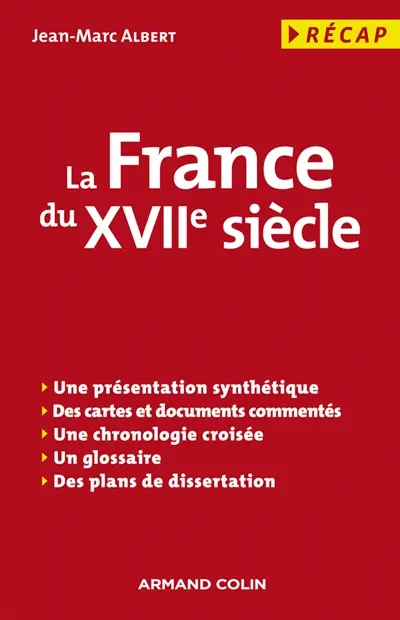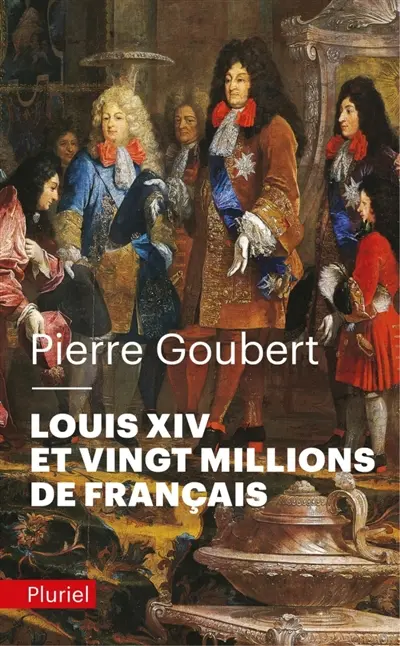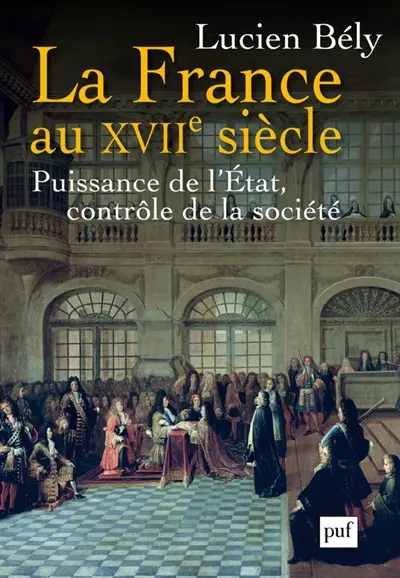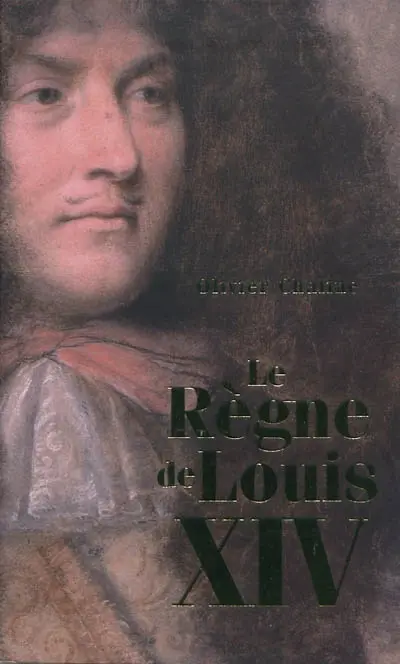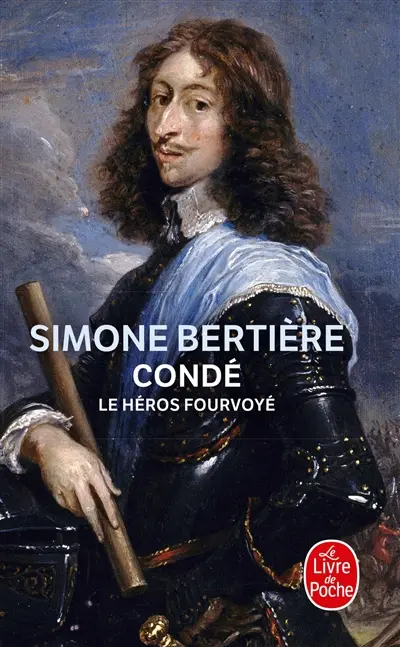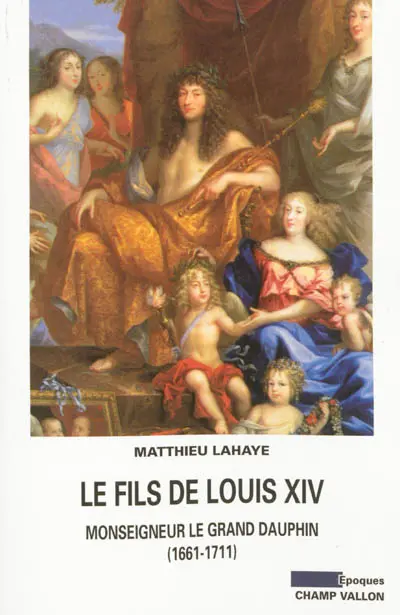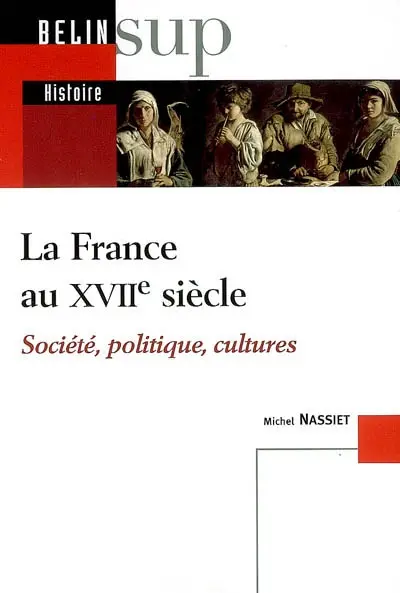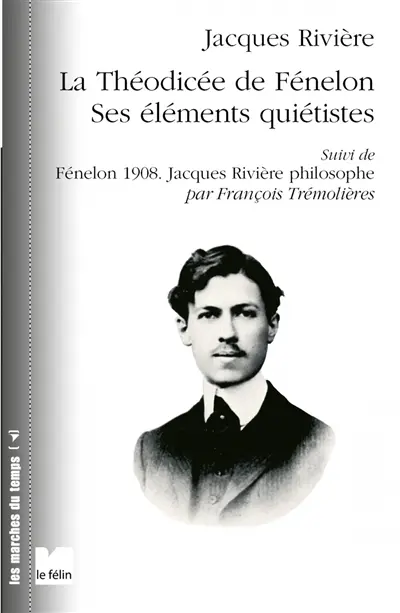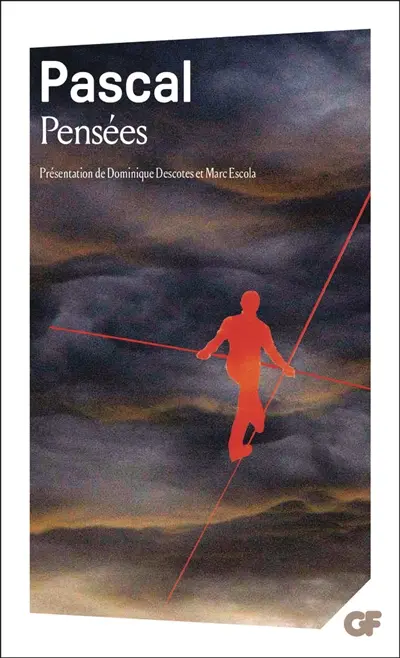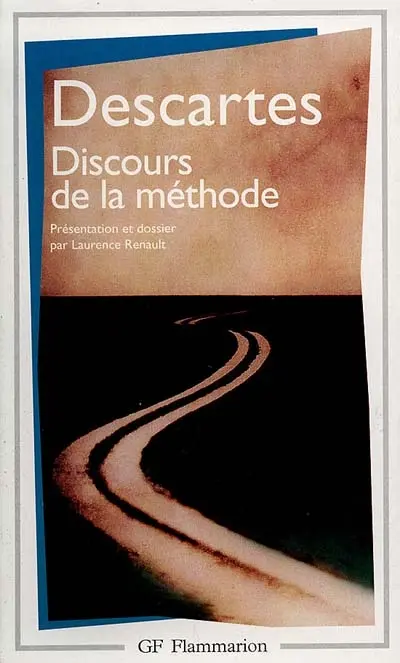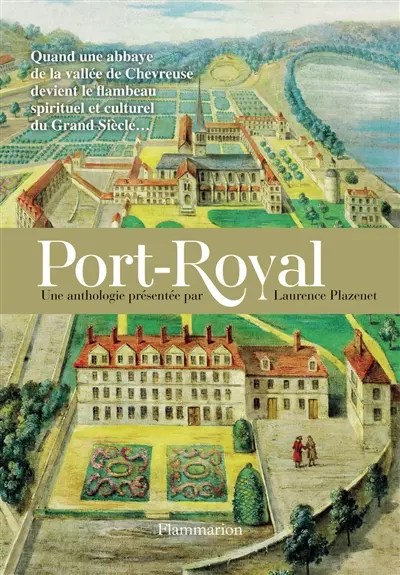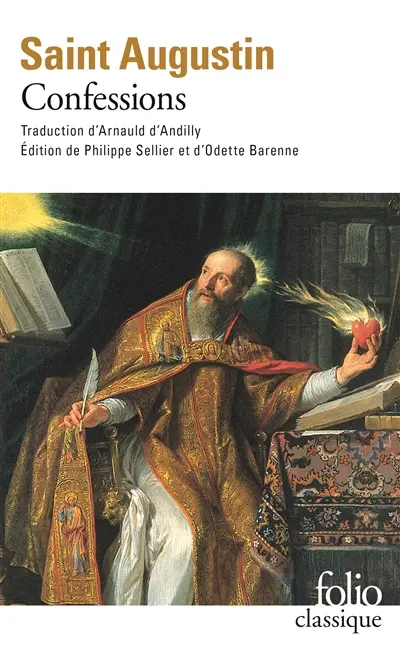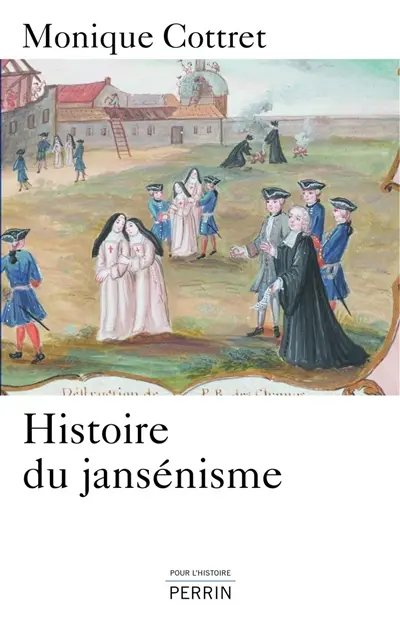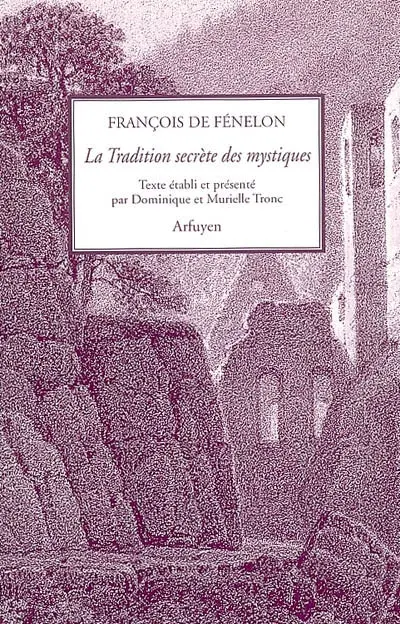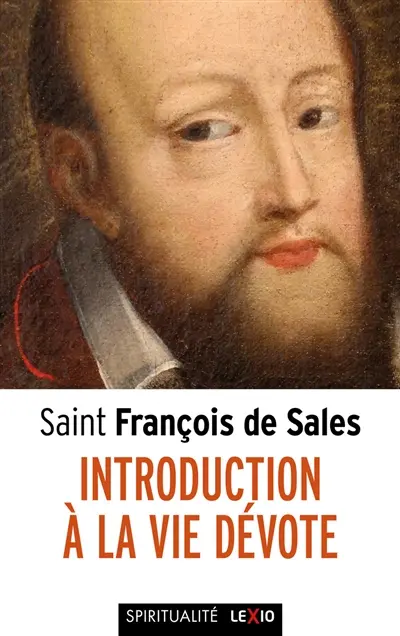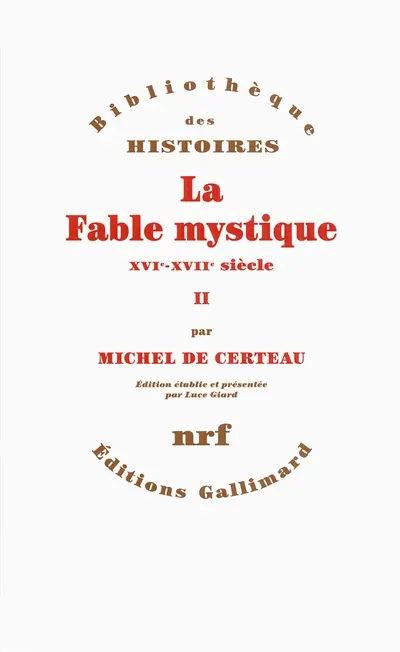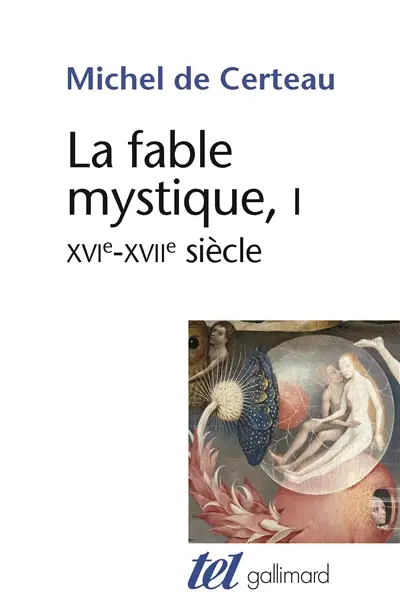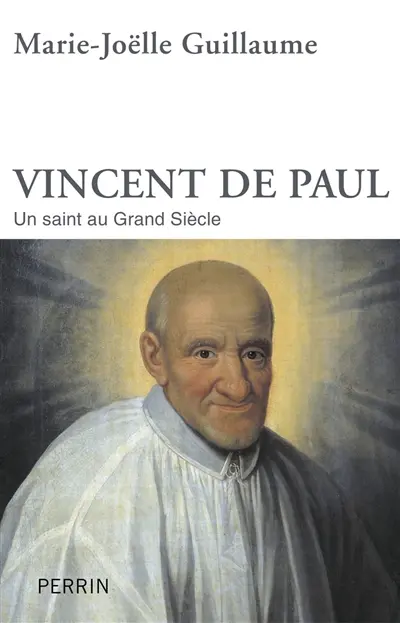Homme de cour et homme de lettres, figure emblématique de la culture classique du Grand Siècle, Bossuet incarne aussi une certaine idée du catholicisme triomphant de la Contre Réforme. Son Exposition sur la doctrine catholique en est une parfaite illustration, énonçant toutefois, et de manière singulière, la nécessité d’un dialogue et d’une mutuelle compréhension entre catholiques et protestants. Homme de son temps, l’écrivain se nourrit des influences qui parcourent le siècle, de Saint Augustin à Descartes, en passant par Saint Thomas d’Aquin , Corneille ou Pascal. Héritier de la scolastique médiévale, Bossuet est au croisements de tout : Antiquité et modernité, foi et rationalisme, lettres et sciences, cultures et savoirs. De même, il se tiendra au cœur des grands conflits théologiques qui bouleversent alors l’Église catholique gallicane, dont il sera longtemps le chef de file : le courant janséniste d’abord, rassemblé autour de Port-Royal, et les doctrines quiétistes ensuite, dont Madame Guyon et Fénelon restent à ce jour les plus fameux représentants.
Pris entre l’ancien et le nouveau monde, Bossuet, plus que quiconque, incarne cette fin de siècle troublée et incertaine, cette « crise de la conscience européenne » selon les mots de l’historien Paul Hazard. Sa figure sera livrée à une postérité changeante, vacillant entre une certaine méfiance de la part des Lumières et un regain d'intérêt, un siècle plus tard, pour ce "génie du christianisme" qui a si bien su incarner la grandeur de la France. A chacun de s'en faire une opinion. Quoi qu'il en soit, Bossuet, par une littérature féconde, innovante et libre et par sa dimension religieuse et politique, aura fortement et durablement marqué de son empreinte l'identité culturelle de la France moderne.