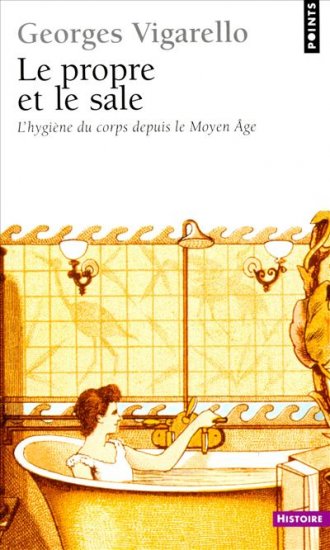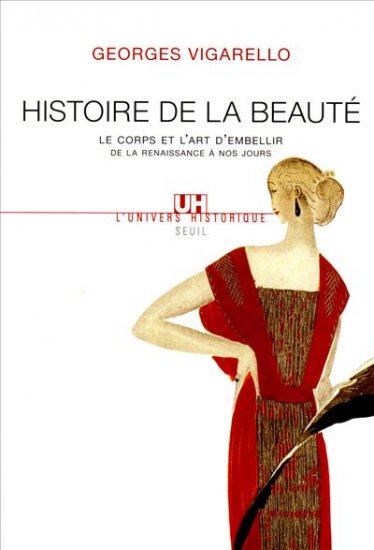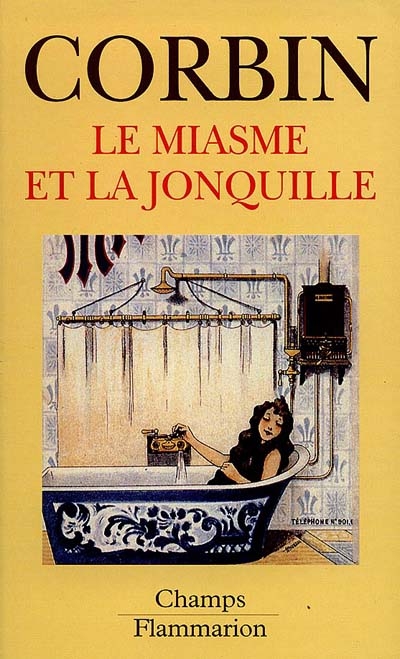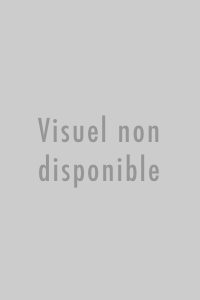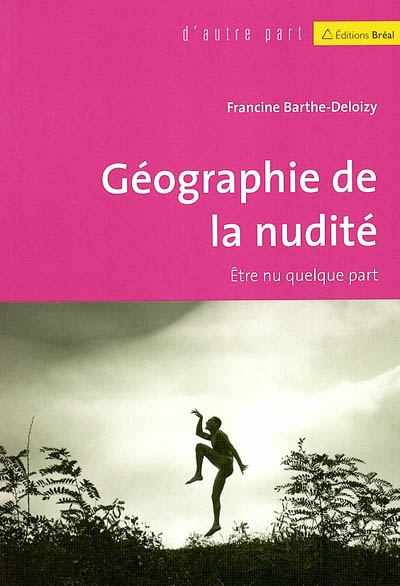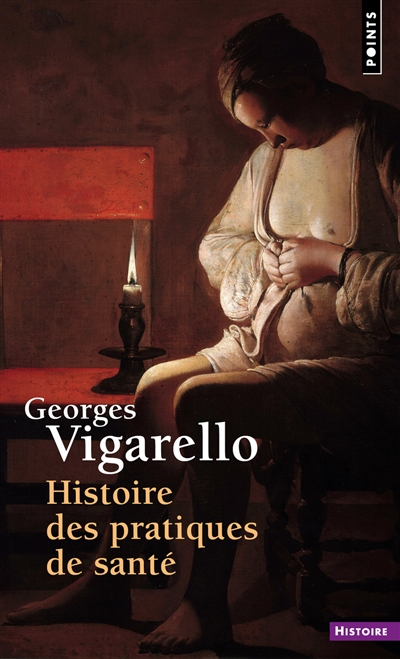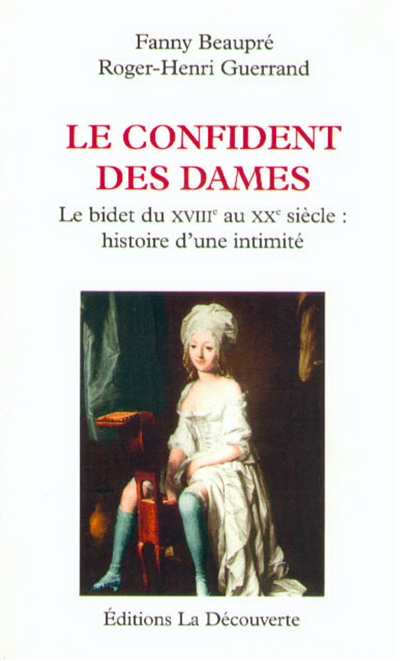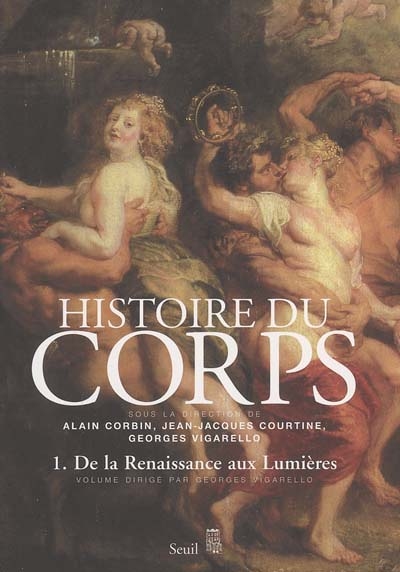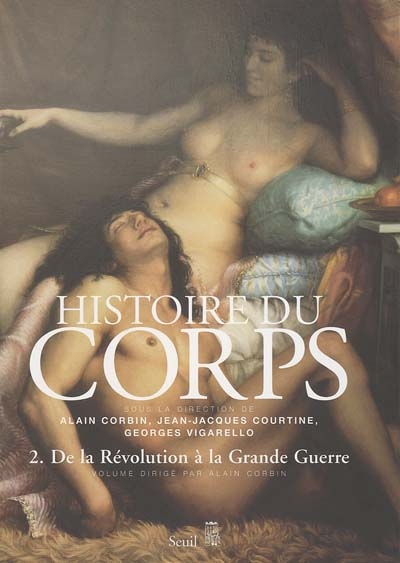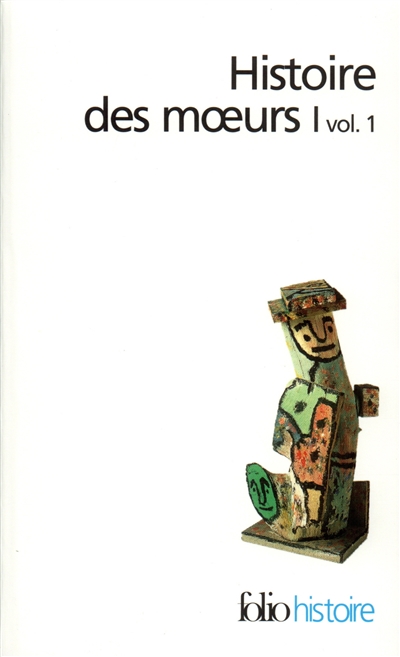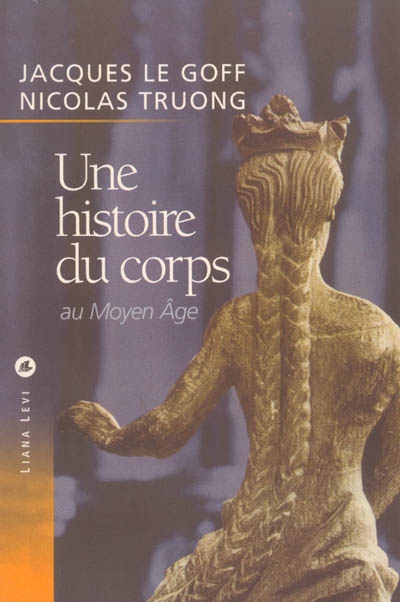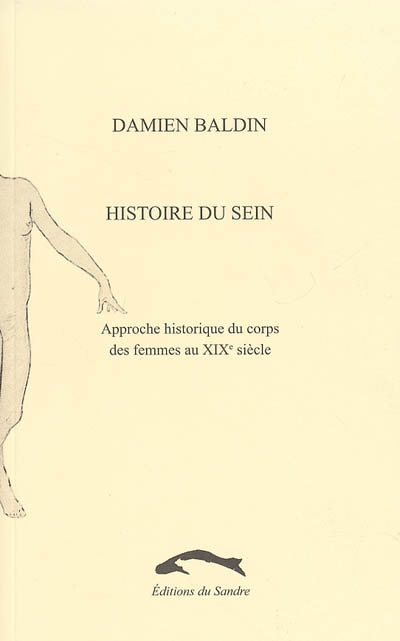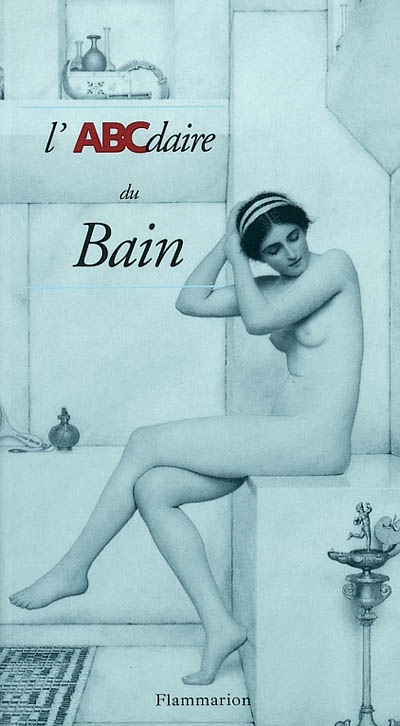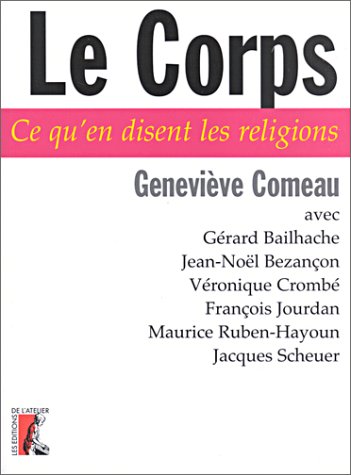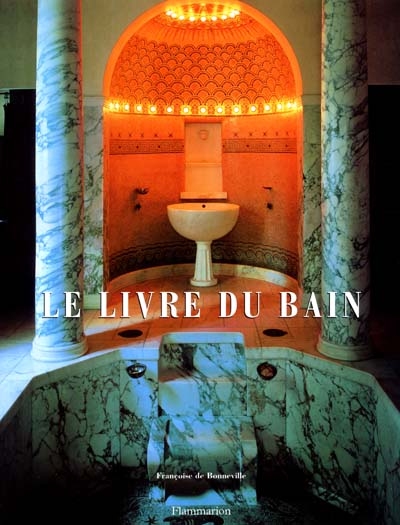elon
les époques, la notion de propreté est perçue tour à tour comme un vice ou une
vertu. Au cœur du débat, nous retrouvons un élément essentiel :
l'eau.
elon
les époques, la notion de propreté est perçue tour à tour comme un vice ou une
vertu. Au cœur du débat, nous retrouvons un élément essentiel :
l'eau.
Durant l'Antiquité, elle est sacralisée, et dans
l'Église primitive, se laver entièrement est signe de purification de l'âme.
Puis sous l'Ancien Régime, l'eau suscite la méfiance. C'est en effet, à cette
époque que se développe la théorie des humeurs selon laquelle l'immersion du
corps dans l'eau est perçue comme un facteur de déséquilibre physiologique. La
dilatation des pores de la peau affaiblirait le corps et permettrait
l'infiltration des maladies.
Par conséquent, l'usage des étuves, sorte de
bains publics, est considéré comme propagateur d'épidémies et comme source de
désordres moraux en raison de la promiscuité des corps. La crasse devient un
facteur de conservation, elle protège.
Se développe alors la " toilette
sèche", qui est plus symbolique qu'autre chose. L'apparence prime sur la
propreté réelle des corps.
Ce royaume de l'apparat mène également à d'autres
pratiques, notamment l'usage du maillot de corps, qui contrairement à la peau et
aux vêtements, est lavé régulièrement.
Les seules parties du corps nettoyées
régulièrement, du Moyen Âge jusqu'au XVIIIe, sont les mains et le visage,
surtout pour répondre aux codes de bonne conduite.
Sous Louis XVI, les gestes
de l'hygiène corporelle commencent à s'effectuer dans des pièces spécifiques, à
l'abri des regards. Lieux d'aisance et bidets font leur apparition. L'eau
commence lentement à être acceptée.
Les salles de bain deviennent alors à la mode, mais dans une optique de détente : on y cause, on fait salon. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le bain devient une pratique hygiénique.
En 1962, 29% des foyers avaient une douche. Aujourd'hui, 85% en sont équipés.
Un point important de l'histoire de l'hygiène est
celui des odeurs.
Elles sont acceptées, tolérées jusqu'au XVIIe siècle, puis
de nombreuses mesures sont prises, que ce soit à l'échelle de la ville ou des
individus. On ne cherche pas à supprimer les odeurs corporelles, mais on les
couvre avec des parfums très forts. Le parfum est pourtant apparu au Moyen Âge,
mais son essor ne se fait qu'au XVIIe siècle. Visages, mains, bouches sont
nettoyés à l'eau parfumée.
En ce qui concerne l'hygiène à l'échelle urbaine, la
notion de propreté se situe à la croisée d'un besoin privé et d'une politique
publique. Jusqu'au XVIIIe, la rue sert de latrines publiques. La population
urine et jette ses ordures dehors, contribuant à la prolifération des
épidémies.
Les premières mesures prophylactiques datent de la fin du Moyen
Âge, et consistent essentiellement à ne plus jeter le sang des saignées dans la
Seine.
À Paris, par exemple, la ville est traversée par deux
égouts à ciel ouvert, provoquant inondations et coulées de boue très
régulièrement. La construction de trottoirs et la modernisation des égouts ne
sont effectives qu'à partir du XVIIIe siècle avec la fondation du Conseil
d'Hygiène et de Salubrité, contrôlant la voirie, les marchés et logements. La
politique sanitaire vise à purifier l'air et à débarrasser les villes de leurs
miasmes pathogènes. L'eau est de plus en plus utilisée pour nettoyer les
rues.
Le XXe siècle finalise le réseau d'égouts ainsi que la mise en place du
tout-à-l'égout et voit également la construction de 8000 stations
d'épuration.
Notre conception de l'hygiène est en constante
évolution. Ces dernières années sont par exemple marquées par l'explosion des
produits cosmétiques en tout genre et l'arrivée sur le marché de toute une gamme
de produits pour les hommes, alors que le XIXe soulignait un retour au
naturel.
L'homme ne cesse de modifier son rapport au corps, les codes
changent, et par conséquent, le rapport à l'hygiène. Se baigner, se laver, se
nettoyer, se sécher, se maquiller, autant d'actes dont le sens change selon les
périodes...
Céline Constantin
Illustration : Edgar Degas, Femme au tub, pastel sur papier, circa 1883