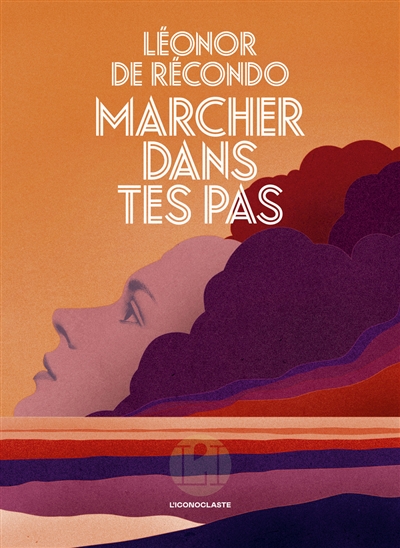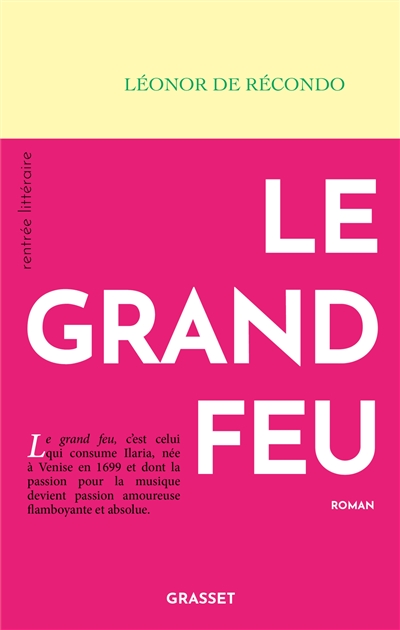Chargement...
Chargement...
Léonor de Récondo - Marcher dans tes pas
Un voyage dans le temps sur les traces des exilés républicains espagnols, entre histoire et mémoire intime.
Publié le 18/09/2025
Léonor de Récondo vous présente son ouvrage "Marcher dans tes pas" aux éditions l'Iconoclaste. Entretien avec Sylvie Hazebroucq. Rentrée littéraire automne 2025.
Léonor De Récondo signe un récit d'une puissance saisissante qui entremêle la grande Histoire à l'histoire intime de sa famille. L'ouvrage est né d'une nécessité impérieuse : celle de prouver l'exil de son grand-père. À la suite d'une nouvelle loi espagnole offrant la nationalité aux descendants d'exilés républicains, l'autrice se retrouve confrontée à l'absurdité administrative. On lui demande un "justificatif d'exil", une demande qui fait ressurgir la violence de l'histoire et l'humiliation ressentie. Pour toute preuve, elle ne possède que les récits de son père et les fragments d'une mémoire familiale transmise de vive voix.
L'écriture devient alors une arme, une forme de révolte contre l'oubli et le silence. Plus qu'une quête d'identité, ce livre est une exploration du "creux" laissé par l'absence, des fantômes qui peuplent la mémoire familiale. L'autrice ne se contente pas de relater les faits, elle y insuffle de la chair, du corps, des émotions. Les corps en mouvement, la brutalité de la guerre, le quotidien interrompu par l'exil, tout cela est décrit avec une force et une fluidité qui rend le passé terriblement vivant. L'utilisation du "je", du "tu" et du "nous" abolit les frontières temporelles, permettant à la narratrice et au lecteur de "marcher dans les pas" de ces absents.
Ce va-et-vient entre passé et présent, cette fusion des temporalités, permet de mettre en lumière la résonance des événements de 1936 avec le monde actuel. De Récondo évoque le "tourisme de guerre", le spectacle de la souffrance d'autrui que l'on observe sans agir, hier comme aujourd'hui. L'ouvrage est un hymne à l'accueil et à la générosité, un engagement politique pour l'humanité. L'autrice souligne le rôle des femmes dans ces périodes de l'histoire, souvent reléguées au second plan, alors qu'elles sont celles qui portent l'exil, les enfants et l'avenir.
À travers ce récit, c'est aussi un hommage à l'écriture, à son pouvoir de reconstruire, de rendre vivants les disparus. De Récondo n'a pas voulu que sa voix soit étouffée par les conventions romanesques. Elle a laissé la forme se plier à la nécessité du récit, intégrant des poésies qui s'imposent comme des parenthèses de liberté. La quête de ses papiers devient une quête littéraire, une exploration des archives, des actes de naissance et de décès, des traces écrites qui témoignent de la vie. Au-delà de l'histoire familiale, le livre célèbre la mémoire, la transmission et l'amour, "le seul territoire" capable de nous unir face à la violence du monde.
L'écriture devient alors une arme, une forme de révolte contre l'oubli et le silence. Plus qu'une quête d'identité, ce livre est une exploration du "creux" laissé par l'absence, des fantômes qui peuplent la mémoire familiale. L'autrice ne se contente pas de relater les faits, elle y insuffle de la chair, du corps, des émotions. Les corps en mouvement, la brutalité de la guerre, le quotidien interrompu par l'exil, tout cela est décrit avec une force et une fluidité qui rend le passé terriblement vivant. L'utilisation du "je", du "tu" et du "nous" abolit les frontières temporelles, permettant à la narratrice et au lecteur de "marcher dans les pas" de ces absents.
Ce va-et-vient entre passé et présent, cette fusion des temporalités, permet de mettre en lumière la résonance des événements de 1936 avec le monde actuel. De Récondo évoque le "tourisme de guerre", le spectacle de la souffrance d'autrui que l'on observe sans agir, hier comme aujourd'hui. L'ouvrage est un hymne à l'accueil et à la générosité, un engagement politique pour l'humanité. L'autrice souligne le rôle des femmes dans ces périodes de l'histoire, souvent reléguées au second plan, alors qu'elles sont celles qui portent l'exil, les enfants et l'avenir.
À travers ce récit, c'est aussi un hommage à l'écriture, à son pouvoir de reconstruire, de rendre vivants les disparus. De Récondo n'a pas voulu que sa voix soit étouffée par les conventions romanesques. Elle a laissé la forme se plier à la nécessité du récit, intégrant des poésies qui s'imposent comme des parenthèses de liberté. La quête de ses papiers devient une quête littéraire, une exploration des archives, des actes de naissance et de décès, des traces écrites qui témoignent de la vie. Au-delà de l'histoire familiale, le livre célèbre la mémoire, la transmission et l'amour, "le seul territoire" capable de nous unir face à la violence du monde.
Bibliographie
Pour en savoir plus
Rencontre avec Léonor de Récondo
Rencontre du mardi 28 janvier 2020 à Station Ausone avec Léonor de Récondo autour de son nouveau ...
Léonor de Récondo - La leçon de ténèbres
Léonor de Récondo vous présente son ouvrage "La leçon de ténèbres" aux Editions Stock. Rentrée li...
Léonor de Récondo - Revenir à toi
Léonor de Récondo vous présente son ouvrage "Revenir à toi"
Rencontre en ligne avec Léonor de Récondo
Le 07/09/2021
Assistez à la rencontre en ligne avec Léonor de Récondo autour de son ouvrage "Revenir à toi" par...
Rencontre avec Léonor de Récondo
Rencontre avec Léonor de Récondo autour de son livre "Revenir à toi" paru aux éditions Grasset.
Le grand feu - Léonor de Récondo
Avec son nouveau roman, incontournable de la rentrée littéraire 2023, Léonor de Récondo livre un ...
Léonor de Récondo - Marcher dans tes pas
Une quête intime et politique, où l'écriture devient une arme face à l'histoire.
Léonor de Récondo vous présente son ouvrage "Marcher dans tes pas". Parution le 21 août 2025 aux...