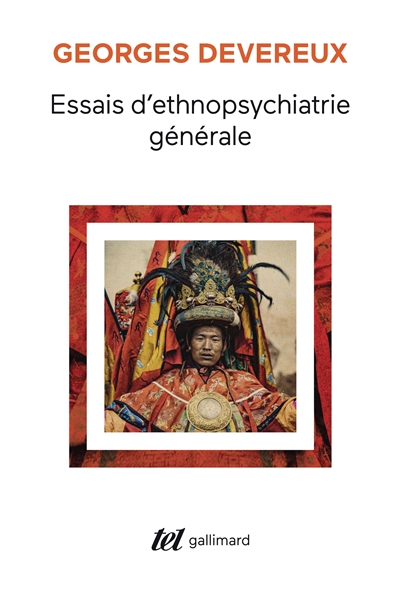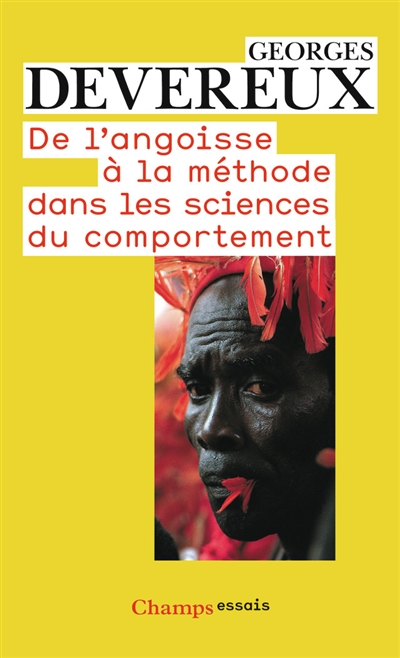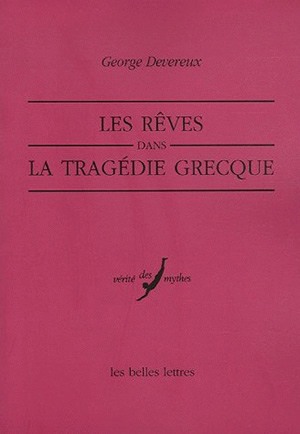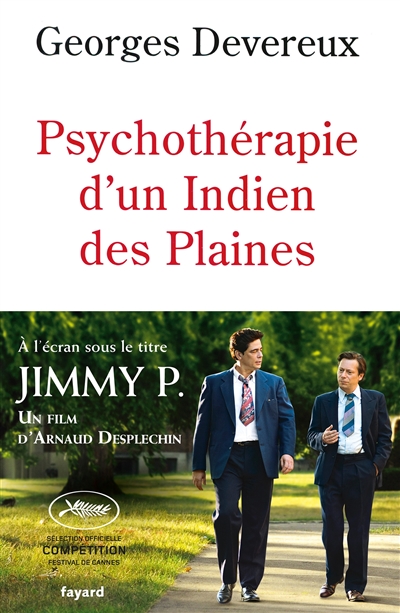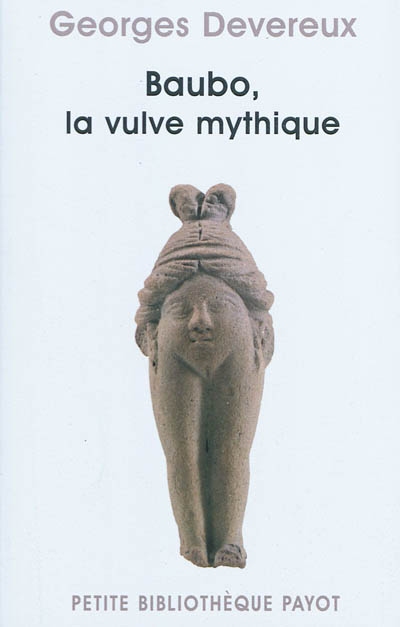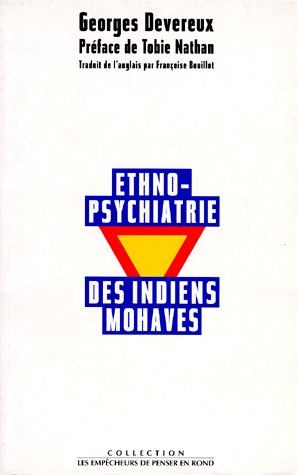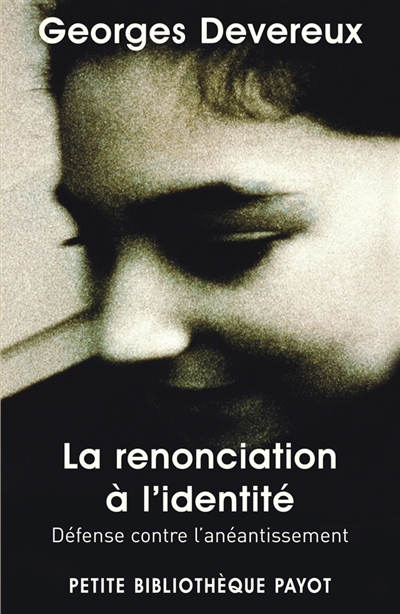C'est donc en sa qualité d'anthropologue spécialiste de la culture indienne que Georges Devereux fut contacté par l'hôpital de Topeka dans le Kansas. L'établissement fondé par l'éminent psychiatre américain Karl Menninger fut l'un des premiers hôpitaux américains à traiter les troubles psychologiques et psychiatriques des vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale.
En 1948, Georges Devereux rencontra ainsi Jimmy Picard, américain originaire de la tribu indienne des Blackfoot, qui a combattu en France et dont le diagnostic de schizophrénie ne parvient pas alors à convaincre complètement les psychiatres.Ainsi débuta la fameuse psychothérapie que Devereux relata en 1951 dans son ouvrage Psychothérapie d'un indien des plaines, véritable journal rapportant de manière minutieuse les rencontres avec ce patient qu'il ménera jusqu'à la guérison.
Georges Devereux, de son nom d'origine Gyorgy Dobo est né en 1908 en Transylvanie (actuelle Roumanie). Il abandonnera son nom dans les années 1930 en raison de la montée de l'antisémitisme en Europe. A l'âge de 18 ans, il émigre en France où il fréquente les milieux littéraires, s'adonne à la poésie et devient entre autres l'ami de Klaus Mann. Il travaille tour à tour en librairie, dans l'édition, entame des études de chimie auprès de Marie Curie pour finalement s'orienter vers le nouvel Institut d'Ethnologie fondé en 1927. Il y suit les cours de Marcel Mauss et de Lévy-Bruhl qui reconnaissent son talent aussi bien que son tempérament indiscipliné.
Devenu anthropologue, il se rend en 1933 aux États-Unis pour étudier la tribu indienne Hopi en Arizona puis les indiens Mohaves dont la culture l'influencera profondément et qui lui donnera le sujet de sa thèse " La vie sexuelle des indiens Mohaves". Mais au-delà de l'enquête ethnographique, Devereux s'interroge déjà sur l'impact de la culture sur certains troubles psychiques. C'est cette intuition qu'il confirmera avec Jimmy Picard quelques années plus tard en faisant ressurgir chez ce patient la problématique indienne.
Il met en place une méthode d'analyse ayant recours à la fois à l'ethnologie, à la psychologie et à la psychanalyse. Il est convaincu que tout comportement humain ne peut s'analyser qu'à la lumière de discours dits "complémentaires". Un thérapeute doit prendre en compte les logiques culturelles de son patient, leur impact sur le psychisme et ainsi alterner le voir ethnologique et l'approche psychanalytique ethnologique. C'est en cela que Georges Devereux est considéré comme le père de l'ethnopsychanalyse.
En 1970 les Essais d'ethnopsychiatrie générale regroupe un ensemble d'articles qui posent les bases méthodologiques de sa méthode analytique. Parallèlement, dans son ouvrage De l'angoisse à la méthode publié en 1967, il poursuit des recherches sur la place de l'inconscient de l'analyste dans le processus psychothérapeutique.
Malgré sa notoriété internationale, il faudra attendre 1963 pour que Georges Devereux soit reconnu en France. Il y revient à l'invitation de Claude Lévi-Strauss, Roger Bastide et Fernand Braudel qui lui proposent de créer la chaire d'ethnopsychiatrie à l'École Pratique des Hautes Etudes. Devenu psychanalyste au terme d'une analyse avec Robert Hans Joklil, il adhère à la Société Psychanalytique de Paris. Ses dernières recherches portèrent sur l'interprétation de certains éléments et récits de la mythologie grecque qui le fascinait. A sa mort en 1985, ses cendres furent transférées selon sa volonté dans la réserve des Indiens Mohaves pour lesquels il eut une affection profonde. Tobie Nathan et Marie-Rose Moro poursuivent chacun de manière distingue la pratique de Georges Devereux.