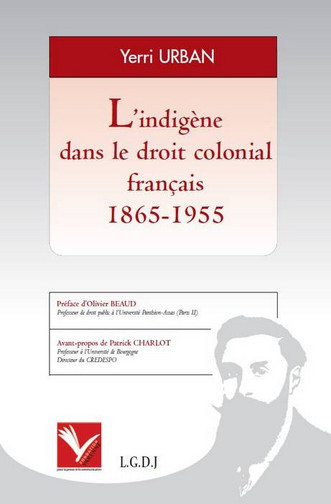en savoir plus

Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).
Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.
Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.
Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...
Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.
Requiert un compte Mollat
Requiert un compte Mollat
L'indigène dans le droit colonial français, 1865-1955
Auteur : Yerri Urban
en savoir plus
Résumé
Après une première partie concernant l'instauration d'un droit de la nationalité pour les colonisés de 1834 à 1916, l'auteur de cette thèse s'intéresse au concept de race, puis au dépérissement du droit de nationalité, de 1918 à 1955. ©Electre 2025
Quatrième de couverture
L'indigène dans le droit colonial français 1865-1955
Cette recherche porte sur l'émergence, l'existence tumultueuse et la disparition progressive de cette catégorie du droit français de la nationalité qu'on nomme indigène. En effet, durant un court siècle (1865-1955), ce droit ne se résume pas à la distinction entre nationaux et étrangers : il comporte trois catégories, le Français, l'étranger et l'indigène, auxquelles peut s'ajouter, dans de nombreux territoires, une quatrième, l'étranger assimilé à l'indigène. Dans son Empire, la France choisit ainsi de superposer à la différenciation territoriale entre l'État métropolitain et les possessions une différenciation en matière de nationalité entre le peuple métropolitain et les originaires des possessions. Elle doit alors élaborer un droit pour ces derniers. Son histoire, soumise aux contraintes du concept juridique et politique de civilisation, du régime législatif, de la conception de la nationalité du Code civil de 1804 et de la situation géographique et géopolitique, résulte de dynamiques multiples et constantes.
Ce droit émerge au début de la présence française en Algérie, avant de voir ses principes posés en 1865 : expression d'un compromis entre mission civilisatrice et principe des nationalités, il doit permettre à l'indigène de s'assimiler à la nation française par le biais d'une naturalisation, conçue comme une « conversion à la civilisation ». Toutefois la naturalisation sera progressivement régie par des textes de plus en plus sélectifs, visant à la francisation des seules élites. Si, dans la plupart des possessions, aucun texte ne définit l'indigène, il en va autrement en Indochine : il y est longtemps perçu en termes ethniques-raciaux et y sont adoptées, dans les années 1930, les dispositions les plus complètes, marquées par la focalisation sur la question du métissage, aussi bien entre Européens et indigènes qu'entre Chinois et indigènes. Ce droit dépérira progressivement par la suite : sous Vichy, parce que l'on tend à transformer l'indigène en catégorie raciale ; sous la IVème République, parce qu'il est considéré comme discriminatoire.
L'indigène n'avait jamais vu son histoire retracée. Ce vide est comblé ici.
Fiche Technique
Paru le : 11/01/2011
Thématique : Grands thèmes droit public
Auteur(s) : Auteur : Yerri Urban
Éditeur(s) :
Fondation Varenne
LGDJ
Collection(s) : Collection des thèses
Contributeur(s) : Préfacier : Olivier Beaud - Préfacier : Patrick Charlot
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-916606-35-4
EAN13 : 9782916606354
Reliure : Broché
Pages : XXVI-665
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 3.6 cm
Poids: 1130 g