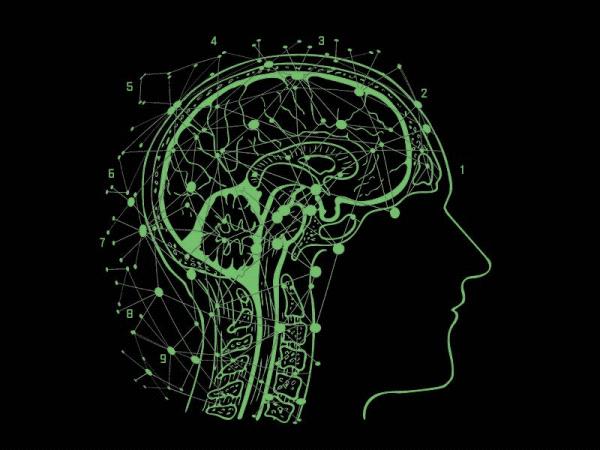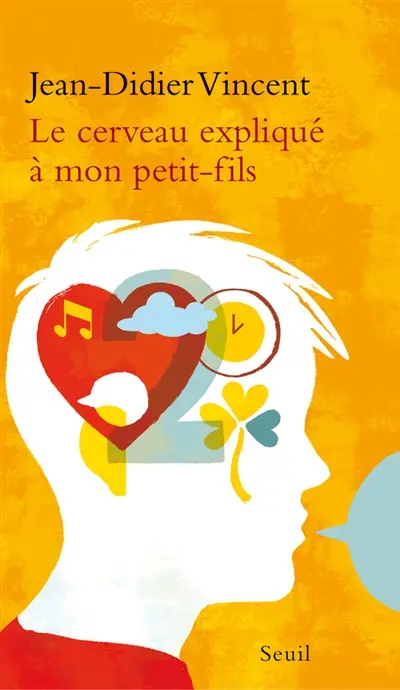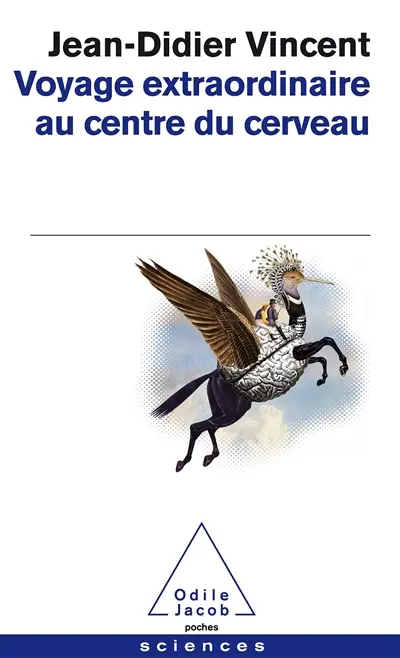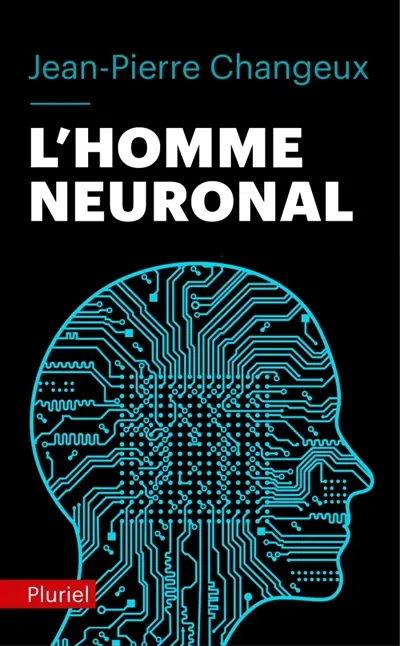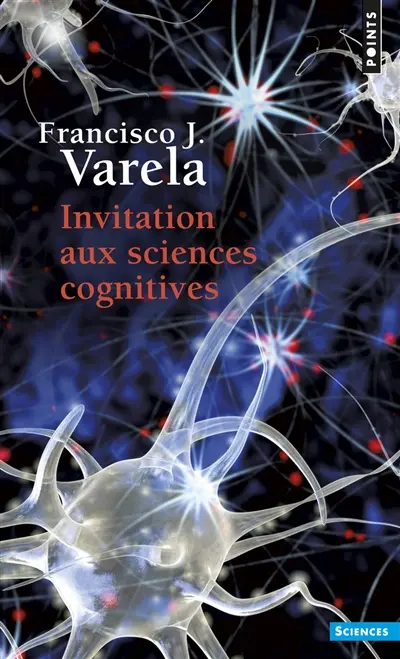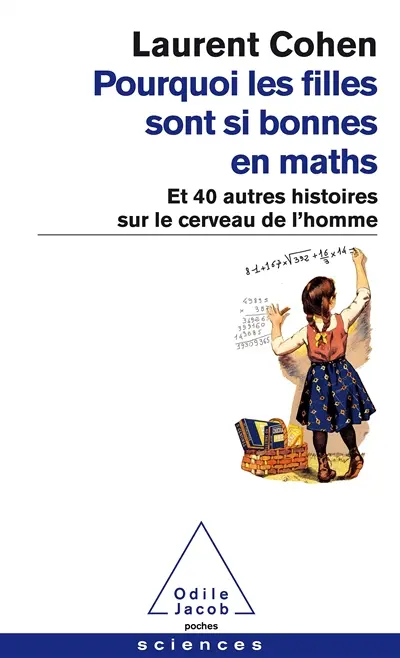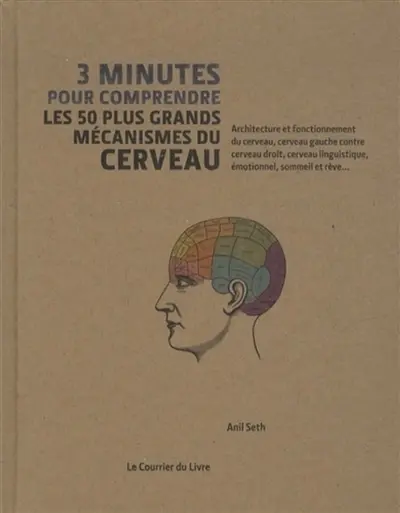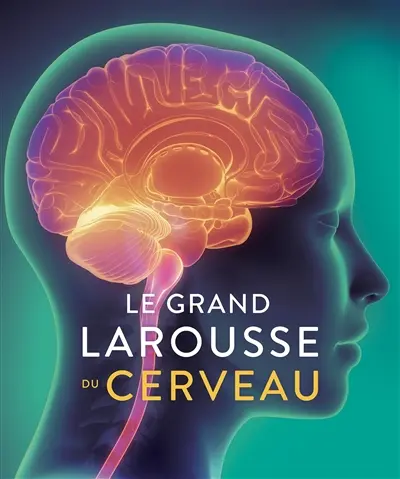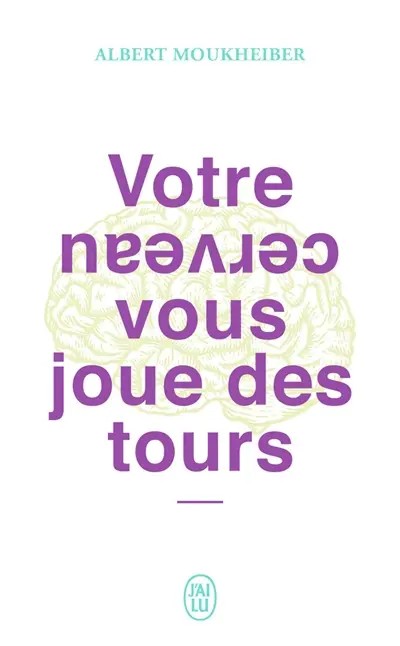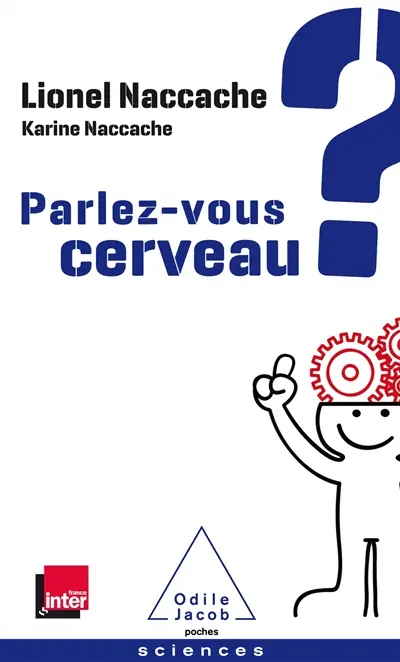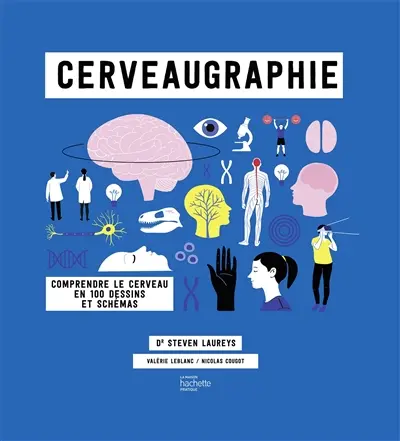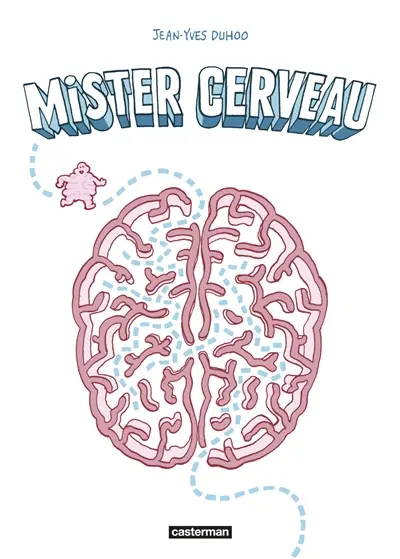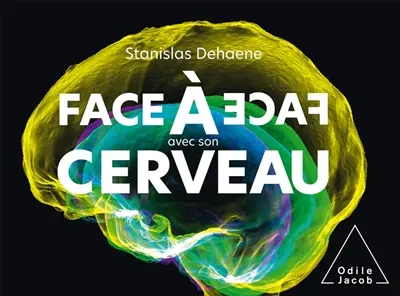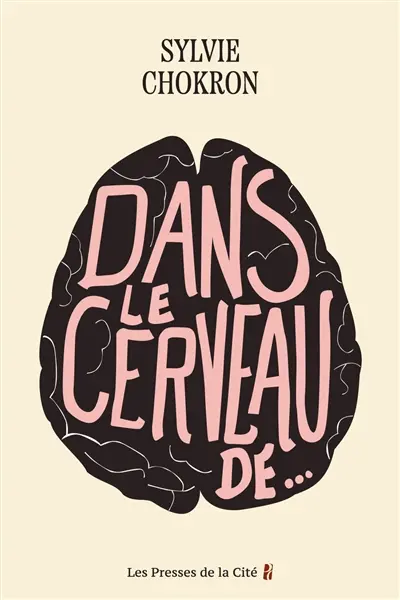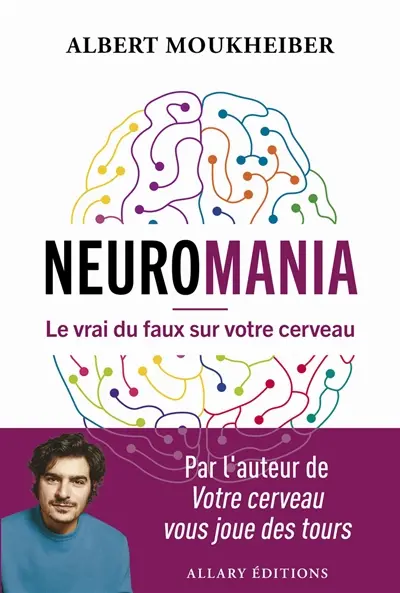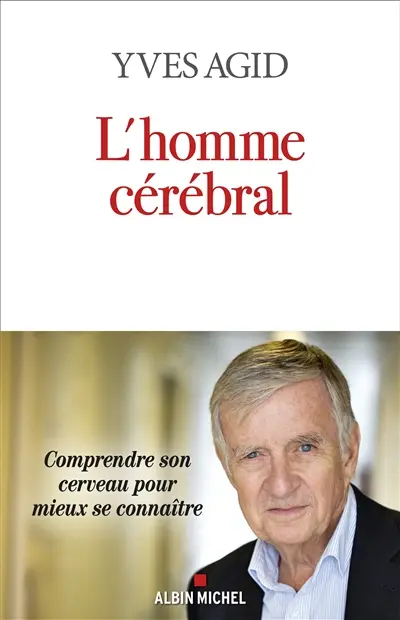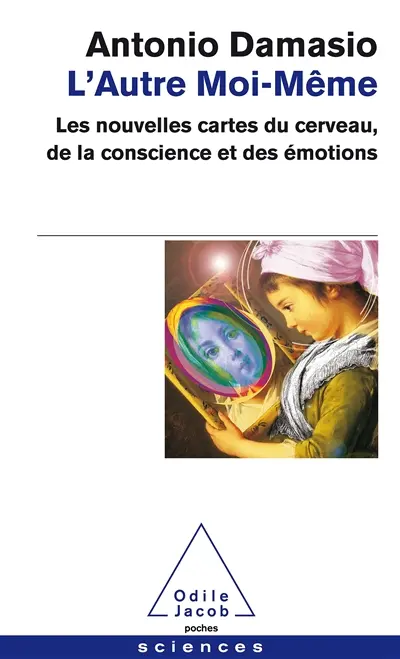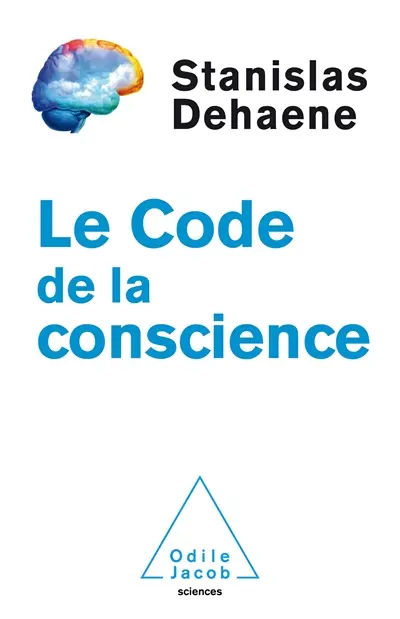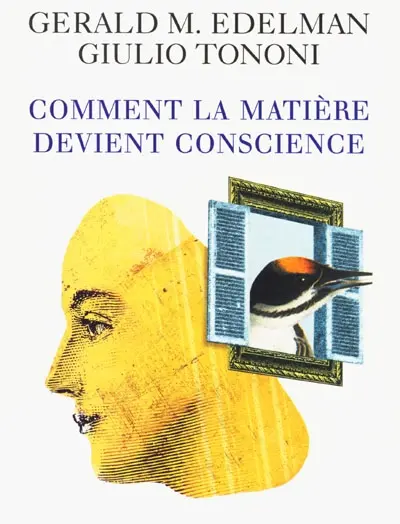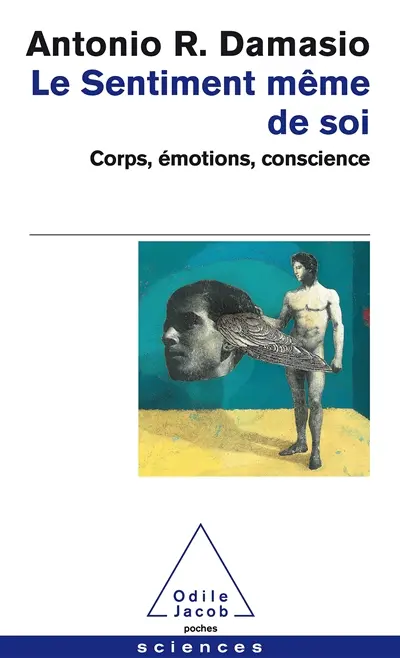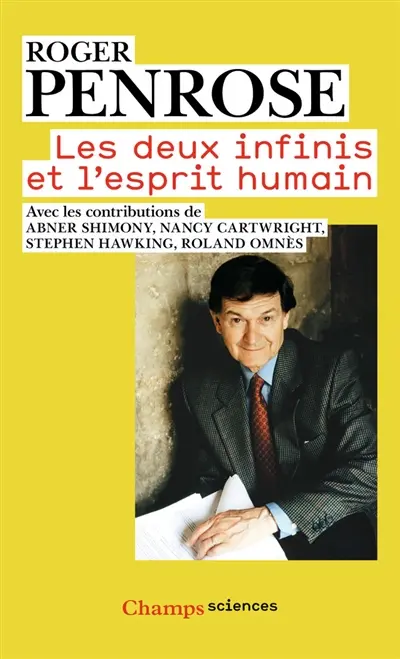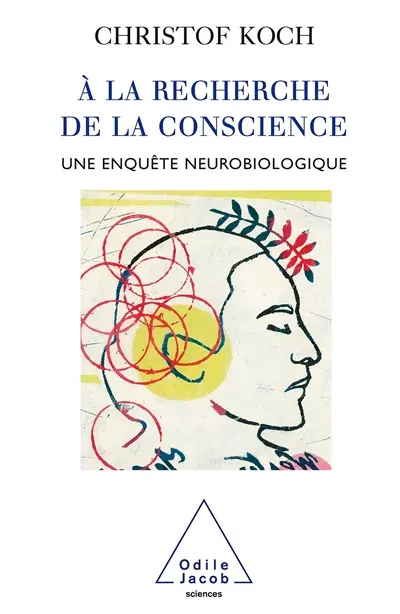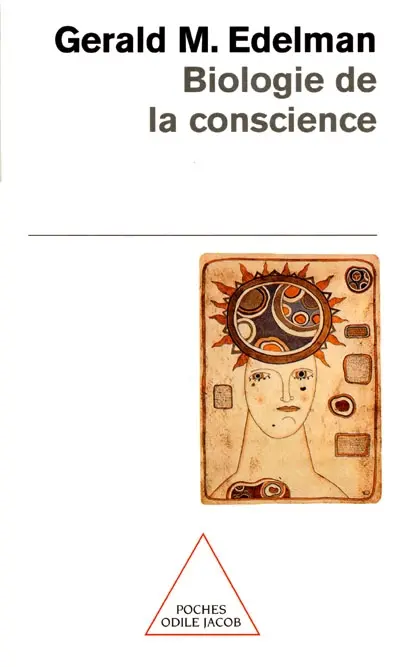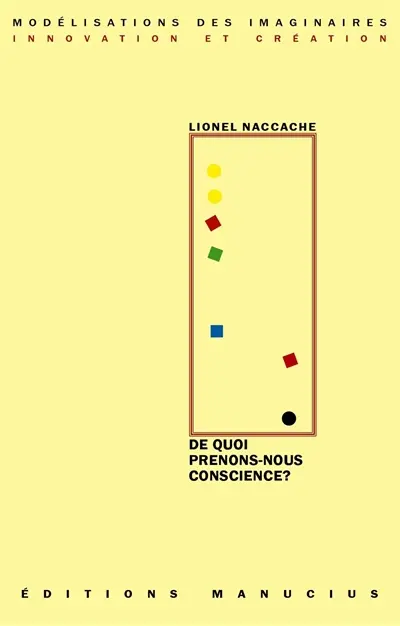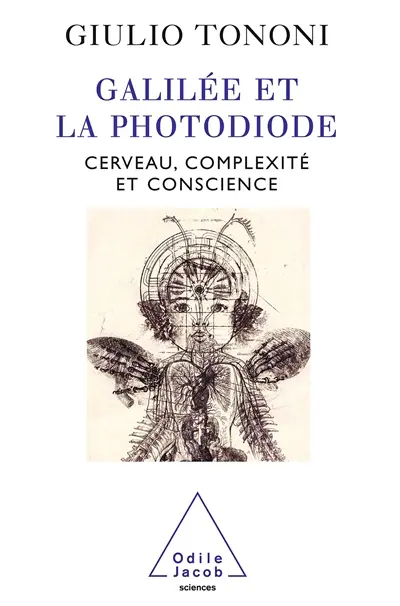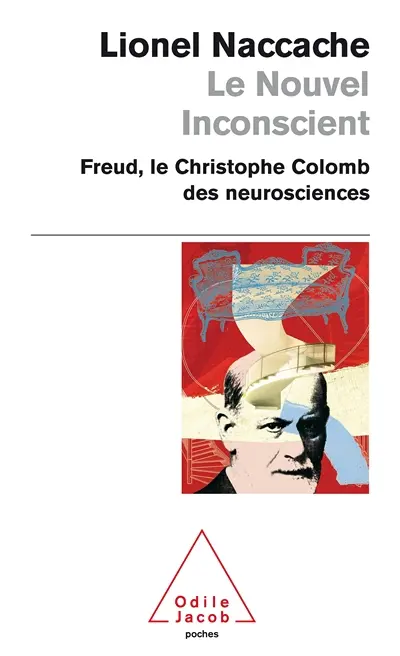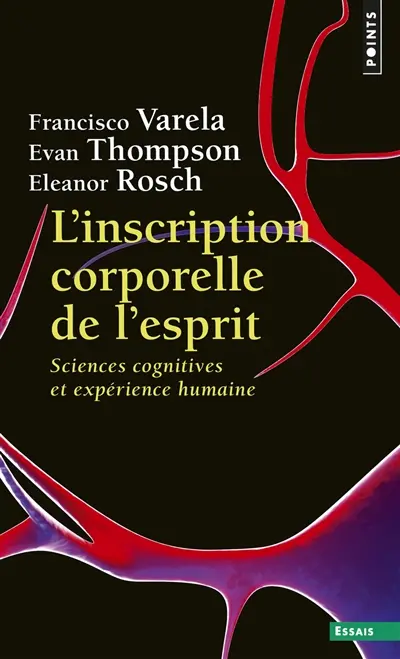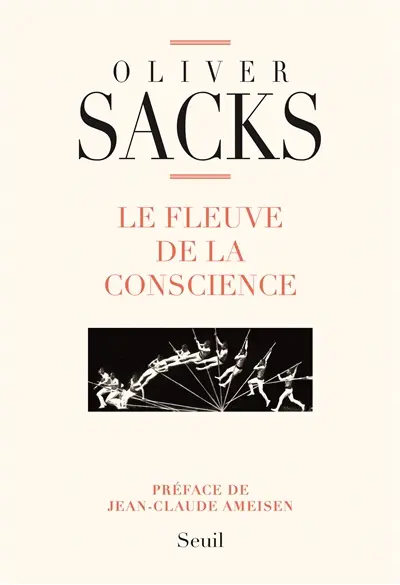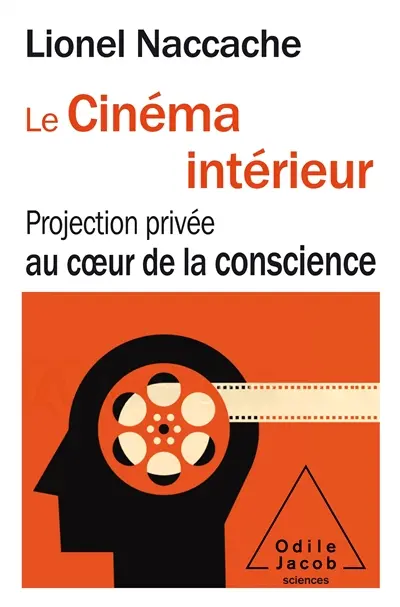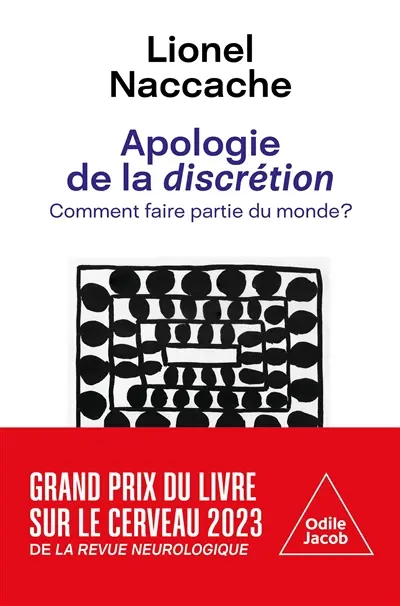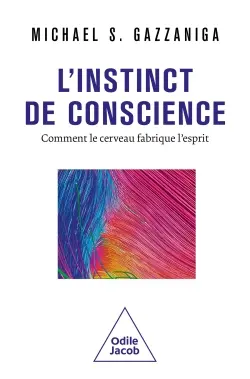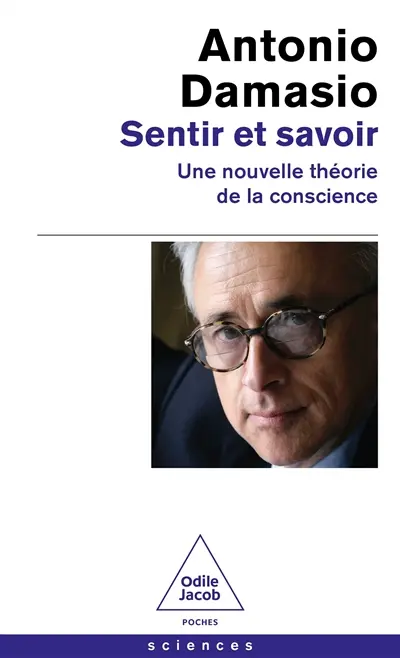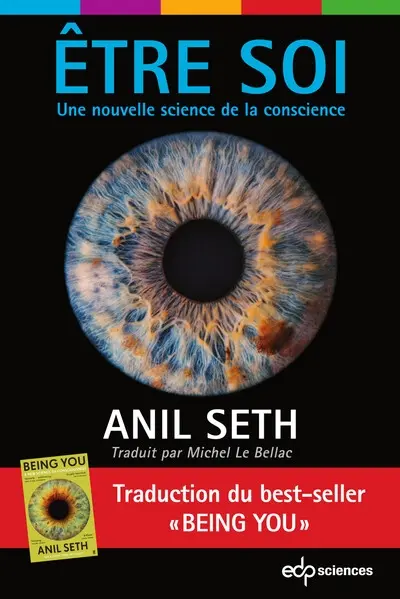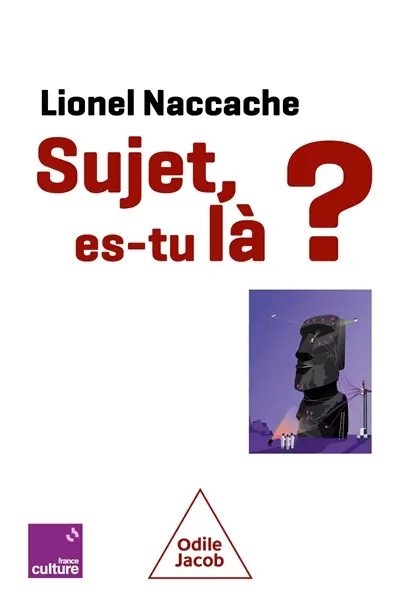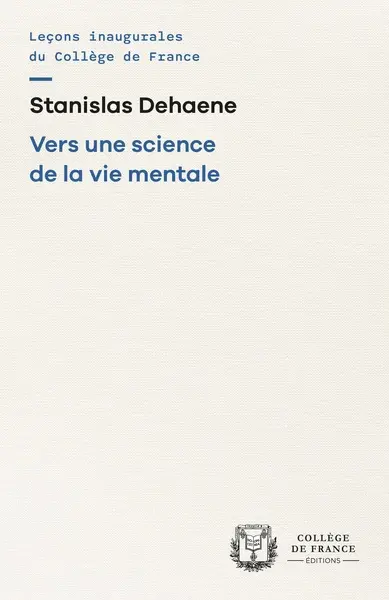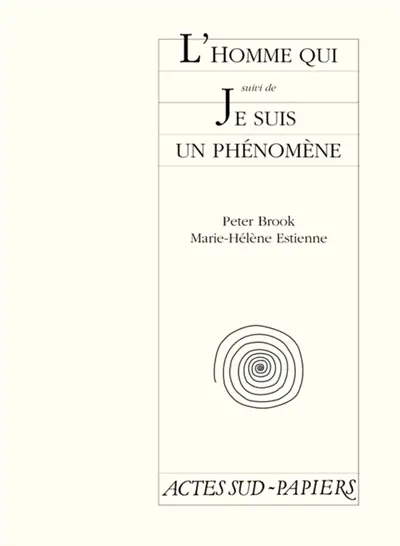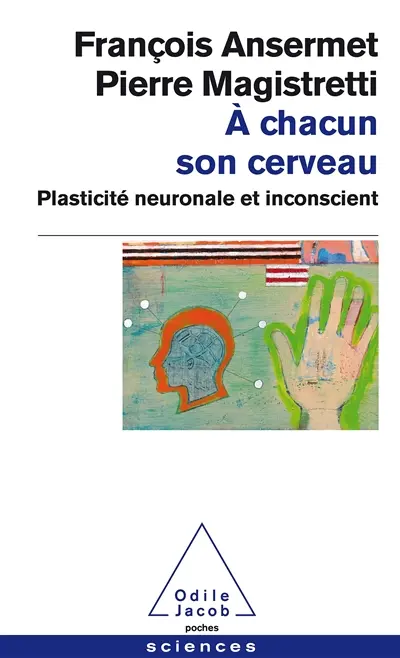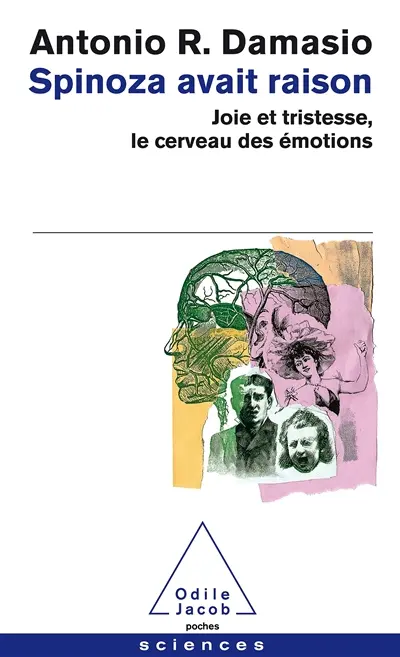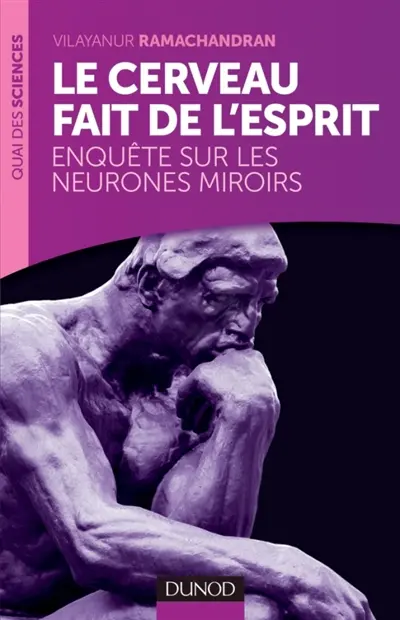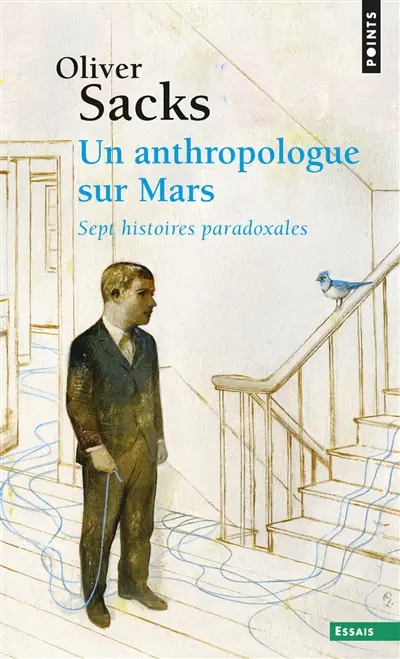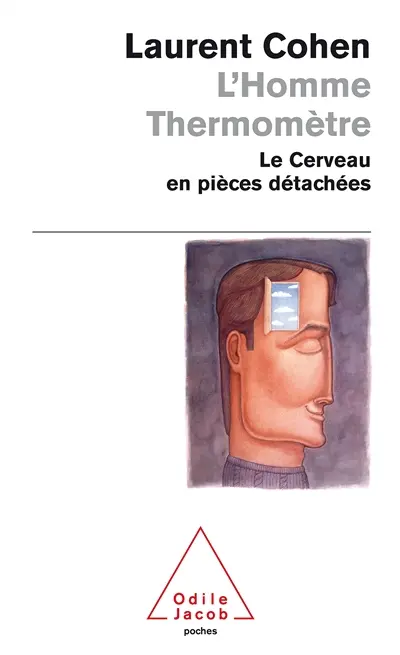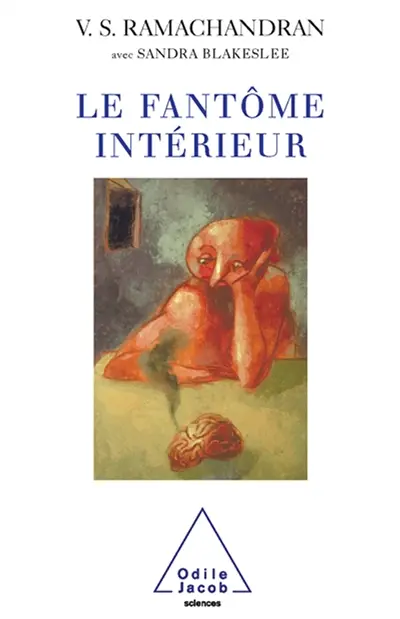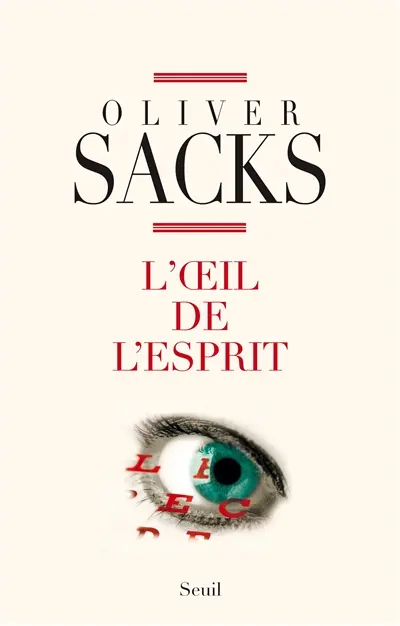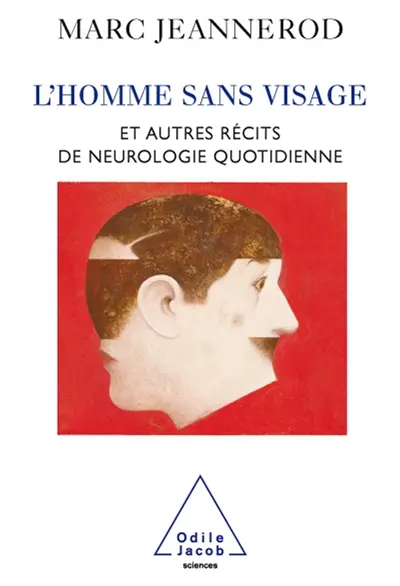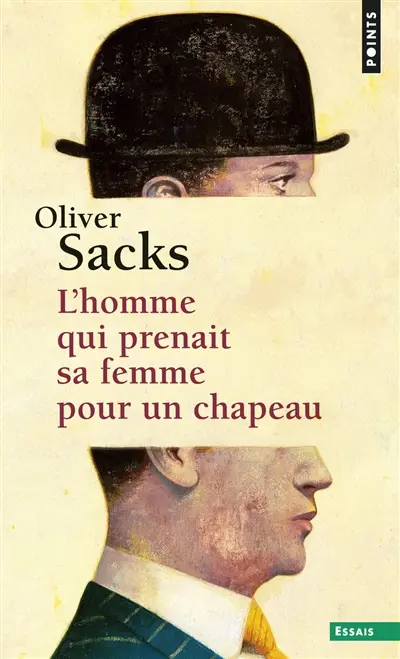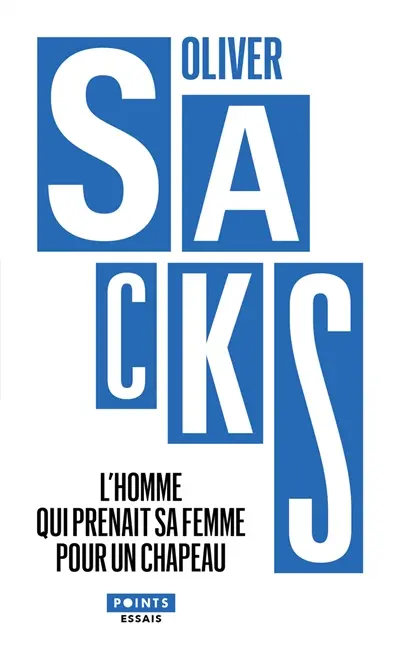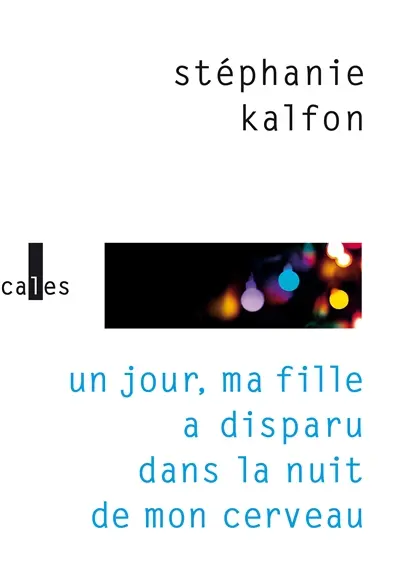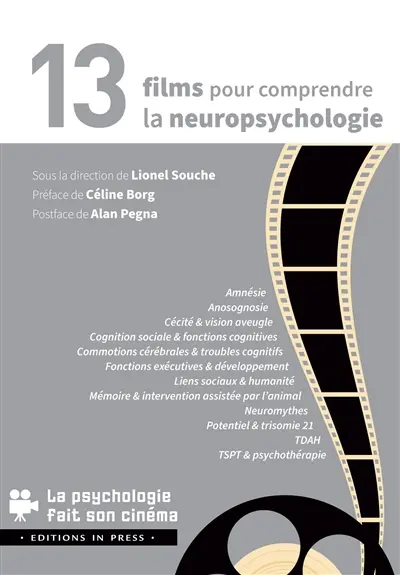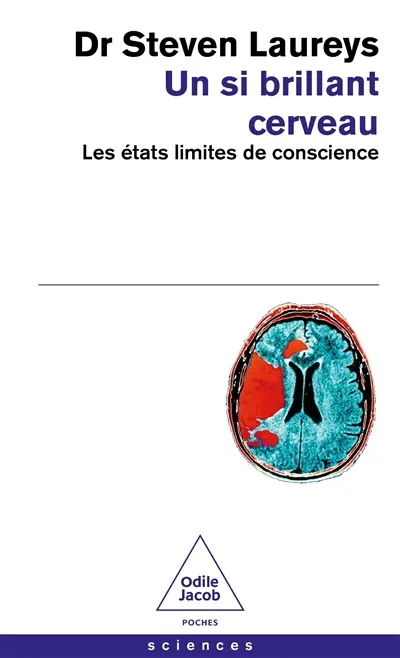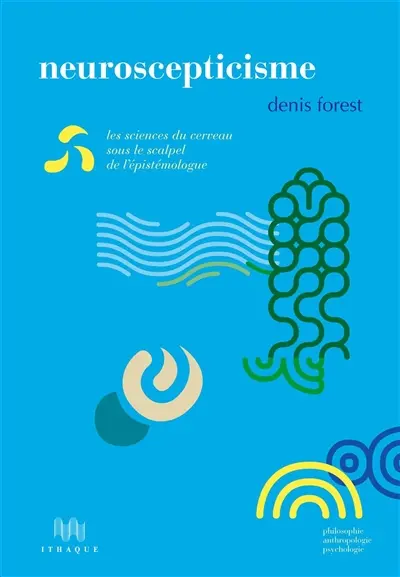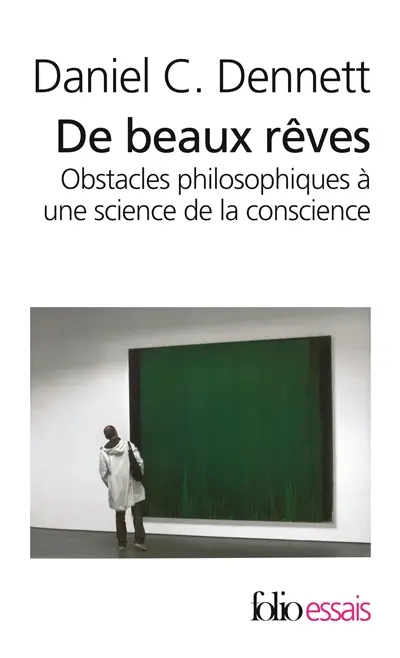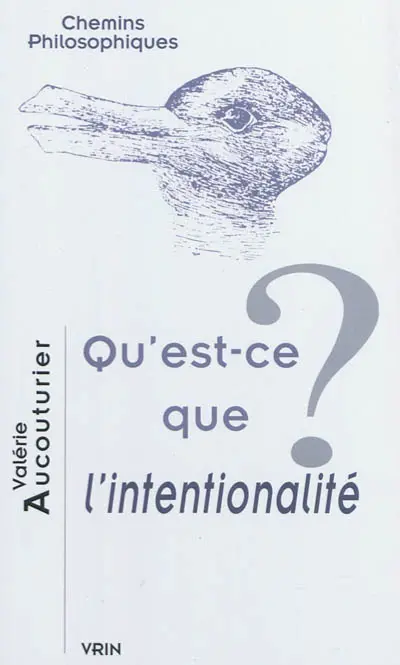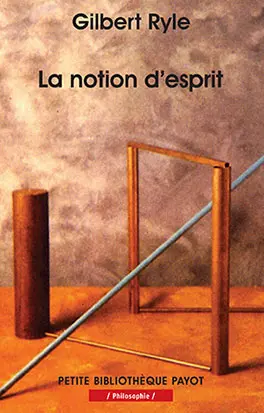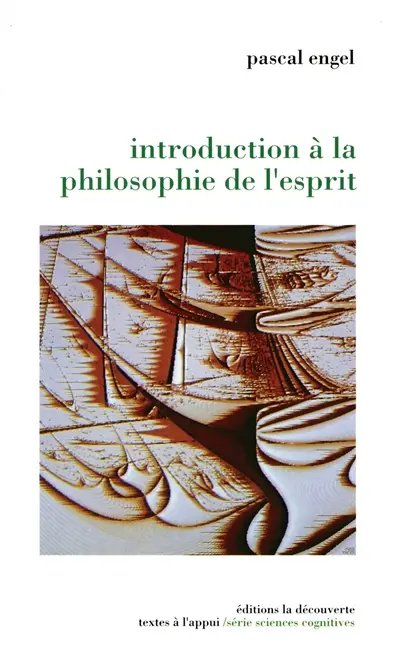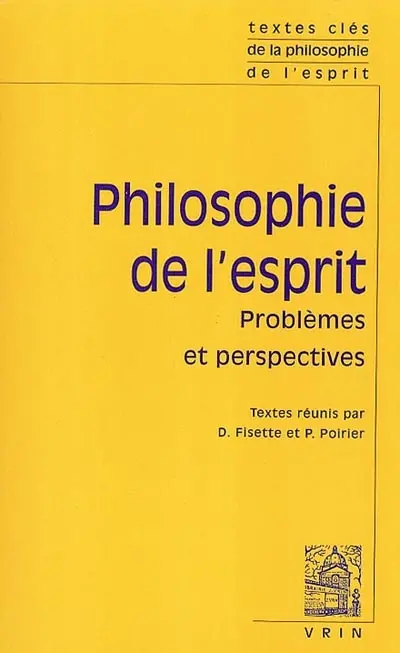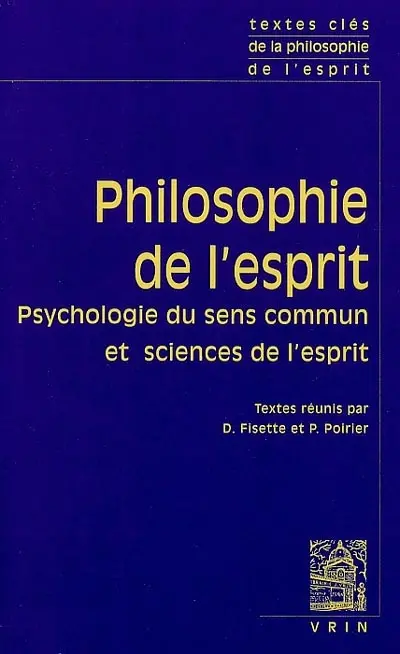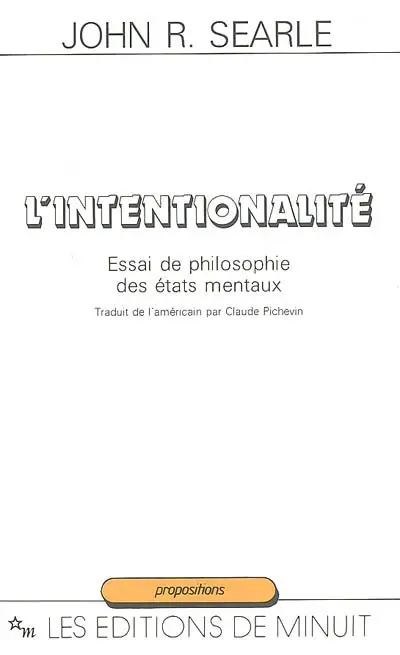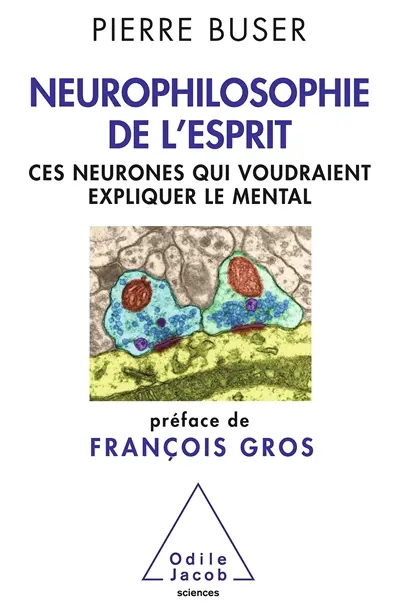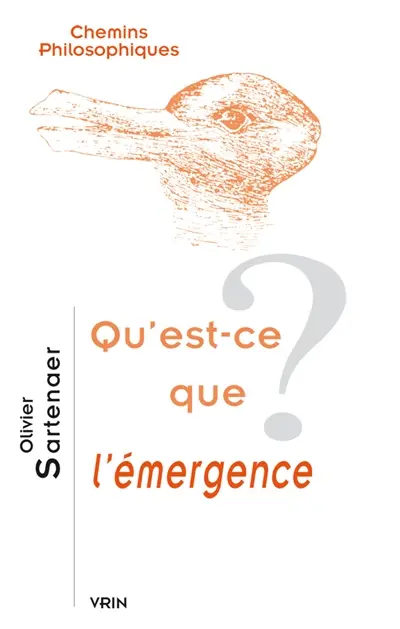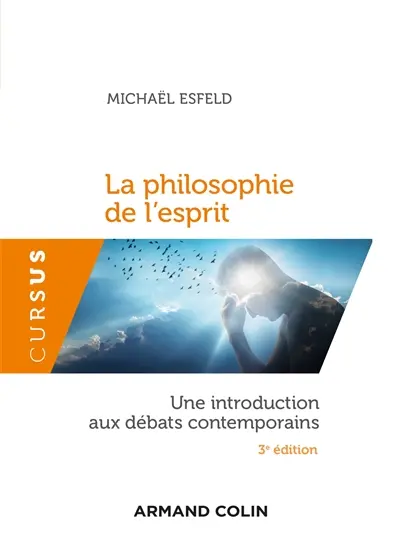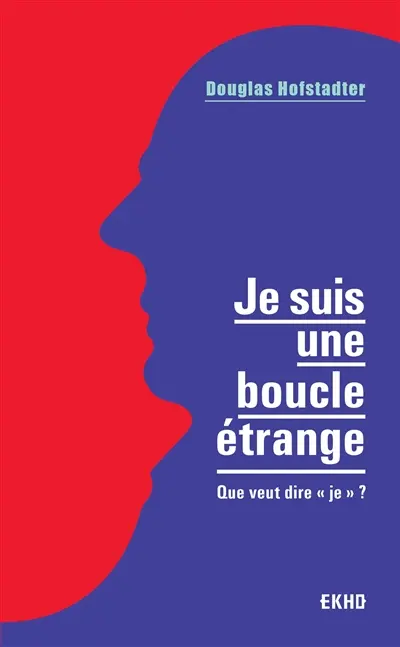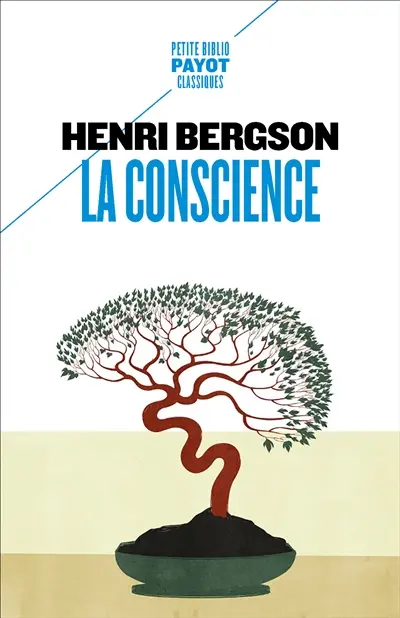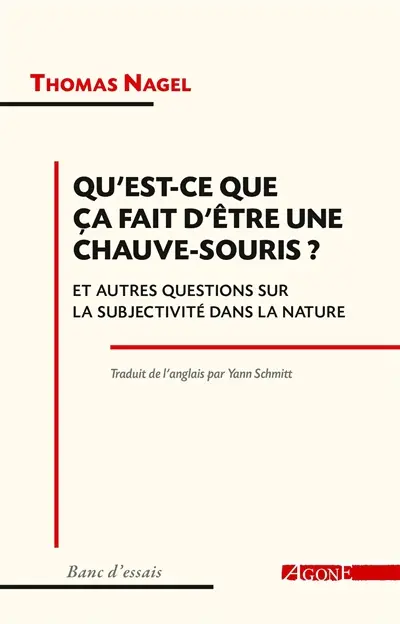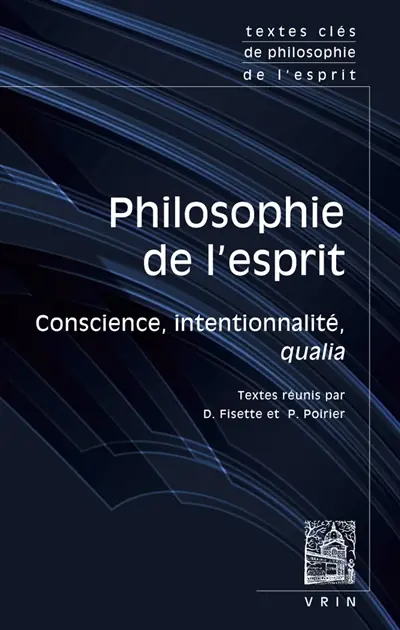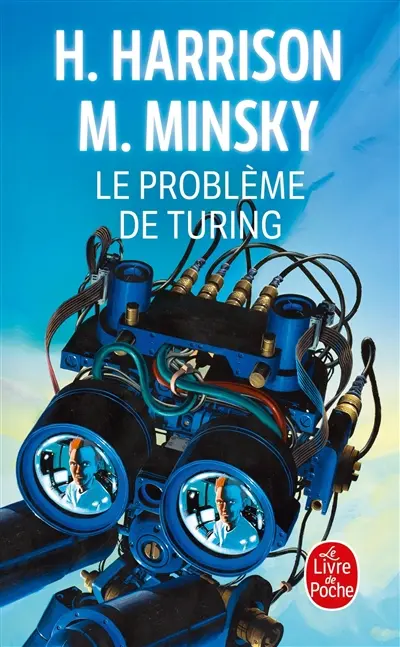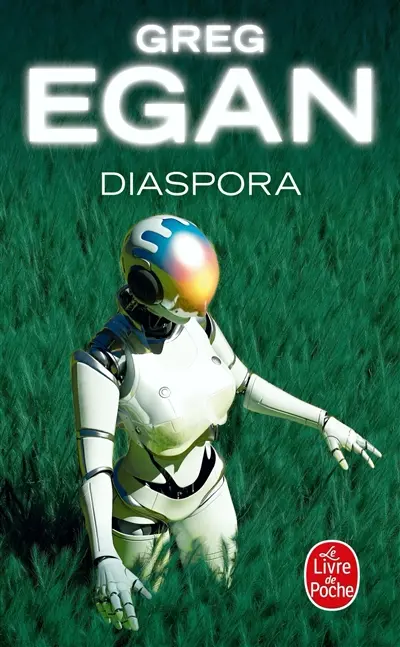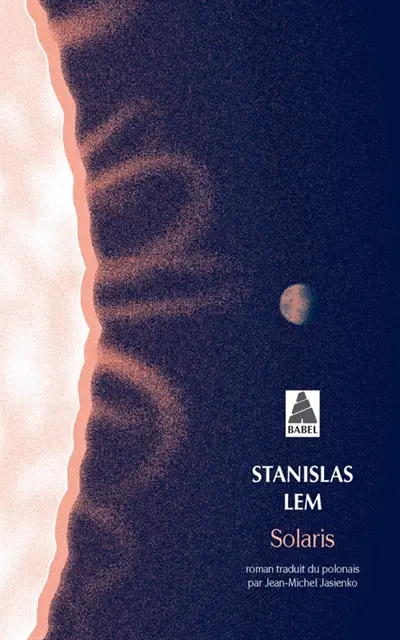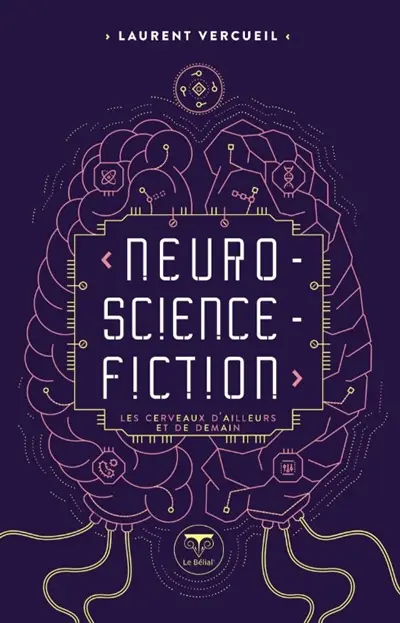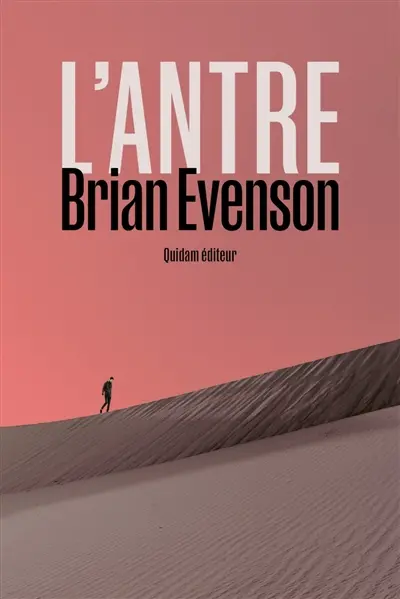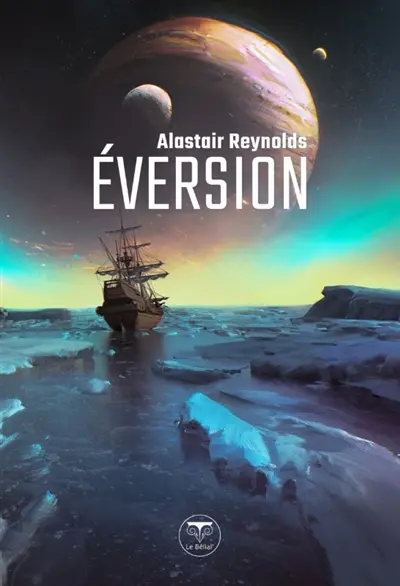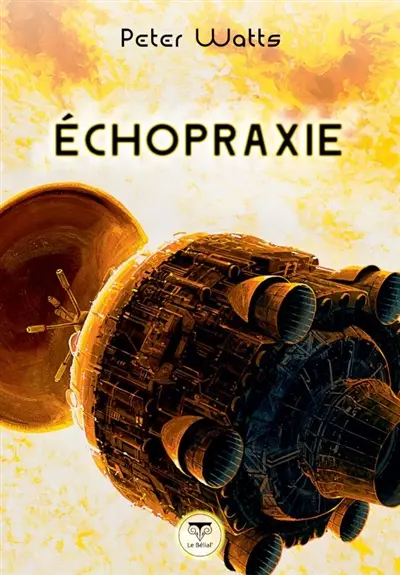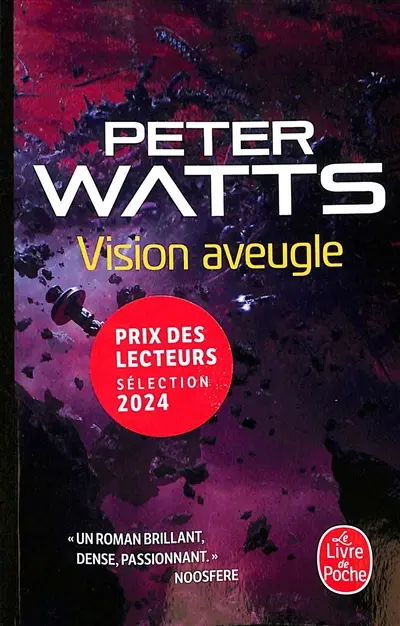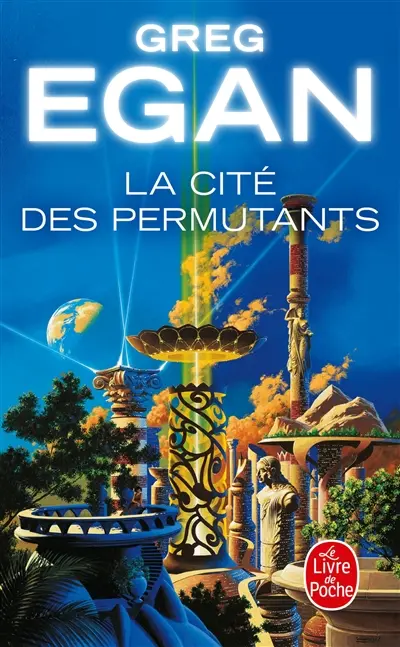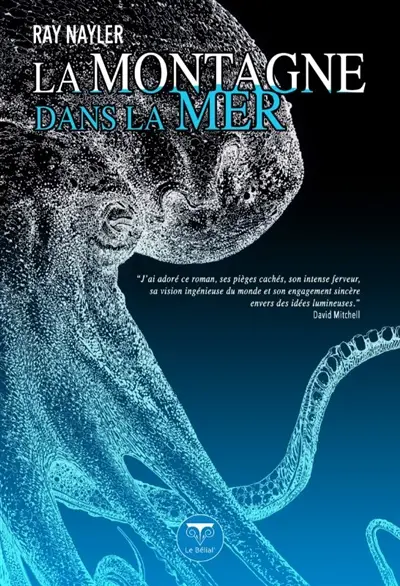Ce ne sont pas là des mots que vous entendrez dans une séance de spiritisme, mais quelques-uns des concepts clefs utilisés par les sciences cognitives, pour tenter de percer l’ultime secret de l’esprit humain : sa conscience.
Inutile de faire tourner les tables pour ça ; il s’agira plutôt de vous retourner le cerveau.
Qu’est-ce qu’une âme ? Il est facile de la définir négativement : c’est très exactement cela en nous qui se rétracte quand nous entendons parler de séries algébriques.
C'est quoi, la conscience ?
En détournant une citation de Paul Valéry, on pourrait dire que « la plupart des hommes ont de la conscience une idée si vague que ce vague même de leur idée est pour eux la définition de la conscience. » Ce serait un « je ne sais-quoi », un petit truc en plus, qui ferait le sel de la vie. Quelque chose d’évident et de mal défini pourtant, parce qu’elle échapperait justement à toute tentative d’explication scientifique.
Essayons quand même d’être un peu plus précis. Quand on parle de conscience, on désigne quelque chose d’autre que nos sensations, notre mémoire ou notre raisonnement. Il s’agirait plutôt de notre faculté à nous « rendre compte » d'une perception, d’un souvenir ou d’une idée qui nous traverse la tête, et aussi de notre capacité à les rapporter à nous-même, au « je » de l’esprit. Voilà qui confère déjà un peu plus de consistance à notre « vague de l’âme ». Reste maintenant à lui donner corps.
C'est fait en quoi ?
21 grammes. C’est le poids de l’âme humaine, d’après les mesures très approximatives effectuées par le médecin Duncan MacDougall en 1907 (et totalement discréditées depuis). La science moderne ne traite plus l’âme comme une substance. Encore moins comme une substance pesante ou observable. L’hypothèse est devenue superflue. Pour faire notre examen de conscience, on se contentera de sonder notre kilo et demi de matière cérébrale. Sans pour autant renier la particularité de nos états mentaux.
Le paradigme fonctionnaliste, qui domine aujourd’hui les sciences cognitives, distingue la fonction qui est étudiée de la manière dont elle est réalisée concrètement. Une montre, par exemple, peut vous donner l’heure sans qu’aucun de ses rouages ne possède la notion d’heure. Il en va de même pour la conscience. Il nous est possible de l’étudier à partir des processus physiques qui sont mis en œuvre, sans toutefois l’y réduire. C’est ainsi que la science pourra étudier son sujet de manière objective. Nous aurons perdu notre âme ici, mais nous aurons gagné une conscience.
Cent kilos de levure ne s’émerveillent pas devant une toile de Braque, ni devant quoi que ce soit ; vous si, et pourtant, vous êtes fait de cellules qui, fondamentalement, sont des choses du même genre que ces cellules de levure [...].
C'est où ?
Il fallait peut-être un œil d’artiste pour admettre l’impensable. En dessinant ses observations effectuées sur de fines tranches de cerveau, Ramon y Cajal remarque que nos neurones ne sont pas reliés les uns aux autres, comme on le croyait alors, mais qu’ils sont séparés par de petits interstices : les synapses. D’un coup de crayon, notre âme est pulvérisée. Nos pensées, notre conscience, notre identité sont éparpillées en une myriade de cellules.
Où se trouve la tour de contrôle ? Où est l’administrateur central ? Nul part. Partout. C’est en tout cas l'une des hypothèses privilégiée pour l’explication de la conscience proposée par Jean-Pierre Changeux, Stanislas Dehaene et Lionel Naccache avec la théorie de l'espace global de travail. Le cerveau fonctionnerait comme un concert de voix, dépourvu de chef d’orchestre, et ce serait cette grande « conversation », en elle-même, qui sélectionnerait une partie des opérations sur laquelle notre attention se porterait. Notre conscience serait « discrète », et néanmoins parfaitement observable.
C'est tout ?
Et puis quoi encore ? Des crépitements électriques jaillissant dans le cerveau, quelques gouttes de produits chimiques répandues, par-ci par-là, et voilà la madeleine de Proust expliquée ? Est-ce qu’il n’y a pas, une fois toutes les dissections, toutes les imageries et tous les tests effectués, quelque chose qui résiste encore à nos analyses ? Quelque chose dont on ne peut pas rendre compte par une colonne de chiffres. L’odeur du jasmin, la couleur rouge, la douleur que je ressens en me cognant le gros orteil, « l’effet que ça fait » d’être moi.
Les « philosophes de l’esprit », comme on les appelle, se sont très vite emparé de ces questions, et nombre d’entre eux ont tenté de tracer une limite à notre compréhension scientifique de la conscience, Faut-il y voir la résurgence de présupposés d’un autre temps ? Une position conservatrice ?
Psychologues, neuroscientifiques et philosophes sont aujourd’hui engagés dans d’âpres discussions sur ces problèmes. De leurs réflexions émergera peut-être une meilleure conscience de ce qu’est la science ainsi qu’une nouvelle science de la conscience.
Multiforme, complexe, déroutante, la conscience joue avec nos nerfs. À bien d’égards, elle ressemble à un tour de magie : nous ne sommes jamais tout à fait sûr d’avoir bien vu les fils (les axones en l'occurrence) qui expliquent le phénomène, ni d’avoir bien compris ce qu’il s’est passé sous nos yeux.
Une chose est certaine, les scientifiques sont bien déterminés à dissiper le mystère, et à lever le voile sur cette ultime énigme de la connaissance humaine. En espérant nous retrouver nous-mêmes derrière le rideau.